-
Normal avec une CAF faisant dans le ridicule
-
Les autorités relèvent le niveau d’alerte suite à la montée des eaux de l’oued Loukkos
-
Partenariat Maroc – UE : 15ème session du Conseil d’association à Bruxelles
-
Hassan Tariq : La Haute Approbation Royale instituant la Journée nationale de la Médiation de service public, une étape charnière pour sa valorisation au sein de l'administration
«L’ UE fait de son mieux pour rendre la traversée des migrants irréguliers pénible voire mortelle et cela au détriment du respect des droits de l’Homme ». Telle est, en substance, la conclusion qui ressort d'un récent document du Conseil de l’Europe. Selon celui-ci, les politiques européennes sont responsables des milliers de morts en mer Méditerranée. En effet, ces politiques sont accusées de retrait progressif des navires affrétés par les Etats, d’entrave aux activités de sauvetage des ONG et de coopération avec des pays tiers en matière de migration sans respect aucun des droits fondamentaux des migrants. Concernant la politique de désengagement des pays européens vis-à-vis du sauvetage des migrants irréguliers, le Conseil de l’Europe a indiqué que le risque de noyade semble demeurer élevé tout en précisant qu’il a augmenté légèrement dans les mois qui ont suivi la première vague de la pandémie de Covid-19. Selon ledit document, les naufrages en Méditerranée continuent à être d'une fréquence inquiétante notamment avec le manque d'opérations de recherche et la faible capacité de sauvetage mise en place. A ce propos, le Conseil de l’Europe a constaté qu’aucun navire supplémentaire ou dispositif spécifiquement dédié aux activités de recherche et de sauvetage n’a été déployé par les Etats membres notamment le long de la route migratoire de la Méditerranée centrale où il y a urgence à agir. Une situation qui s’est détériorée davantage avec la pandémie de Covid-19. Même la mise en place de l’opération Eunavfor Med Irini en avril 2020 n’a rien changé à la donne. Selon l'Organisation internationale pour la migration (OIM), plus de 2.600 décès ont été recensés en Méditerranée entre le deuxième semestre de 2019 et 2020, dont la grande majorité a eu lieu sur la route de la Méditerranée centrale. Le Conseil de l’Europe va plus loin. Il estime que la faiblesse de la présence des pays européens dans cette zone est volontaire puisque l’UE cherche par cela à «nettoyer le champ» pour les interceptions opérées par les garde-côtes libyens qui ont permis, selon les données de l'OIM, plus de 20.000 retours en Libye entre 2019 et 2020 et exposé nombre de personnes à de graves violations de leurs droits humains. A ce propos, ledit document a noté que les relations de coopération avec les pays tiers, y compris la Libye, ont été renforcées malgré les preuves indéniables de l'existence de graves violations des droits humains, et le manque de garanties ou de principes de transparence et de responsabilité. A cet effet, le document a rappelé que le commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe a, dans une lettre adressée au Premier ministre italien, réitéré sa préoccupation face à la coopération de Rome avec le gouvernement libyen d'accord national (LGNA), et appelé à l'introduction de garanties claires dans le mémorandum d’accord bilatéral (MoU). Ce dernier a été, en effet, prorogé sans aucun changement concernant le respect des droits de l’Homme et rien aujourd’hui n'indique qu'il va inclure des garanties protégeant les migrants contre les graves violations des droits de l'Homme. « En l'absence de telles garanties et d'une amélioration significative de la situation des droits de l'Homme en Libye, il est essentiel que cette coopération soit suspendue immédiatement », recommande le Conseil de l’Europe tout en soulignant que, plutôt que de considérer la coopération entre l'Italie et la Libye comme un prototype de coopération à éviter, d'autres Etats membres semblent l'utiliser comme un modèle. « En mai 2020, Malte a pris de nouvelles mesures pour renforcer sa coopération avec Tripoli en signant un nouveau protocole d'accord, qui fournit une base juridique à la création de centres de coordination conjoints en Libye et à Malte. Bien que peu de détails sur le projet envisagé ont filtré, néanmoins, cette coordination conjointe pourrait contribuer à permettre aux gardecôtes libyens d'intercepter les réfugiés et les migrants en mer pour les renvoyer en Libye. En outre, le mémorandum engage Malte à proposer à l'UE de fournir plus de financement pour les actions maritimes à déployer en vue d’intercepter les réfugiés et les migrants, mais ne prévoit aucune garantie spécifique en matière de droits de l'Homme », précise le document. En outre, il a également observé les retards enregistrés au niveau des débarquements des bateaux de sauvetage qui doivent attendre des journées voire des semaines alors que cette attente présente de graves risques pour les droits, la santé et le bien-être des survivants et des équipages des navires qui les ont sauvés. Le Conseil de l’Europe a noté, à ce propos, que les pays européens continuent à entraver le travail de sauvetage des ONG. En effet, plusieurs associations se plaignent du refus de coopération des autorités chargées des opérations de recherche et de sauvetage et du fait d’être ignorées ou mises à l’écart dans des opérations de sauvetage même quand elles sont les mieux placées pour effectuer ce travail. « Il semble y avoir une réticence persistante à utiliser les capacités fournies par les ONG pour garantir la meilleure protection des vies en mer, ce qui peut également être lié à la tendance mentionnée ci-dessus à donner aux autorités libyennes plus de latitude pour effectuer des interceptions », a conclu le document.
Hocine Zeghbib, professeur de droit public honoraire à Montpellier : Le Conseil de l’Europe a tout simplement pris acte de la mauvaise conduite de l’UE et l’a fait savoir de manière moins diplomatique que d’ordinaire
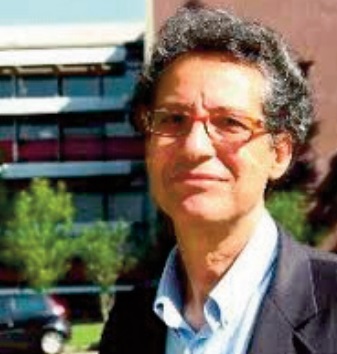
Libération : Comment une institution européenne peut-elle remettre en cause les politiques migratoires des pays européens ?
Hocine Zeghbib : A première vue, cela peut en effet sembler étonnant.En réalité, cela l’est moins si on garde en mémoire que le rapport très critique rendu pour 2020 (il y est expressément écrit qu’il prend en compte la situation jusqu’au 31 décembre 2020) a été précédé, dans celui de 2019, de critiques sérieuses de l’action de l’UE en matière de migration en général et en Méditerranée en particulier. Le Conseil de l’Europe prend donc simplement acte de «la mauvaise conduite » de l’UE et le fait savoir de manière beaucoup moins«diplomatique» que d’ordinaire. En outre, il ne faut pas oublier que ce rapport intitulé «A distress call for humanrights - The widening gap in migrant protection in the Mediterranean» est l’œuvre de la commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe (Dunja Mijatovic) et qu’à ce titre on ne pouvait continuer à détourner plus longtemps le regard des drames qui se déroulent, depuis déjà de trop longues années, en Méditerranée. D’autre part, et cela me permet de faire la transition vers la question suivante, le Conseil de l’Europe est une institution vouée à la défense de la démocratie libérale et des droits de l’Homme en Europe. A ce titre, il a bien fallu poursuive et approfondir le travail entamé après la si mal nommée «crise migratoire» de 2015 sur les droits des migrants et des réfugiés en Europe. C’est à ce titre que le rapport apparaît comme nécessaire dans ses critiques et ses recommandations et légitime quant à son champ d’application, à savoir l’Europe.
Les conclusions et les recommandations du Conseil de l'Europe ont-elles une chance d'être prises en compte par l'UE ?
Sur le plan strictement institutionnel, la réponse est négative dans la mesure où, même s’il y avait un lien institutionnel et donc possiblement hiérarchique, les recommandations du Conseil de l’Europe n’ont aucune valeur juridique contraignante vis-à-vis de ses Etats membres et encore moins vis-à-vis de l’UE. En revanche, elles peuvent avoir un poids moral dont l’UE, en tant qu’institution émettrice de normes juridiques et de pratiques extrêmement défavorables aux migrants et réfugiés traversant la Méditerranée, ne peut continuer à faire comme si de rien n’était. De ce point de vue, oui, le rapport peut influencer la pratique de l’UE dans le traitement des migrants et réfugiés en Méditerranée. Mais uniquement en raison de ce poids moral et aucunement en raison d’un quelconque lien institutionnel même si les 27 Etats membres de l’UE sont tous également membres du Conseil de l’Europe.
Sur le plan purement institutionnel, quels sont la place et le poids du Conseil dans l'architecture institutionnelle européenne ?
Le Conseil de l’Europe est l’une des toutes premières institutions que les Européens se sont données au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Elle est distincte de l’UE et des autres institutions que celle-ci a générées. Créé par le traité de Londres du 5 mai 1949, signé par dix Etats (Belgique, Danemark, France, Irlande,Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède), le Conseil de l’Europe se compose des ministres des Affaires étrangères des 47 Etats membres qu’il compte actuellement. Souvent, confusion est faite entre Conseil de l’Europe et Conseil européen qui, lui, est une institution propre à l’UE, réunissant les chefs d’Etat et de gouvernement des 27 Etats membres, tous également membres du Conseil de l’Europe. Le Conseil de l’Europe initie des conventions à destination de ses Etats membres qui peuvent les signer et les ratifier ou non. En revanche, le Conseil européen, parfois en partage avec le Parlement européen, édicte des actes (règlements et directives) qui s’imposent aux Etats membres. Vu sous cet angle, le Conseil de l’Europe n’a pas vocation à s’insérer dans l’architecture institutionnelle européenne réduite à l’UE. En revanche, ce Conseil a un poids moral important notamment quant au devenir des droits de l’Homme en Europe,sachant, par exemple, que la première convention qu’il a élaborée dès 1950 c’est la Convention européenne des droits de l’Homme entrée en vigueur en 1953.
L'UE prend-elle au sérieux les drames qui se déroulent à ses frontières ? Et qu’en est-il de l'opinion publique européenne ?
Depuis les années 1980, l’UE ne cesse d’être en prise avec les organisations de défense des droits des migrants qui dénoncent ses politiques migratoires successives. La décennie en cours a vu se cristalliser les critiques autour du Règlement Dublin et de ses effets délétères. ONG spécialisées dans la défense des migrants et Etats membres les plus exposés à l’arrivée de migrants ont revendiqué l’abandon, côté ONG, ou la réforme profonde du système, côté Etats. A l’intérieur-même de ces Etats, on distingue le groupe dit de Višegrad totalement réfractaire à toute forme d’accueil de migrants, le groupe des Etats situés aux frontières extérieures de l’UE qui demande une plus juste répartition des efforts et celui des Etats relativement moins exposés qui a fini par accepter de militer juste pour un rééquilibrage des solidarités européennes. D’autre part, les opinions publiques nationales sont de plus en plus traversées par les idées xénophobes et racistes et s’accommodent mal de l’arrivée de migrants présentée comme des flux sans fin. Dans le même temps, et c’est le paradoxe de la situation, les opinions européennes, dans leur quasi-totalité, sont partagées entre, d’un côté, une forme prononcée d’humanisme qui les pousse à considérer l’accueil des migrants comme un devoir de solidarité et d’hospitalité et, de l’autre, un sentiment de « trop plein » justifiant le principe d’un « accueil de qualité » plutôt qu’un « accueil de quantité ». Le sentiment de la nécessaire fermeture des frontières, servi par la pandémie de Covid 19, transforme assez facilement au sein de pans entiers des peuples européens «l’accueil de qualité» en volonté de pas d’accueil du tout. Les entrepreneurs politiques, au spectre de plus en plus large, s’engouffrent dans la brèche qu’ils n’ont cessé d’élargir. En plus, le dernier scandale en date, provoqué par le rôle contraire aux droits de l’Homme joué par l’Agence Frontex se traduisant par la non-assistance à quantité de migrants en Méditerranée, voire par leur refoulement en mer purement et simplement, a obligé l’UE à modifier sa politique pour rester sur une ligne de crête, essayant de ménager la chèvre et le choux. C’est ainsi que l’on doit comprendre la raison d’être du nouveau «pacte pour la migration et l’asile» qui doit remplacer, sans vraiment l’abolir, le règlement Dublin. Ce «pacte» met l’accent sur l’instauration d’un contrôle plus efficace aux frontières, sur la surveillance des frontières extérieures assise sur des accords avec les pays de transit et d’origine créant une corrélation entre nombre de visas accordés au pays et migration et enfin sur la mise en place d’un mécanisme de solidarité permanent et efficace, entre les 27 Etats membres. Présenté le 23 septembre 2020, ce «pacte», selon l’avis de nombreuses ONG, vise à empêcher la plupart des migrants du Sud d'accéder au territoire européen. En revanche, pour les partis populistes d’extrême droite, ce «pacte» facilitera, s’il entre en vigueur, la «submersion» du territoire européen par les migrants. Le groupe de Višegrad y reste, bien entendu, globalement opposé ne voulant accueillir aucun migrant. On reste donc dans la lignée de la politique migratoire européenne antérieure, principalement sécuritaire. En Méditerranée, l’amélioration vers laquelle l’UE se dirige, c’est de rendre plus efficace la collaboration avec les Etats du versant sud…y compris avec un Etat failli comme la Libye.


























