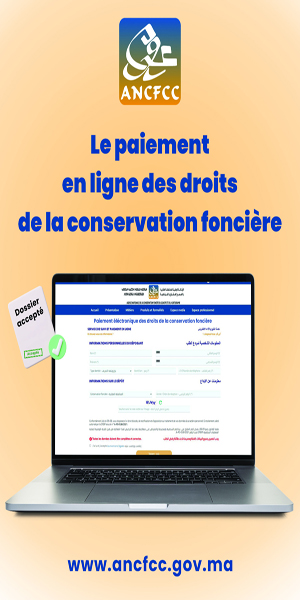Autres articles
-
Deux écrivains marocains sur la liste restreinte de la 20ème édition du Prix Cheikh Zayed du livre
-
Marrakech à l’heure de la 4e édition du Festival du livre africain
-
Présentation de l'ouvrage "Les Vertus immorales" de Kebir Mustapha Ammi
-
Rencontre littéraire autour du livre "A la découverte de l'Islam et des musulmans: L'abécédaire"
À l’initiative du Laboratoire de recherche « Sciences du langage, Art, Littérature, Éducation et Culture »,un vif hommage a été rendu à l’écrivain Abderrahim Kamal le 13 novembre 2025 à l’École Normale Supérieure de Meknès.Le débat avec l’auteur a donné lieu à des échanges riches et passionnants.
Coordonnée par les professeurs Mohamed Semlali, Abdelouahed Hajji et Omar Benjelloun, cette journée d’étude a réuni des universitaires marocains, des écrivains et des étudiants.
Les participants ont analysé l’œuvre de Abderrahim Kamal (notamment sa trilogie composée de Tkoulia, l’attente (Sagacita 2020 ; réédition Marsam 2025), Peaux et ocres (Marsam 2021) et Naufrages dans le désert (Marsam 2023)) sous différentes facettes montrant son originalité thématique, éthique et esthétique.
Le public a également bénéficié d’une conférence de l’auteur portant sur son rapport à la littérature et à l’Histoire, l’écriture du corps, le moi et l’Autre. Procédant comme un lexicographe, l’auteur adéfini, de son point de vue des termes-clés tels que « langage », « écriture », « émotion » et « Histoire ».
Dans sa trilogie, le romancier développe une véritable esthétique de l’engagement. Comme l’écrit l’auteur lui-même, « ce qu’il faut, c’est des mots qui cassent d’autres mots, comme la pierre casse la pierre. » (Tkoulia, l’attente).
Sous cet angle de vue les romans de A. Kamal cristallisent une forme de littérature militante qui sort des sentiers du folklore et de l’exotisme. Ils reproblématisent des situations historiques à l’arrière-fond existentiel, et éveillent l’esprit du lecteur vis-à-vis de l’Histoire.Le retour au passé vise à réhabiliter tout un pan de l’histoire marocaine.
Rappelons que Abderrahim Kamal est professeur de littérature française et francophone à l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès. Il a formé plusieurs générations de chercheurs et de professeurs, marocains et étrangers. Il a publié de nombreux articles et ouvrages sur la littérature française et francophone, ainsi que sur les arts plastiques au Maroc. Parmi ses ouvrages de critique littéraire, on peut citer, entre autres, La photographie selon Roland Barthes (1998), Le voir simonien. Esthétique et poétique de Claude Simon (2001), Lire le visible, Roland Barthes (2017), Homo copiens (2018).
À ses étudiants, il transmet une passion exigeante pour la littérature. Comme il le confie à son ami et frère de plume Bernoussi Saltani dans un entretien : « Enseigner est une passion et c’est cette passion du savoir et de l’art que j’essaie de communiquer à mes étudiants. »
Pour lui, le savoir est inséparable du savoir-être. Kamal a d’ailleurs souligné, dans sa conférence, l’importance de travailler l’être : « Travailler l’être, c’est mettre sa peau sur la table de travail, sans tomber dans l’égocentrisme ou l’égotisme. […] La finalité est claire : explorer, questionner, repenser ce qu’on a cru comprendre ou avoir compris ; mais aussi : sentir, faire sentir, produire une sensation et une émotion de ce qu’on a assimilé par strates, par procuration, souvent dans la douleur, parfois dans le bonheur d’écrire. »
En effet, l’écriture de l’Histoire chez Kamal ne s’embourbe pas dans les enjeux idéologiques simplistes propres à l’historiographie, mais fait appel à une poétique de la composition/décomposition. Il fait sien la belle formule de Balzac: « Le roman est l’histoire privée des peuples ». Le romancier puise ainsi dans les archives du passé pour les retravailler dans un espace de fiction. Un tel agencement procure un plaisir littéraire où la fabula se mêle à l’Histoire, dans le but de préserver la mémoire historique tout en donnant à lire une œuvre littéraire qui révèle la complexité de l’humain. De ce point de vue, son œuvre est subversive ; le romancier jette sur l’Histoire un « regard lucide, triste, pensif et qui essaie de pénétrer vers l’essentiel. » (Kundera, Une rencontre, 29). Que se révèle-t-il d’essentiel quand tous les rêves de l’homme se sont évaporés ? L’œuvre de Kamal apporte une réponse : « Tkoulia ». Il s’agit d’unsentiment d’ennui, d’amertume et d’attente ayant préoccupé l’esprit de toute une génération. Un tel sentiment provoque un penchant pour la folie et la colère.
Abderrahim Kamal s’exprime, en effet, avec une verve colérique dans ses romans aux résonances historiques et politiques. Il repense l’irréductible singularité de cette époque marquée par la violence et la terreur. Il s’agit de retracer le destin d’une génération confrontée à une crise politique majeure, conduisant à un naufrage du pays et des corps. Chez lui, le corps est la mémoire secrète de la violence sociale, historique et politique.
Cette nouvelle édition d’Une œuvre, un écrivain perpétue une culture de la reconnaissance et de la gratitude envers les écrivains et les chercheurs qui ont œuvré – et œuvrent encore – à l’épanouissement des idées et de la culture. C’est aussi un hommage à Abderrahim Kamal, l’écrivain, l’universitaire et l’homme.
Par Abdelouahed Hajji
Université Moulay Ismaïl de Meknès
Coordonnée par les professeurs Mohamed Semlali, Abdelouahed Hajji et Omar Benjelloun, cette journée d’étude a réuni des universitaires marocains, des écrivains et des étudiants.
Les participants ont analysé l’œuvre de Abderrahim Kamal (notamment sa trilogie composée de Tkoulia, l’attente (Sagacita 2020 ; réédition Marsam 2025), Peaux et ocres (Marsam 2021) et Naufrages dans le désert (Marsam 2023)) sous différentes facettes montrant son originalité thématique, éthique et esthétique.
Le public a également bénéficié d’une conférence de l’auteur portant sur son rapport à la littérature et à l’Histoire, l’écriture du corps, le moi et l’Autre. Procédant comme un lexicographe, l’auteur adéfini, de son point de vue des termes-clés tels que « langage », « écriture », « émotion » et « Histoire ».
Dans sa trilogie, le romancier développe une véritable esthétique de l’engagement. Comme l’écrit l’auteur lui-même, « ce qu’il faut, c’est des mots qui cassent d’autres mots, comme la pierre casse la pierre. » (Tkoulia, l’attente).
Sous cet angle de vue les romans de A. Kamal cristallisent une forme de littérature militante qui sort des sentiers du folklore et de l’exotisme. Ils reproblématisent des situations historiques à l’arrière-fond existentiel, et éveillent l’esprit du lecteur vis-à-vis de l’Histoire.Le retour au passé vise à réhabiliter tout un pan de l’histoire marocaine.
Rappelons que Abderrahim Kamal est professeur de littérature française et francophone à l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès. Il a formé plusieurs générations de chercheurs et de professeurs, marocains et étrangers. Il a publié de nombreux articles et ouvrages sur la littérature française et francophone, ainsi que sur les arts plastiques au Maroc. Parmi ses ouvrages de critique littéraire, on peut citer, entre autres, La photographie selon Roland Barthes (1998), Le voir simonien. Esthétique et poétique de Claude Simon (2001), Lire le visible, Roland Barthes (2017), Homo copiens (2018).
À ses étudiants, il transmet une passion exigeante pour la littérature. Comme il le confie à son ami et frère de plume Bernoussi Saltani dans un entretien : « Enseigner est une passion et c’est cette passion du savoir et de l’art que j’essaie de communiquer à mes étudiants. »
Pour lui, le savoir est inséparable du savoir-être. Kamal a d’ailleurs souligné, dans sa conférence, l’importance de travailler l’être : « Travailler l’être, c’est mettre sa peau sur la table de travail, sans tomber dans l’égocentrisme ou l’égotisme. […] La finalité est claire : explorer, questionner, repenser ce qu’on a cru comprendre ou avoir compris ; mais aussi : sentir, faire sentir, produire une sensation et une émotion de ce qu’on a assimilé par strates, par procuration, souvent dans la douleur, parfois dans le bonheur d’écrire. »
En effet, l’écriture de l’Histoire chez Kamal ne s’embourbe pas dans les enjeux idéologiques simplistes propres à l’historiographie, mais fait appel à une poétique de la composition/décomposition. Il fait sien la belle formule de Balzac: « Le roman est l’histoire privée des peuples ». Le romancier puise ainsi dans les archives du passé pour les retravailler dans un espace de fiction. Un tel agencement procure un plaisir littéraire où la fabula se mêle à l’Histoire, dans le but de préserver la mémoire historique tout en donnant à lire une œuvre littéraire qui révèle la complexité de l’humain. De ce point de vue, son œuvre est subversive ; le romancier jette sur l’Histoire un « regard lucide, triste, pensif et qui essaie de pénétrer vers l’essentiel. » (Kundera, Une rencontre, 29). Que se révèle-t-il d’essentiel quand tous les rêves de l’homme se sont évaporés ? L’œuvre de Kamal apporte une réponse : « Tkoulia ». Il s’agit d’unsentiment d’ennui, d’amertume et d’attente ayant préoccupé l’esprit de toute une génération. Un tel sentiment provoque un penchant pour la folie et la colère.
Abderrahim Kamal s’exprime, en effet, avec une verve colérique dans ses romans aux résonances historiques et politiques. Il repense l’irréductible singularité de cette époque marquée par la violence et la terreur. Il s’agit de retracer le destin d’une génération confrontée à une crise politique majeure, conduisant à un naufrage du pays et des corps. Chez lui, le corps est la mémoire secrète de la violence sociale, historique et politique.
Cette nouvelle édition d’Une œuvre, un écrivain perpétue une culture de la reconnaissance et de la gratitude envers les écrivains et les chercheurs qui ont œuvré – et œuvrent encore – à l’épanouissement des idées et de la culture. C’est aussi un hommage à Abderrahim Kamal, l’écrivain, l’universitaire et l’homme.
Par Abdelouahed Hajji
Université Moulay Ismaïl de Meknès













 Deux écrivains marocains sur la liste restreinte de la 20ème édition du Prix Cheikh Zayed du livre
Deux écrivains marocains sur la liste restreinte de la 20ème édition du Prix Cheikh Zayed du livre