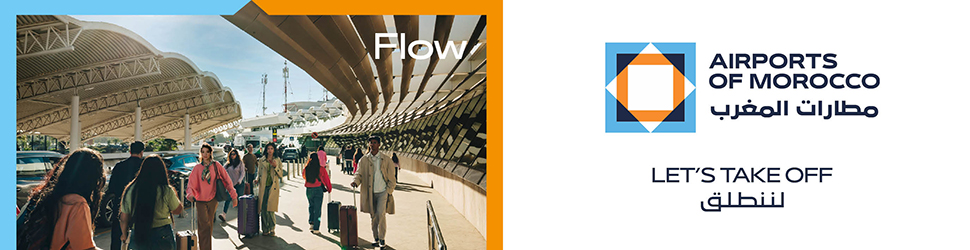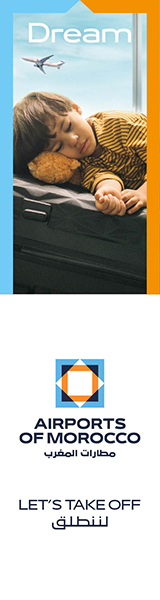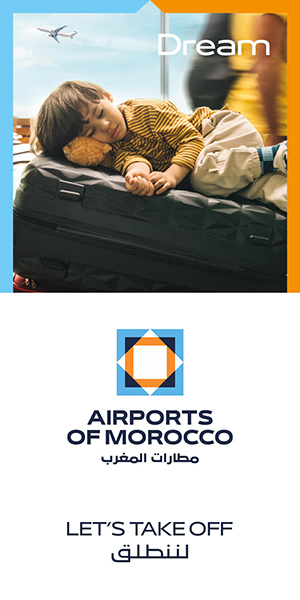-
La France ne reçoit pas de leçons de la réaction internationale, en référence à Rome et Washington
-
Industrie européenne : Bruxelles retarde son projet de relance du «made in Europe»
-
80% des nouveaux emplois créés depuis 2024 occupés par des immigrés
-
Trump augmente sa nouvelle taxe douanière à 15% après le revers infligé par la Cour suprême
La dispute dure depuis des années. Avant même le début des discussions dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh, sur la mer Rouge, le ministre égyptien de l'Eau et de l'Irrigation, Mohammed Nasreddin Allam, a prévenu que son pays entendait garder sa part de 55,5 milliards de mètres cubes d'eau par an, soit plus de la moitié du début du Nil. Le Caire exige en outre de disposer d'un droit de veto sur tout nouveau projet d'irrigation émanant des neuf autres Etats, lesquels ont refusé une telle clause. L'Egypte s'accroche à un accord conclu en 1929 avec la Grande-Bretagne au nom des colonies que la couronne anglaise possédait alors en Afrique de l'Est, et à un autre conclu en 1959 avec le Soudan qui fixait son quota actuel des eaux du fleuve.
L'Egypte, avec ses 80 millions d'habitants, affirme qu'en maintenant ce quota, la part par tête tombera à environ 630 m3 en 2025, contre 1.213 en 1990.
Les huit autres pays de l'Initiative du bassin du Nil (NBI) demandent un partage plus équitable. La conclusion d'un accord-cadre ouvrirait la voie à l'établissement d'une commission permanente du bassin du Nil chargée de veiller à l'attribution des ressources en eau.
La NBI comprend le Burundi, la République démocratique du Congo, l'Egypte, l'Erythrée, l'Ethiopie, le Kenya, le Rwanda, le Soudan, la Tanzanie et l'Ouganda.