Dans le deuxième chapitre de son ouvrage Ce que nous voyons, ce qui nous regarde ((Minuit, 1992), Georges Didi-Huberman essaye de comprendre ce qui se passe quand nous voyons l’objet «tombeau», à titre d’exemple, la dalle funéraire de l’abbé Isarn, seconde moitié du XIe siècle.
Une fois nos yeux sont face à cette oeuvre-d’art, nous ne sommes plus une seule personne, dans la mesure où nous nous trouvons dans une situation délicate qui « ouvre notre expérience en deux ». Devant la dalle et les inscriptions funéraires qu’elle porte, ce que nous voyons, c’est, d’une part, un volume évident, une masse de pierre, se dotant d’une forme, d’une géométrie organisée, calculée, d’autre part, il y a ce qui nous regarde, et, contrairement à ce que nous voyons, ce qui nous regarde, cette fois-ci, n’est pas évident, car il s’agit là d’«une espèce d’évidement », inévitable, me rappelant que je suis éphémère, voué à la perte, à la finitude, tant et si bien que le tombeau que je vois porte en lui un corps qui, bien qu’il soit inactif, inerte, mort, me regarde.
Le tombeau, me regardant « jusqu’au tréfonds », me trouble et ma vue avec.
Car je ne le vois plus sereinement, mais il m’indique que tôt ou tard je perdrai mon corps, ou je l’ai déjà perdu, puisqu’il ressemble à celui qu’il porte déjà dans ses entrailles. Le tombeau annonce ma défaite et me dit que je ne le verrai plus dans le futur : « Devant le tombeau, je tombe ainsi moi-même, je tombe dans l’angoisse (…) C’est l’angoisse de regarder au fond-au lieu-de ce qui me regarde, l’angoisse d’être livré à la question de savoir (en fait : de ne pas savoir) ce que devient mon propre corps, entre sa capacité à faire volume et sa capacité à s’offrir au vide, à s’ouvrir ».
Que faire donc face à cette scission ressentie devant le tombeau ?
Peut-être sombrons-nous dans la mélancolie, qui est une forme de lucidité.
Sans doute suturons-nous l’angoisse, que nous éprouvons devant le tombeau, laquelle suture ne serait qu’un refoulement, nous faisant croire combler le vide.
Devant une telle situation, il est à noter qu’à son origine, dans les gènes, il y a une forme de peur et de dénégation du plein, c’est-à-dire que ce que nous voyons en tant que volume, le tombeau, « est plein d’un être semblable à nous, mais mort, et à ce titre plein d’une angoisse qui nous chuchote notre propre destin ». On peut davantage remarquer qu’il y a dans cette attitude une seconde horreur, elle se nomme cette fois-ci la « dénégation du vide», elle se traduit par une volonté de ne pas chercher à savoir ce qu’il y a dedans, dans le fond, du tombeau, mais de se contenter de sa formalité et de son aspect extérieur.
«Une volonté d’en rester à tout prix à ce que nous voyons, pour ignorer que ce volume-là n’est pas indifférent et simplement convexe, puisqu’il est creux, évidé, puisqu’il fait réceptacle (et concavité) à un corps lui-même cave, s’évidant de toute sa substance ».
De ce double déni, Didi-Huberman en est venu ainsi à nous faire constater que l’expérience du voir semble être un « exercice de la tautologie ». Devant le tombeau, je vois une surface plane, un forme d’expression, sans substance, un simple parallélépipède, et c’est tout, néanmoins, cette « vérité plate » n’en est pas moins avancée comme cachant autre chose, une autre vérité, qui est là-dessous, quelque chose de redoutable. Or, l’homme de la tautologie, comme dit Didi-Huberman, passera outre à la face cachée de l’objet au profit de sa surface, et il fera fi de sa temporalité, du travail du temps et de la mémoire, bref, il négligera son aura. L’homme de la tautologie est l’homme de l’indifférence. Satisfait de ce qui est visible, indifférent à l’invisible :
«Le résultat ultime de cette indifférence, de cette parade en forme de satisfaction, fera donc de la tautologie une manière de cynisme : « Ce que je vois, c’est ce que je vois, et le reste, je m’en balance ».
Face à cette tautologie si accablante, face à l’angoisse que nous ressentons devant la tombe, il y a la possibilité de dépasser et ce que nous voyons et ce qui nous regarde, car on peut y avoir accès par l’imagination et le rêve.
Rêver en supposant qu’une vie meilleure sera ailleurs, où « le corps y sera rêvé comme restant beau et bien fait, plein de substance et plein de vie ».
Par là, l’expérience du voir devient un exercice de la croyance. A cette étape là, le symbolique arrive à vaincre le matériel, et l’on assiste à une victoire du langage sur le regard, du céleste sur le terrestre, autrement dit, curieusement, ce que nous voyons s’efface au bénéfice de ce à quoi nous croyons : « c’est l’affirmation, figée en dogme, qu’il n’y a là ni un volume seulement, ni un pur processus d’évidement, mais «quelque chose d’Autre» qui fait revivre tout cela et lui donne un sens, téléologique et métaphysique». Ici, le volume, tangible, incarnant une horreur du vide et du plein, est dépassé par un au-delà, dès lors que le triste volume s’éclipse par un invisible à prévoir.
L’image et sa production tisse une relation étroite avec la croyance, tel est le cas de la religion chrétienne, par exemple, où le modèle en reste le christ qui, par le simple fait d’être ressuscité, déserte son tombeau et donne matière à la croyance. L’art chrétien s’inscrit amplement dans cette optique du moment que la production des images de tombeaux sont vidés de leur corps et par conséquent de leur contenu angoissant (voir “Femmes au tombeau, détail de la Résurrection vers 1438-1450” de Fra Angelico).
L’absence du corps enclenche la présence de la croyance : « Une apparition, de rien, une apparition minimale : quelques indices d’une disparition. Rien à voir, pour croire en tout ».
L’image, chrétienne, a ceci de particulier qu’elle impose la croyance, et ce en transformant le tombeau, plein d’un corps, objet d’angoisse, indiquant la mort prochaine de son observateur, en un objet vide, ressuscité. La tombe, ainsi évidée de son contenu, du corps, se remplit tant de promesses que d’espoirs et de menaces : Paradis et Enfer. En ce sens, la croyance n’échapperait pas à la contradiction, et c’est Dante qui proférera une contreversion au modèle christique. En est témoin la Divine Comédie, en particulier « les chants IX et X de l’Enfer, cercle d’où sortent autant de flammes que de cris poussés par les Hérétiques subissant leur châtiment ».
A partir de là, on le sait, devant la tombe, l’homme de la croyance voit audelà de ce qu’il voit. Dans la mesure où croire rend possible une forme de consolation fantasmatique, le regard se détourne pour voir autre chose dans ce que nous voyons. Tout se présente enfin aux yeux du croyant comme un espoir nécessaire à la continuité de la vie : « un jour-un jour où la notion de jour, comme celle de nuit, aura fait son temps-, nous serons sauvés de cet enfermement désespérant que suggère le volume des tombeaux ». Devant la tombe, c’est le temps qui se réinvente, de même que le lieu. L’ici maintenant devient un ailleurs, une ouverture, une voie possible devant l’impossible (pour un non-croyant, il serait impossible que le corps du défunt sorte de la tombe).
« L’homme de la croyance, conclut Georges Didi-Huberman, préfère vider les tombeaux de leurs chairs pourrissantes, désespérément informes, pour les remplir d’images corporelles sublimes, épurées, faites pour conforter et informer- c’est-à-dire fixer- nos mémoires, nos craintes et nos désirs ».
Najib Allioui
Une fois nos yeux sont face à cette oeuvre-d’art, nous ne sommes plus une seule personne, dans la mesure où nous nous trouvons dans une situation délicate qui « ouvre notre expérience en deux ». Devant la dalle et les inscriptions funéraires qu’elle porte, ce que nous voyons, c’est, d’une part, un volume évident, une masse de pierre, se dotant d’une forme, d’une géométrie organisée, calculée, d’autre part, il y a ce qui nous regarde, et, contrairement à ce que nous voyons, ce qui nous regarde, cette fois-ci, n’est pas évident, car il s’agit là d’«une espèce d’évidement », inévitable, me rappelant que je suis éphémère, voué à la perte, à la finitude, tant et si bien que le tombeau que je vois porte en lui un corps qui, bien qu’il soit inactif, inerte, mort, me regarde.
Le tombeau, me regardant « jusqu’au tréfonds », me trouble et ma vue avec.
Car je ne le vois plus sereinement, mais il m’indique que tôt ou tard je perdrai mon corps, ou je l’ai déjà perdu, puisqu’il ressemble à celui qu’il porte déjà dans ses entrailles. Le tombeau annonce ma défaite et me dit que je ne le verrai plus dans le futur : « Devant le tombeau, je tombe ainsi moi-même, je tombe dans l’angoisse (…) C’est l’angoisse de regarder au fond-au lieu-de ce qui me regarde, l’angoisse d’être livré à la question de savoir (en fait : de ne pas savoir) ce que devient mon propre corps, entre sa capacité à faire volume et sa capacité à s’offrir au vide, à s’ouvrir ».
Que faire donc face à cette scission ressentie devant le tombeau ?
Peut-être sombrons-nous dans la mélancolie, qui est une forme de lucidité.
Sans doute suturons-nous l’angoisse, que nous éprouvons devant le tombeau, laquelle suture ne serait qu’un refoulement, nous faisant croire combler le vide.
Devant une telle situation, il est à noter qu’à son origine, dans les gènes, il y a une forme de peur et de dénégation du plein, c’est-à-dire que ce que nous voyons en tant que volume, le tombeau, « est plein d’un être semblable à nous, mais mort, et à ce titre plein d’une angoisse qui nous chuchote notre propre destin ». On peut davantage remarquer qu’il y a dans cette attitude une seconde horreur, elle se nomme cette fois-ci la « dénégation du vide», elle se traduit par une volonté de ne pas chercher à savoir ce qu’il y a dedans, dans le fond, du tombeau, mais de se contenter de sa formalité et de son aspect extérieur.
«Une volonté d’en rester à tout prix à ce que nous voyons, pour ignorer que ce volume-là n’est pas indifférent et simplement convexe, puisqu’il est creux, évidé, puisqu’il fait réceptacle (et concavité) à un corps lui-même cave, s’évidant de toute sa substance ».
De ce double déni, Didi-Huberman en est venu ainsi à nous faire constater que l’expérience du voir semble être un « exercice de la tautologie ». Devant le tombeau, je vois une surface plane, un forme d’expression, sans substance, un simple parallélépipède, et c’est tout, néanmoins, cette « vérité plate » n’en est pas moins avancée comme cachant autre chose, une autre vérité, qui est là-dessous, quelque chose de redoutable. Or, l’homme de la tautologie, comme dit Didi-Huberman, passera outre à la face cachée de l’objet au profit de sa surface, et il fera fi de sa temporalité, du travail du temps et de la mémoire, bref, il négligera son aura. L’homme de la tautologie est l’homme de l’indifférence. Satisfait de ce qui est visible, indifférent à l’invisible :
«Le résultat ultime de cette indifférence, de cette parade en forme de satisfaction, fera donc de la tautologie une manière de cynisme : « Ce que je vois, c’est ce que je vois, et le reste, je m’en balance ».
Face à cette tautologie si accablante, face à l’angoisse que nous ressentons devant la tombe, il y a la possibilité de dépasser et ce que nous voyons et ce qui nous regarde, car on peut y avoir accès par l’imagination et le rêve.
Rêver en supposant qu’une vie meilleure sera ailleurs, où « le corps y sera rêvé comme restant beau et bien fait, plein de substance et plein de vie ».
Par là, l’expérience du voir devient un exercice de la croyance. A cette étape là, le symbolique arrive à vaincre le matériel, et l’on assiste à une victoire du langage sur le regard, du céleste sur le terrestre, autrement dit, curieusement, ce que nous voyons s’efface au bénéfice de ce à quoi nous croyons : « c’est l’affirmation, figée en dogme, qu’il n’y a là ni un volume seulement, ni un pur processus d’évidement, mais «quelque chose d’Autre» qui fait revivre tout cela et lui donne un sens, téléologique et métaphysique». Ici, le volume, tangible, incarnant une horreur du vide et du plein, est dépassé par un au-delà, dès lors que le triste volume s’éclipse par un invisible à prévoir.
L’image et sa production tisse une relation étroite avec la croyance, tel est le cas de la religion chrétienne, par exemple, où le modèle en reste le christ qui, par le simple fait d’être ressuscité, déserte son tombeau et donne matière à la croyance. L’art chrétien s’inscrit amplement dans cette optique du moment que la production des images de tombeaux sont vidés de leur corps et par conséquent de leur contenu angoissant (voir “Femmes au tombeau, détail de la Résurrection vers 1438-1450” de Fra Angelico).
L’absence du corps enclenche la présence de la croyance : « Une apparition, de rien, une apparition minimale : quelques indices d’une disparition. Rien à voir, pour croire en tout ».
L’image, chrétienne, a ceci de particulier qu’elle impose la croyance, et ce en transformant le tombeau, plein d’un corps, objet d’angoisse, indiquant la mort prochaine de son observateur, en un objet vide, ressuscité. La tombe, ainsi évidée de son contenu, du corps, se remplit tant de promesses que d’espoirs et de menaces : Paradis et Enfer. En ce sens, la croyance n’échapperait pas à la contradiction, et c’est Dante qui proférera une contreversion au modèle christique. En est témoin la Divine Comédie, en particulier « les chants IX et X de l’Enfer, cercle d’où sortent autant de flammes que de cris poussés par les Hérétiques subissant leur châtiment ».
A partir de là, on le sait, devant la tombe, l’homme de la croyance voit audelà de ce qu’il voit. Dans la mesure où croire rend possible une forme de consolation fantasmatique, le regard se détourne pour voir autre chose dans ce que nous voyons. Tout se présente enfin aux yeux du croyant comme un espoir nécessaire à la continuité de la vie : « un jour-un jour où la notion de jour, comme celle de nuit, aura fait son temps-, nous serons sauvés de cet enfermement désespérant que suggère le volume des tombeaux ». Devant la tombe, c’est le temps qui se réinvente, de même que le lieu. L’ici maintenant devient un ailleurs, une ouverture, une voie possible devant l’impossible (pour un non-croyant, il serait impossible que le corps du défunt sorte de la tombe).
« L’homme de la croyance, conclut Georges Didi-Huberman, préfère vider les tombeaux de leurs chairs pourrissantes, désespérément informes, pour les remplir d’images corporelles sublimes, épurées, faites pour conforter et informer- c’est-à-dire fixer- nos mémoires, nos craintes et nos désirs ».
Najib Allioui




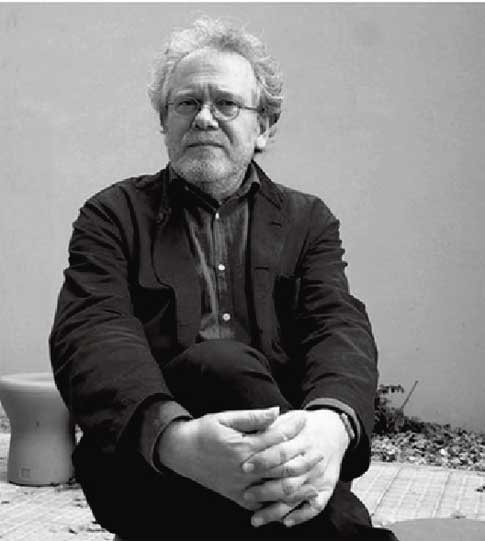
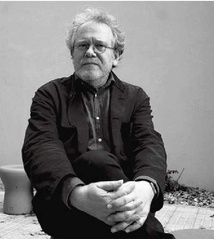








 L’homme avant la légende
L’homme avant la légende


