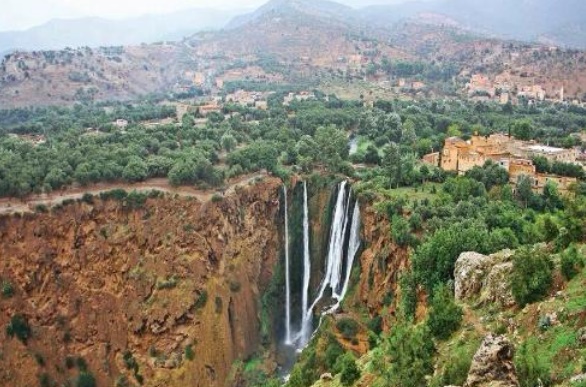-
Des autobus de nouvelle génération renforcent la flotte du transport urbain à Marrakech et sa périphérie
-
Dinos Alive ouvre ses portes à Casablanca, pour un voyage immersif au cœur de la préhistoire
-
TB Fès : Plus de 500 bénéficiaires d’une campagne médicale pluridisciplinaire
-
Salé: atelier national sur la violence basée sur le genre dans les espaces numériques
Cette édition est co-organisée avec le GREPOM/BirdLife Maroc et l’Institut scientifique de Rabat, en partenariat avec le Haut-commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification et la Tour du Valat (France) et avec l’appui du Groupement d’assurance du supérieur.
Ces journées visent à débattre du rôle de la recherche en relation avec les effets des changements climatiques sur les zones humides nord-africaines.
Elles offrent aussi l’occasion pour renforcer un programme ambitieux de recherche et de formation en environnement lancé par l’ESTK, lequel programme s’individualise au Maroc comme initiative pilote d’intégration de la gestion des milieux naturels à la formation universitaire. Selon une note de présentation de cette rencontre, les multiples efforts déployés pour instaurer des pratiques de développement durable durant les trois dernières décennies n’ont pas ralenti la dégradation des écosystèmes, dont la gestion reste dominée par l’approche sectorielle, qui ne considère guère leur vulnérabilité.
Cet échec est en grande partie aggravé par les changements climatiques, enjeu environnemental et sociétal qui occupe depuis plus de vingt ans le devant de la scène à l’échelle mondiale, souligne la même source.
La note relève que les zones humides méditerranéennes, écosystèmes particulièrement vulnérables et riches en faune et flore, payent depuis longtemps le prix des pressions humaines, notamment d’une gestion non intégrée des ressources en eau, où les besoins hydriques écologiques de ces écosystèmes sont totalement négligés.
Dans ce sens, des millions d’oiseaux d’eau paléarctiques qui transitent par cette région sont fréquemment sujets à des disettes, consécutives aux pertes et modifications des zones humides où ils satisfont leurs besoins énergétiques.
La plupart de ces espèces peuvent modifier leur répartition spatio-temporelle pour s’adapter aux sécheresses, mais les chances de cette adaptation sont très réduites actuellement, relèvent les organisateurs, en ajoutant que les modes de développement humains actuels, marqués par des technologies puissantes et des ambitions économiques démesurées, imposent des modifications imprévisibles et irréversibles des mécanismes de résilience des écosystèmes et de leurs ressources.