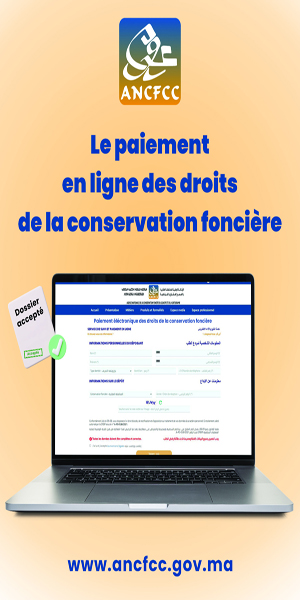Autres articles
Parfois, un film se veut dénonciateur, mais finit par souligner malgré lui ce qu’il cherche à déconstruire. Everybody Loves Touda, dernier opus de Nabil Ayouch, s’inscrit dans cette lignée : une œuvre techniquement bien montée, visuellement maîtrisée, mais idéologiquement épuisée. Sous couvert de féminisme et de célébration de la culture aïta, le film recycle à l’écran les mêmes figures éculées de la femme victime et de l’homme bourreau, sans jamais oser affronter la complexité du réel marocain.
L’histoire de Touda, chanteuse marginalisée, mère célibataire, frappée par la société, rejetée par la religion, violentée par les hommes, n’a rien de nouveau. Le viol, le tabou, la maternité solitaire, la précarité, les femmes qui travaillent la nuit : tous les codes sont là. Coches bien remplies. Et pourtant, tout sonne faux. Car ce n’est pas tant le sujet qui lasse, mais la manière. Le cinéma maghrébin social s’est enfermé depuis des années dans un schéma répétitif où la femme ne peut être qu’un corps martyrisé en quête de lumière, et où les hommes ne sont que des ombres primitives, interchangeables et archaïques. Le père tyran, le client lubrique, le frère impuissant : plus personne ne prend la peine d’écrire des personnages.
Ayouch, pour éviter la comparaison avec Kharboucha (2008, Hamid Zoughi), change le cadre, actualise le ton, mais trébuche sur la même pente : un scénario confus, hésitant, qui cherche à cocher toutes les cases du drame social contemporain. Touda n’a ni l’intensité mythologique de Kharboucha, ni l’efficacité télévisuelle de Salha (2009, Kamal Kamal). C’est un film qui veut dire beaucoup, mais montre peu. Une tentative de fresque sociale qui se perd entre fiction molle et documentaire tiède.
Et que dire du personnage principal ? Nisrin Erradi, malgré son talent et son engagement, ne parvient pas à incarner la puissance charnelle et symbolique d’une vraie cheikha. Le jeu est là, les émotions sont là, mais l’âme manque. Elle pleure, elle résiste, elle chante — mais sans jamais irradier cette force populaire que tout Marocain reconnaît dans les coulisses d’un bar comme Najmat Layle, lieu réel du tournage. Là-bas, ce sont souvent les femmes qui dictent les règles. Ce sont elles qui dirigent, choisissent, manipulent. Ce sont elles les reines de la nuit. Le film refuse cette vérité : il préfère montrer Touda comme une icône sacrificielle, figée dans sa souffrance, incapable de puissance réelle. Un fantasme victimaire plutôt qu’un portrait incarné.
Plus grave encore : le récit bascule parfois dans le didactisme pur. Certaines séquences donnent l’impression de suivre un mode d’emploi : voici comment devenir cheikha. Voici la douleur, voici l’humiliation, voici l’enfant à charge. Tout est à sa place, sauf la vie. Le spectateur marocain, lui, voit clair. Il sent que ce qu’on lui montre est une construction, pas un miroir. Il connaît ces milieux. Il sait que la vérité est bien plus nuancée, plus sale, plus riche. Il sait que le cinéma peut mentir, même quand il prétend dénoncer.
Au final, Everybody Loves Touda n’est ni un hommage, ni un cri, ni un portrait. C’est un exercice de style social qui cherche à émouvoir sans déranger, à dénoncer sans complexifier. Un Zin Li Fik du monde des cheikhates : joli, lisse, et terriblement prévisible. Le problème n’est pas que Touda souffre. Le problème, c’est qu’on ne la laisse jamais être autre chose qu’une femme en souffrance. Et cela, dans le cinéma d’aujourd’hui, ce n’est plus un acte de résistance. C’est une recette.
Par Salaheddine Lalouani
L’histoire de Touda, chanteuse marginalisée, mère célibataire, frappée par la société, rejetée par la religion, violentée par les hommes, n’a rien de nouveau. Le viol, le tabou, la maternité solitaire, la précarité, les femmes qui travaillent la nuit : tous les codes sont là. Coches bien remplies. Et pourtant, tout sonne faux. Car ce n’est pas tant le sujet qui lasse, mais la manière. Le cinéma maghrébin social s’est enfermé depuis des années dans un schéma répétitif où la femme ne peut être qu’un corps martyrisé en quête de lumière, et où les hommes ne sont que des ombres primitives, interchangeables et archaïques. Le père tyran, le client lubrique, le frère impuissant : plus personne ne prend la peine d’écrire des personnages.
Ayouch, pour éviter la comparaison avec Kharboucha (2008, Hamid Zoughi), change le cadre, actualise le ton, mais trébuche sur la même pente : un scénario confus, hésitant, qui cherche à cocher toutes les cases du drame social contemporain. Touda n’a ni l’intensité mythologique de Kharboucha, ni l’efficacité télévisuelle de Salha (2009, Kamal Kamal). C’est un film qui veut dire beaucoup, mais montre peu. Une tentative de fresque sociale qui se perd entre fiction molle et documentaire tiède.
Et que dire du personnage principal ? Nisrin Erradi, malgré son talent et son engagement, ne parvient pas à incarner la puissance charnelle et symbolique d’une vraie cheikha. Le jeu est là, les émotions sont là, mais l’âme manque. Elle pleure, elle résiste, elle chante — mais sans jamais irradier cette force populaire que tout Marocain reconnaît dans les coulisses d’un bar comme Najmat Layle, lieu réel du tournage. Là-bas, ce sont souvent les femmes qui dictent les règles. Ce sont elles qui dirigent, choisissent, manipulent. Ce sont elles les reines de la nuit. Le film refuse cette vérité : il préfère montrer Touda comme une icône sacrificielle, figée dans sa souffrance, incapable de puissance réelle. Un fantasme victimaire plutôt qu’un portrait incarné.
Plus grave encore : le récit bascule parfois dans le didactisme pur. Certaines séquences donnent l’impression de suivre un mode d’emploi : voici comment devenir cheikha. Voici la douleur, voici l’humiliation, voici l’enfant à charge. Tout est à sa place, sauf la vie. Le spectateur marocain, lui, voit clair. Il sent que ce qu’on lui montre est une construction, pas un miroir. Il connaît ces milieux. Il sait que la vérité est bien plus nuancée, plus sale, plus riche. Il sait que le cinéma peut mentir, même quand il prétend dénoncer.
Au final, Everybody Loves Touda n’est ni un hommage, ni un cri, ni un portrait. C’est un exercice de style social qui cherche à émouvoir sans déranger, à dénoncer sans complexifier. Un Zin Li Fik du monde des cheikhates : joli, lisse, et terriblement prévisible. Le problème n’est pas que Touda souffre. Le problème, c’est qu’on ne la laisse jamais être autre chose qu’une femme en souffrance. Et cela, dans le cinéma d’aujourd’hui, ce n’est plus un acte de résistance. C’est une recette.
Par Salaheddine Lalouani














 2026, année foisonnante de sorties cinéma
2026, année foisonnante de sorties cinéma