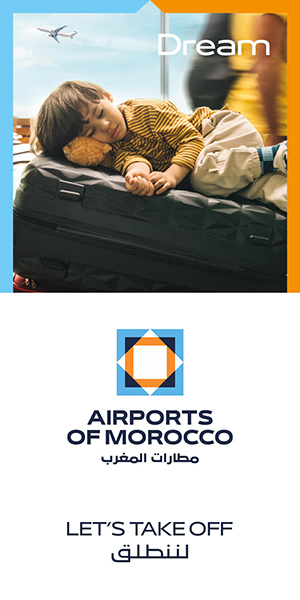Autres articles
-
Le Maroc et l’enjeu de la transformation structurelle du système des droits de l’homme
-
Pourquoi Bank Al-Maghrib tarde-t-elle à baisser son taux directeur ?
-
L’ancrage narratif du changement
-
Edward W. Said: L’intellectuel n’entre pas dans le moule
-
L'intégration est la seule voie possible pour l'Afrique

Le Monde arabe aurait vécu deux autres décennies de stagnation politique. Cependant, il y aurait de la braise sous les cendres. Dans son édition du 25 juillet 2009, l'hebdomadaire britannique The Economist, a publié un rapport spécial sur « le monde des Arabes », composé de plusieurs articles. Les 14 pages de ce rapport donnent une image affligeante de la scène politique arabe à travers une analyse précise, sans complaisance, et avec le recul suffisant; le rapport cherche, néanmoins, les portes de sortie de la stagnation que nous vivons.
L'article ci-dessous, tiré du rapport, est particulièrement intéressant. D'une part, il prend dans plusieurs de ses paragraphes l'exemple marocain. Et d'autre part, il envisage comme seule possibilité d'évolution, l'union des forces de l'opposition. Comment rester aux commandes ? Par la contrainte et un simulacre de démocratie? Un grand nombre de statistiques comparatives blessantes révélées afin de démontrer le retard des Arabes, sont apparues d'abord dans le « Arab Human Development Report 2002 ». Ses conclusions brutes ont nettement influencé la préparation par l'administration Bush du « Middle East Partnership Initiative »[1]. Dans le Monde arabe lui-même, le rapport a eu de la résonance du fait qu'il a été écrit non pas par des technocrates occidentaux, mais par une équipe d'universitaires arabes. Et l'auteur principal a été Nader Fergany, rencontré préalablement lors de la préparation du rapport (spécial de The Economist), reproche aux Américains d'être les « nouveaux Mongols» du Moyen-Orient. Aujourd'hui directeur du Centre Almishkat de recherche et de formation au Caire, M.Fergany ne s'acharne pas moins sur les régimes arabes, qu'il accuse de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour saboter la démocratie et la justice sociale.
Dans la plupart des pays arabes, dit-il, l'ordre politique est oppressif et la démocratie une imposture, un système creux incapable de tenir compte de la vitalité des populations. Le parti dirigeant en Egypte (non, il se corrige lui-même, le « Parti du Dirigeant ») n'a pas de soutien populaire et les "soi-disant partis d'opposition légitimes sont essentiellement des cadavres morts." Malgré quelques variations locales, la plupart des régimes arabes maintiennent leur pouvoir avec des moyens remarquablement similaires. Au sommet du système se trouve soit un seul dirigeant autoritaire, qu'il soit un monarque ou un président, soit un éternel parti au pouvoir ou famille royale.
Le dirigeant est soutenu par un vaste service de moukhabarat (renseignements) qui emploie un vaste réseau d'informateurs. Un diplomate égyptien retraité, s'exprimant anonymement, estime la taille de l'appareil de sécurité intérieure de son propre pays à environ 2 millions de personnes. Un deuxième instrument de contrôle est la bureaucratie gouvernementale. En l'absence de rotation du pouvoir, les pays arabes ont brouillé la distinction entre le dirigeant et l'État. M.Pollack de la Brookings affirme que les administrations publiques asphyxiées par leur gigantisme, fournissent aux régimes le moyen de distribuer des emplois pour absorber les nouveaux diplômés et masquer le niveau de chômage. La taille de ces mastodontes administratifs est stupéfiante.
M.Pollack estime qu'en 2007, la fonction publique égyptienne était forte de 7 millions (d'employés). Et malgré cela, proportionnellement, leur population, les salariés du secteur public des pays producteurs de pétrole du Golfe, sont en nombre supérieur.
Des élections à gogo sans signification. Et pourtant, aussi étrange que cela puisse paraître, l'un des instruments de contrôle les plus efficaces des régimes est le système élaboré de démocratie - ou plutôt, le simulacre de démocratie - qu'ils ont conçu dans le but de canaliser et de contenir la dissidence politique. La plupart des pays arabes ont des parlements et organisent des élections officielles. Ces dernières années, les constitutions nationales ont été sérieusement révisées et re-révisées. Le fait est que les parlements ont peu de pouvoirs et les élections sont truquées pour faire en sorte que le dirigeant ou son parti ne puisse pas être détrôné. Les quelques dites exceptions ne font que confirmer la règle. En mai, le Koweït a fait la une de la presse lorsque pour la première fois de son histoire quatre femmes ont été élues au parlement, une institution véritablement turbulente. Mais la politique du Koweït ne fait que boiter de crise en crise parce que la famille éternellement dirigeante, Al-Sabah, refuse de permettre au parlement de contrôler les membres de la famille et notamment, le Premier ministre. Et quand une telle menace surgit du parlement, l'émir le dissout ou le gouvernement démissionne de lui-même.
Au Liban, l'élection du mois dernier a connu un combat dur et a donné des résultats non truqués. Mais étant donné que le Liban a un système de familles confessionnelles, aucun gouvernement n'obtient le plein contrôle par les urnes. La plus importante force militaire au Liban n'est pas l'armée nationale, mais la milice dirigée par le Hezbollah, qui fait partie de l'opposition. Ainsi, la nette victoire remportée par la coalition pro-occidentale dirigée par Saad Hariri n'empêchera pas le Hezbollah de contrôler une grande partie du pays et d'avoir son mot à dire dans la politique à l'égard d'Israël.
Cela étant dit, M. Fergany est injuste vis-à-vis des partis de l'opposition du Monde arabe quand il les qualifie de «cadavériques». Les Frères musulmans sont une puissante force politique en Egypte, même si elle n'est pas autorisée à participer ouvertement aux élections. Dans le Monde arabe, les personnes membres de l'opposition ont peu d'illusions quant à leur capacité à prendre le pouvoir, mais espèrent au moins influencer le débat sur les marges. Mahmoud Abaza, le chef du Parti libéral égyptien, le Wafd, déclare que ni son organisation, ni le Parti national démocratique au pouvoir n'ont une incidence sur la législation: les lois sont écrites par des techniciens et le travail du parlement est simplement de « cacheter ». Mais il est fier du rôle que le journal de son parti a joué en provoquant le débat sur la réforme politique.
En outre, il y a des pays arabes avec des partis beaucoup plus dynamiques qu'en Égypte. Ainsi le Parti de la justice et du développement (PJD) au Maroc est un mouvement sophistiqué avec un grand nombre d'adhérents et une aspiration à suivre la trajectoire de l'AKP, le parti islamiste modéré qui a eu un grand succès en Turquie. En effet, le Maroc a une longue tradition de multipartisme dans laquelle les partis laïques et religieux (même si certains de ces derniers sont interdits) ont été autorisés à se développer. En Algérie aussi, un riche éventail de partis sérieux est autorisé à se présenter pour des sièges parlementaires. Cependant, la permission d'être un candidat ne doit pas être confondue avec une chance de gagner, et encore moins de gouverner.
Ainsi, malgré l'ancienne tradition de multipartisme au Maroc (...) c'est le Palais qui déterminent la politique du pays. Et en Algérie, au début de cette année, le fait que cinq candidats se soient présentés contre le Président Abdelaziz Bouteflika, ne l'a pas empêché de remporter un troisième mandat avec un invraisemblable 90% des voix. Unissons-nous tous pour craindre l'Islam. Si vous êtes un autocrate et que vous voulez gouverner avec un semblant de démocratie, c'est une aubaine si l'opposition est divisée. Et c'est ce qui se passe dans le monde arabe. Les partis islamistes se tiennent d'un côté de la fracture et les partis laïques de l'autre. En théorie, votre emprise sur le pouvoir serait plus faible s'il y avait un risque que les oppositions laïque et religieuse s'unissent. Mais jusqu'à présent, ils ne l'ont pas fait, et cela sans doute pour une raison insurmontable, à savoir que les partis laïques d'opposition ont plus peur des islamistes qu'ils ne rejettent le régime actuel. En comparaison avec les régimes et les mouvements islamistes, les partis d'opposition laïques sont particulièrement désavantagés. Leur terrible dilemme est analysé dans un livre à paraître («Comment atteindre le pluralisme», Carnegie Middle East Centre) de Amr Hamzawy et Marina Ottaway. Les auteurs soulignent que les régimes ont les moyens de l'Etat d'offrir à leurs sympathisants. Les islamistes peuvent offrir des services sociaux et de charité à travers les mosquées. Alors que les laïcs n'ont pas de tels moyens à offrir. Ils n'ont même plus, à dire vrai, d'armes idéologiques. Les causes qui les ont propulsés vers la gloire sont soit dépassées (indépendance de la domination coloniale) ou discréditées (le panarabisme de Gamal Abdul Nasser ou le baathisme de la Syrie et de l'Irak).
En outre, ayant le choix entre le statu quo et l'incertitude de l'avenir promis par les islamistes, l'instinct de ces partis les pousse à se contenter des diables qu'ils connaissent déjà, quel qu'en soit le coût à travers les urnes. Ainsi, en Egypte, les élections de 2005 ont accordé 20% des sièges du parlement aux Frères musulmans, contre un petit 5% pour les quatre partis d'opposition laïques. Pourtant, si les partis d'opposition laïques sont faibles, leurs rivaux islamistes ne sont pas nécessairement aussi vigoureux qu'il n'y paraît. Dans les années 1970, explique M.Hamzawy, ils ont construit une «machine redoutable » de services sociaux ; fournissant aux nécessiteux l'aide pratique journalière que les différents régimes semblaient incapables de donner. Plus récemment, les partis islamistes se sont retrouvés du « bon côté », lors du renouveau religieux qui a envahi le Monde arabe. Malgré cela, l'avenir est de plus en plus difficile pour les islamistes. Les Arabes ne sont pas moins pieux, mais les citoyens commencent à remettre en question le fait de participer à la politique en soi. Une des raisons est simplement l’essoufflement. L'exclusion des sphères de décisions commence à saper les aspirations même des partis les plus combatifs. Dans des pays comme le Maroc, où les islamistes sont autorisés à participer aux élections, mais jamais à les gagner, les électeurs sont en train de perdre espoir en la capacité du PJD à livrer ne serait-ce qu'une version allégée des réformes qu'il prône, telles qu'un gouvernement plus transparent et plus responsable. Dans la plupart des élections menées dans les pays arabes, le taux de participation fond comme neige. En Égypte et en Jordanie, les Frères musulmans endurent des cycles de répression imprévisibles, et ce en fonction des peurs et des caprices des régimes. Le roi Abdullah de Jordanie a quelquefois permis aux Frères musulmans de siéger au gouvernement, et d'autres fois, il a mené des manoeuvres contre eux, parfois en écrasant les activités sociales sur lesquelles repose une grande partie de leur popularité.
Un autre problème rencontré par les islamistes est qu'ils sont eux aussi en proie à des doutes idéologiques. Le PJD a débattu à l'infini de la signification que devrait avoir le vocable "islamiste". Lors de réunions avec des journalistes occidentaux, ses dirigeants désavouent parfois tout à fait ce concept et se décrivent comme étant des sociaux-démocrates ou des libéraux légèrement pieux. Depuis quelque temps déjà, les Frères musulmans d'Égypte sont partagés sur l'opportunité de s'en tenir au simple slogan familier qui les a si bien servis : «L'Islam est la solution», ou d'élaborer un programme politique plus détaillé, intégrant éventuellement différentes positions potentiellement sujettes à controverse, sur la gestion économique, les droits de la femme et les droits de la minorité chrétienne copte. L'AKP, parti islamiste modéré au pouvoir en Turquie, est perçu par le PJD comme un modèle à imiter, mais accusé par les Frères musulmans d'être « vendu ».
Au-delà de ces incertitudes idéologiques, les islamistes, comparés aux régimes ou aux partis d'opposition laïques, sont entravés par le plafonnement du soutien populaire. Sur la base des récents résultats des élections, M. Hamzawy met ce plafond à environ 20% de l'électorat, avec certains arguments tirés de sondages révélant une tendance à la baisse de la popularité des islamistes, en Jordanie et au Maroc. Afin d'obtenir une majorité, soutient-il, les islamistes ont besoin de former des alliances avec les mouvements laïques.
Mais ils en sont découragés par un mélange d'arrogance et de peur de voir leur message se réduire à une question de foi. Avec les islamistes dédaignant l'opposition laïque et les partis laïques craignant les islamistes, l'opposition dans de nombreux pays arabes s'est mise toute seule hors-jeu. De génération en génération. Avec les opposants politiques dans l'impasse, qu'en est-il d'un changement qui viendrait de l'intérieur des régimes eux-mêmes?
L'espoir était que l'emprise des dirigeants autoritaires se desserre au fur et à mesure que le pouvoir passe d'une génération à l’autre, et que se mettent sur le devant de la scène politique des dirigeants avec un comportement politique plus moderne. Dans certains cas, cela s'est produit.
Le roi du Maroc, Mohammed VI est plus modernisateur que ne l'a été son père, le roi Hassan II. Le roi Abdullah d'Arabie Saoudite, qui a été intronisé en 2005 à l'âge délicat de 80 ans, a accéléré les réformes prudemment initiées à l'époque où il était prince héritier sous le règne de son demi-frère, encore plus âgé, le roi Fahd.
Cette année, une réorganisation administrative a provoqué beaucoup d'émoi à cause de la nomination de Nora Al-Fayez en tant que ministre-adjoint. Il s'agit du plus haut poste à n’avoir jamais été occupé par une femme dans le royaume. Dans d'autres cas, toutefois, le passage de flambeau à une nouvelle génération a surtout été décevant.
La Jordanie ne s'est pas vraiment illustrée par plus de libéralisme que sous le règne du roi Hussein. Lorsque Bashar Assad, médecin de formation qui a suivi ses études à Londres et qui a épousé une compatriote née et élevée en Grande-Bretagne, a pris le pouvoir en 2000 après le long règne de son père, il a été accueilli par certains en Occident comme un réformateur libéral, calé en Internet, promettant une bouffée d'air frais. Mais le «printemps de Damas» a été bref. Au début de l'année 2001, plus de 1000 militants Syriens ont signé une déclaration appelant à la réforme politique et la fin de l'état d'urgence qui est en vigueur depuis 1963 sous le prétexte du conflit avec Israël. Le nouveau président a pris peur et fait arrêter un grand nombre des plus éminents signataires. En 2005, quelques membres courageux ont renouvelé leur demande dans la "Déclaration de Damas".
Cela a conduit à une autre vague de répression. En mars de cette année, le président Assad a laissé entendre que la libéralisation économique en cours en Syrie peut être accompagnée par des changements politiques, comme la création d'une Chambre haute qui donnerait une plus grande place à l'opposition.
Mais tout cela, a-t-il ajouté, se ferait « petit à petit, à notre propre rythme». Le changement de rythme clamé par les dirigeants sera-t-il suffisamment rapide ?
Traduction de:
Nawal & Khaoula LACHGUAR
[1] L'« Initiative de partenariat avec le Moyen-Orient »
L'article ci-dessous, tiré du rapport, est particulièrement intéressant. D'une part, il prend dans plusieurs de ses paragraphes l'exemple marocain. Et d'autre part, il envisage comme seule possibilité d'évolution, l'union des forces de l'opposition. Comment rester aux commandes ? Par la contrainte et un simulacre de démocratie? Un grand nombre de statistiques comparatives blessantes révélées afin de démontrer le retard des Arabes, sont apparues d'abord dans le « Arab Human Development Report 2002 ». Ses conclusions brutes ont nettement influencé la préparation par l'administration Bush du « Middle East Partnership Initiative »[1]. Dans le Monde arabe lui-même, le rapport a eu de la résonance du fait qu'il a été écrit non pas par des technocrates occidentaux, mais par une équipe d'universitaires arabes. Et l'auteur principal a été Nader Fergany, rencontré préalablement lors de la préparation du rapport (spécial de The Economist), reproche aux Américains d'être les « nouveaux Mongols» du Moyen-Orient. Aujourd'hui directeur du Centre Almishkat de recherche et de formation au Caire, M.Fergany ne s'acharne pas moins sur les régimes arabes, qu'il accuse de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour saboter la démocratie et la justice sociale.
Dans la plupart des pays arabes, dit-il, l'ordre politique est oppressif et la démocratie une imposture, un système creux incapable de tenir compte de la vitalité des populations. Le parti dirigeant en Egypte (non, il se corrige lui-même, le « Parti du Dirigeant ») n'a pas de soutien populaire et les "soi-disant partis d'opposition légitimes sont essentiellement des cadavres morts." Malgré quelques variations locales, la plupart des régimes arabes maintiennent leur pouvoir avec des moyens remarquablement similaires. Au sommet du système se trouve soit un seul dirigeant autoritaire, qu'il soit un monarque ou un président, soit un éternel parti au pouvoir ou famille royale.
Le dirigeant est soutenu par un vaste service de moukhabarat (renseignements) qui emploie un vaste réseau d'informateurs. Un diplomate égyptien retraité, s'exprimant anonymement, estime la taille de l'appareil de sécurité intérieure de son propre pays à environ 2 millions de personnes. Un deuxième instrument de contrôle est la bureaucratie gouvernementale. En l'absence de rotation du pouvoir, les pays arabes ont brouillé la distinction entre le dirigeant et l'État. M.Pollack de la Brookings affirme que les administrations publiques asphyxiées par leur gigantisme, fournissent aux régimes le moyen de distribuer des emplois pour absorber les nouveaux diplômés et masquer le niveau de chômage. La taille de ces mastodontes administratifs est stupéfiante.
M.Pollack estime qu'en 2007, la fonction publique égyptienne était forte de 7 millions (d'employés). Et malgré cela, proportionnellement, leur population, les salariés du secteur public des pays producteurs de pétrole du Golfe, sont en nombre supérieur.
Des élections à gogo sans signification. Et pourtant, aussi étrange que cela puisse paraître, l'un des instruments de contrôle les plus efficaces des régimes est le système élaboré de démocratie - ou plutôt, le simulacre de démocratie - qu'ils ont conçu dans le but de canaliser et de contenir la dissidence politique. La plupart des pays arabes ont des parlements et organisent des élections officielles. Ces dernières années, les constitutions nationales ont été sérieusement révisées et re-révisées. Le fait est que les parlements ont peu de pouvoirs et les élections sont truquées pour faire en sorte que le dirigeant ou son parti ne puisse pas être détrôné. Les quelques dites exceptions ne font que confirmer la règle. En mai, le Koweït a fait la une de la presse lorsque pour la première fois de son histoire quatre femmes ont été élues au parlement, une institution véritablement turbulente. Mais la politique du Koweït ne fait que boiter de crise en crise parce que la famille éternellement dirigeante, Al-Sabah, refuse de permettre au parlement de contrôler les membres de la famille et notamment, le Premier ministre. Et quand une telle menace surgit du parlement, l'émir le dissout ou le gouvernement démissionne de lui-même.
Au Liban, l'élection du mois dernier a connu un combat dur et a donné des résultats non truqués. Mais étant donné que le Liban a un système de familles confessionnelles, aucun gouvernement n'obtient le plein contrôle par les urnes. La plus importante force militaire au Liban n'est pas l'armée nationale, mais la milice dirigée par le Hezbollah, qui fait partie de l'opposition. Ainsi, la nette victoire remportée par la coalition pro-occidentale dirigée par Saad Hariri n'empêchera pas le Hezbollah de contrôler une grande partie du pays et d'avoir son mot à dire dans la politique à l'égard d'Israël.
Cela étant dit, M. Fergany est injuste vis-à-vis des partis de l'opposition du Monde arabe quand il les qualifie de «cadavériques». Les Frères musulmans sont une puissante force politique en Egypte, même si elle n'est pas autorisée à participer ouvertement aux élections. Dans le Monde arabe, les personnes membres de l'opposition ont peu d'illusions quant à leur capacité à prendre le pouvoir, mais espèrent au moins influencer le débat sur les marges. Mahmoud Abaza, le chef du Parti libéral égyptien, le Wafd, déclare que ni son organisation, ni le Parti national démocratique au pouvoir n'ont une incidence sur la législation: les lois sont écrites par des techniciens et le travail du parlement est simplement de « cacheter ». Mais il est fier du rôle que le journal de son parti a joué en provoquant le débat sur la réforme politique.
En outre, il y a des pays arabes avec des partis beaucoup plus dynamiques qu'en Égypte. Ainsi le Parti de la justice et du développement (PJD) au Maroc est un mouvement sophistiqué avec un grand nombre d'adhérents et une aspiration à suivre la trajectoire de l'AKP, le parti islamiste modéré qui a eu un grand succès en Turquie. En effet, le Maroc a une longue tradition de multipartisme dans laquelle les partis laïques et religieux (même si certains de ces derniers sont interdits) ont été autorisés à se développer. En Algérie aussi, un riche éventail de partis sérieux est autorisé à se présenter pour des sièges parlementaires. Cependant, la permission d'être un candidat ne doit pas être confondue avec une chance de gagner, et encore moins de gouverner.
Ainsi, malgré l'ancienne tradition de multipartisme au Maroc (...) c'est le Palais qui déterminent la politique du pays. Et en Algérie, au début de cette année, le fait que cinq candidats se soient présentés contre le Président Abdelaziz Bouteflika, ne l'a pas empêché de remporter un troisième mandat avec un invraisemblable 90% des voix. Unissons-nous tous pour craindre l'Islam. Si vous êtes un autocrate et que vous voulez gouverner avec un semblant de démocratie, c'est une aubaine si l'opposition est divisée. Et c'est ce qui se passe dans le monde arabe. Les partis islamistes se tiennent d'un côté de la fracture et les partis laïques de l'autre. En théorie, votre emprise sur le pouvoir serait plus faible s'il y avait un risque que les oppositions laïque et religieuse s'unissent. Mais jusqu'à présent, ils ne l'ont pas fait, et cela sans doute pour une raison insurmontable, à savoir que les partis laïques d'opposition ont plus peur des islamistes qu'ils ne rejettent le régime actuel. En comparaison avec les régimes et les mouvements islamistes, les partis d'opposition laïques sont particulièrement désavantagés. Leur terrible dilemme est analysé dans un livre à paraître («Comment atteindre le pluralisme», Carnegie Middle East Centre) de Amr Hamzawy et Marina Ottaway. Les auteurs soulignent que les régimes ont les moyens de l'Etat d'offrir à leurs sympathisants. Les islamistes peuvent offrir des services sociaux et de charité à travers les mosquées. Alors que les laïcs n'ont pas de tels moyens à offrir. Ils n'ont même plus, à dire vrai, d'armes idéologiques. Les causes qui les ont propulsés vers la gloire sont soit dépassées (indépendance de la domination coloniale) ou discréditées (le panarabisme de Gamal Abdul Nasser ou le baathisme de la Syrie et de l'Irak).
En outre, ayant le choix entre le statu quo et l'incertitude de l'avenir promis par les islamistes, l'instinct de ces partis les pousse à se contenter des diables qu'ils connaissent déjà, quel qu'en soit le coût à travers les urnes. Ainsi, en Egypte, les élections de 2005 ont accordé 20% des sièges du parlement aux Frères musulmans, contre un petit 5% pour les quatre partis d'opposition laïques. Pourtant, si les partis d'opposition laïques sont faibles, leurs rivaux islamistes ne sont pas nécessairement aussi vigoureux qu'il n'y paraît. Dans les années 1970, explique M.Hamzawy, ils ont construit une «machine redoutable » de services sociaux ; fournissant aux nécessiteux l'aide pratique journalière que les différents régimes semblaient incapables de donner. Plus récemment, les partis islamistes se sont retrouvés du « bon côté », lors du renouveau religieux qui a envahi le Monde arabe. Malgré cela, l'avenir est de plus en plus difficile pour les islamistes. Les Arabes ne sont pas moins pieux, mais les citoyens commencent à remettre en question le fait de participer à la politique en soi. Une des raisons est simplement l’essoufflement. L'exclusion des sphères de décisions commence à saper les aspirations même des partis les plus combatifs. Dans des pays comme le Maroc, où les islamistes sont autorisés à participer aux élections, mais jamais à les gagner, les électeurs sont en train de perdre espoir en la capacité du PJD à livrer ne serait-ce qu'une version allégée des réformes qu'il prône, telles qu'un gouvernement plus transparent et plus responsable. Dans la plupart des élections menées dans les pays arabes, le taux de participation fond comme neige. En Égypte et en Jordanie, les Frères musulmans endurent des cycles de répression imprévisibles, et ce en fonction des peurs et des caprices des régimes. Le roi Abdullah de Jordanie a quelquefois permis aux Frères musulmans de siéger au gouvernement, et d'autres fois, il a mené des manoeuvres contre eux, parfois en écrasant les activités sociales sur lesquelles repose une grande partie de leur popularité.
Un autre problème rencontré par les islamistes est qu'ils sont eux aussi en proie à des doutes idéologiques. Le PJD a débattu à l'infini de la signification que devrait avoir le vocable "islamiste". Lors de réunions avec des journalistes occidentaux, ses dirigeants désavouent parfois tout à fait ce concept et se décrivent comme étant des sociaux-démocrates ou des libéraux légèrement pieux. Depuis quelque temps déjà, les Frères musulmans d'Égypte sont partagés sur l'opportunité de s'en tenir au simple slogan familier qui les a si bien servis : «L'Islam est la solution», ou d'élaborer un programme politique plus détaillé, intégrant éventuellement différentes positions potentiellement sujettes à controverse, sur la gestion économique, les droits de la femme et les droits de la minorité chrétienne copte. L'AKP, parti islamiste modéré au pouvoir en Turquie, est perçu par le PJD comme un modèle à imiter, mais accusé par les Frères musulmans d'être « vendu ».
Au-delà de ces incertitudes idéologiques, les islamistes, comparés aux régimes ou aux partis d'opposition laïques, sont entravés par le plafonnement du soutien populaire. Sur la base des récents résultats des élections, M. Hamzawy met ce plafond à environ 20% de l'électorat, avec certains arguments tirés de sondages révélant une tendance à la baisse de la popularité des islamistes, en Jordanie et au Maroc. Afin d'obtenir une majorité, soutient-il, les islamistes ont besoin de former des alliances avec les mouvements laïques.
Mais ils en sont découragés par un mélange d'arrogance et de peur de voir leur message se réduire à une question de foi. Avec les islamistes dédaignant l'opposition laïque et les partis laïques craignant les islamistes, l'opposition dans de nombreux pays arabes s'est mise toute seule hors-jeu. De génération en génération. Avec les opposants politiques dans l'impasse, qu'en est-il d'un changement qui viendrait de l'intérieur des régimes eux-mêmes?
L'espoir était que l'emprise des dirigeants autoritaires se desserre au fur et à mesure que le pouvoir passe d'une génération à l’autre, et que se mettent sur le devant de la scène politique des dirigeants avec un comportement politique plus moderne. Dans certains cas, cela s'est produit.
Le roi du Maroc, Mohammed VI est plus modernisateur que ne l'a été son père, le roi Hassan II. Le roi Abdullah d'Arabie Saoudite, qui a été intronisé en 2005 à l'âge délicat de 80 ans, a accéléré les réformes prudemment initiées à l'époque où il était prince héritier sous le règne de son demi-frère, encore plus âgé, le roi Fahd.
Cette année, une réorganisation administrative a provoqué beaucoup d'émoi à cause de la nomination de Nora Al-Fayez en tant que ministre-adjoint. Il s'agit du plus haut poste à n’avoir jamais été occupé par une femme dans le royaume. Dans d'autres cas, toutefois, le passage de flambeau à une nouvelle génération a surtout été décevant.
La Jordanie ne s'est pas vraiment illustrée par plus de libéralisme que sous le règne du roi Hussein. Lorsque Bashar Assad, médecin de formation qui a suivi ses études à Londres et qui a épousé une compatriote née et élevée en Grande-Bretagne, a pris le pouvoir en 2000 après le long règne de son père, il a été accueilli par certains en Occident comme un réformateur libéral, calé en Internet, promettant une bouffée d'air frais. Mais le «printemps de Damas» a été bref. Au début de l'année 2001, plus de 1000 militants Syriens ont signé une déclaration appelant à la réforme politique et la fin de l'état d'urgence qui est en vigueur depuis 1963 sous le prétexte du conflit avec Israël. Le nouveau président a pris peur et fait arrêter un grand nombre des plus éminents signataires. En 2005, quelques membres courageux ont renouvelé leur demande dans la "Déclaration de Damas".
Cela a conduit à une autre vague de répression. En mars de cette année, le président Assad a laissé entendre que la libéralisation économique en cours en Syrie peut être accompagnée par des changements politiques, comme la création d'une Chambre haute qui donnerait une plus grande place à l'opposition.
Mais tout cela, a-t-il ajouté, se ferait « petit à petit, à notre propre rythme». Le changement de rythme clamé par les dirigeants sera-t-il suffisamment rapide ?
Traduction de:
Nawal & Khaoula LACHGUAR
[1] L'« Initiative de partenariat avec le Moyen-Orient »




















 Le Maroc et l’enjeu de la transformation structurelle du système des droits de l’homme
Le Maroc et l’enjeu de la transformation structurelle du système des droits de l’homme