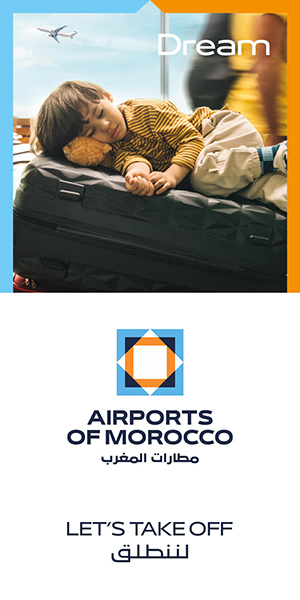Autres articles
-
Classements, brevets et partenariats: l’USMS s’impose sur la scène académique
-
Emmanuel Dupuy : Les Etats-Unis pourraient donc être les véritables facilitateurs d’un rapprochement entre l’Algérie et le Maroc, davantage que la France
-
Moussaoui Ajlaoui : Le grand événement survenu le 31 octobre 2025 rappelle celui du 16 octobre 1975, deux moments charnières séparés par 50 ans d’évolutions
-
Abdelaziz Oussaih : Le Festival Iminig a démontré que la passion, lorsqu’elle s’accompagne de conviction, peut transformer les difficultés en opportunités et les obstacles en passerelles vers l’innovation
-
Dr Adil Ouzzane : La téléchirurgie est une réponse concrète à l’iné gale répartition des compétences médicales
Leïla Slimani est une écrivaine franco-marocaine. Elle est considérée aujourd'hui comme l'un des meilleurs romanciers de l'arène française. Elle a remporté le Prix Goncourt en 2016 pour son roman «Chanson douce», ainsi que le prix littéraire de la Mamounia pour son roman « Dans le jardin l’ogre ». Le président français, Emmanuel Macron, l'a nommée ambassadrice de la langue française. Cet entretien a eu lieu pendant la période de confinement. Leïla Slimani devait effectuer une grande tournée au Maroc pour présenter son nouveau roman «Le Pays des autres» publié aux éditions Gallimard et qui est le premier volet d'une trilogie familiale. Ce livre est inspiré de l'histoire de sa grand-mère française mariée à un soldat marocain engagé dans l'armée française pendant la Grande Guerre. Le roman évoque l'époque coloniale et celle où le Maroc a accédé à l'indépendance en 1956. L'auteure met en exergue les conditions des femmes à cette époque. Lors de cette interview avec Libé, elle évoque l'isolement social, l'écriture et la relation avec son Maroc, d'autant plus qu'elle appartient à une famille mixte maroco-française, et que la question de l'identité et de l'appartenance au Maroc est un sujet qui revêt pour elle une importance particulière. D’autant plus qu’aujourd'hui, certains éditorialistes au Maroc attaquent la double nationalité, un sujet qui concerne plusieurs millions de Marocains nés en Europe. Le Maroc, en tant que pays multiculturel et ouvert sur le monde, devait rester loin de ce genre de polémique et de ce «patriotisme» vide de sens.
Libé : Comment vivez-vous ce confinement collectif ?
Leïla Slimani : Le confinement est un état assez naturel pour moi. Quand je travaille sur un roman, il m’arrive de ne pas sortir pendant des jours, de ne parler à personne. Mais la grande différence avec ce que nous vivons aujourd’hui, c’est que mon confinement littéraire est volontaire. Je peux l’arrêter quand je veux. L’autre différence, c’est que je suis inquiète pour mes amis, ma famille et de manière générale, pour tous les gens qui m’entourent en cette période de crise sanitaire.
Ce confinement pourrait-il devenir le sujet d’un prochain roman ?
e ne crois pas. Bien que ce soit un moment historique et fascinant, il faudra beaucoup de temps avant que cela puisse devenir le sujet d’un grand roman. Regardez le 11 septembre 2001 : Ça a été un événement spectaculaire, énorme et très peu de grands romans en sont sortis. La littérature demande un long moment de digestion.
Vous êtes de retour en librairie avec votre nouveau roman «Le pays des autres». Est-ce un livre sur le Maroc à l’époque coloniale ?
Je ne sais pas, c’est plutôt l’histoire d’une famille dans un Maroc colonisé. Je ne voulais pas écrire un roman historique au sens classique du terme. Je voulais vraiment que les personnages et leurs sentiments restent au centre de ce livre et qu’on aborde les évènements historiques à travers leur regard, leur point de vue.
Dans votre roman, il y a deux France, une France coloniale qui traite les indigènes comme des esclaves et une France qui pousse à s’épanouir via l’école et la culture. Est-ce que cela reflète les deux faces du colonialisme ?
En tout cas, il me semble que ces deux faces existaient. C’est ce que m’ont raconté mes parents et mes grands-parents. Mon père a été insulté, moqué mais il a aussi croisé des gens, français, qui l’ont aidé et lui ont transmis des choses positives. Notamment une vieille dame de la médina de Fès qui lui a légué tous ses livres. Je ne crois pas au bien et au mal, chaque période comme chaque être humain renferme de la lumière et des zones d’ombre. C’est le rôle du romancier de raconter ça.
Vous abordez également la question de l’engagement des soldats africains dans l’armée française pendant la guerre. Peut-on dire que l’histoire de ces hommes a été occultée par la République ?
Absolument ! Je pense que la France n’a pas suffisamment œuvré à leur témoigner de la reconnaissance. Et il faut aussi que les artistes, les cinéastes et les écrivains se saisissent de cette histoire pour rendre hommage au courage de ces hommes extraordinaires sans lesquels l’Europe ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui.
Vous parlez du combat pour l’indépendance en évoquant les incendies dans les villages. Très peu de romans racontent l’indépendance du Maroc alors qu’ils sont très nombreux à traiter de l’indépendance de l’Algérie. Quel regard portez-vous sur la décolonisation du Maroc ?
Comme beaucoup de gens, je pensais que tout s’était passé de manière plutôt pacifique. J’avais en tête les images de la guerre d’Algérie et j’occultais les violences qui avaient eu lieu au Maroc. Et puis la relation du Maroc et de la France, encore aujourd’hui, est moins emplie de colère et d’amertume que chez nos voisins algériens. C’est peut-être aussi ce qui fausse notre regard sur la décolonisation. Mais là encore, en interrogeant les témoins de l’époque, en me plongeant dans les documents d’archives, j’ai découvert avec beaucoup d’intérêt les flambées de violence de la pré-indépendance.
Vous avez déclaré que vous avez trouvé l’inspiration pour l’écriture de ce dernier roman dans le cinéma. Comment cela se manifeste-t-il ?
Tous mes livres trouvent une part de leur inspiration dans le cinéma. Je travaille à partir de l’œil, de la vision. Je construis chaque chapitre comme une scène de cinéma. J’aime imaginer le décor, les costumes, la façon dont les personnages se déplacent et s’adressent les uns aux autres. Quelle est la part d’autobiographie dans ce récit ? Je me suis inspirée du couple de mes grands-parents : ma grandmère alsacienne et mon grand-père spahi dans l’armée française. J’avais envie, c’est vrai, de savoir d’où je viens, pourquoi je suis ce que je suis. Souvent, au Maroc, on m’a dit que je n’étais pas « une vraie Marocaine », parce que j’ai grandi dans un microcosme bourgeois, parce que je suis francophone, parce que je viens d’une famille métissée où différentes religions ont coexisté entre elles. Avant, j’en avais honte, honte de ne pas être une bonne Marocaine, de ne pas parler l’arabe aussi bien que je le voudrais. Mais je me dis maintenant que je suis Marocaine, un point c’est tout et que je suis aussi le produit de l’histoire de ce pays avec les mélanges et les douleurs que cela comporte.
Dans votre roman, personne n’est dans son pays. Chacun semble vivre dans le pays des autres. Est-ce que vous ressentez parfois votre double origine ?
Je le ressens tout le temps. Mais je dois dire que c’est plus douloureux au Maroc qu’en France. En France, si quelqu’un me dit de manière un peu raciste que je ne suis pas Française, ça me met en colère mais ça ne me blesse pas. Au Maroc, ça me blesse parce que je ne comprends pas ce rejet. Je crois qu’il n’y a pas une seule façon d’être Marocain et c’est d’ailleurs ce qui fait la beauté et la complexité de ce pays. Le Maroc, c’est aussi mon père, mort et enterré à Rabat. Quand on me refuse ma marocanité, on m’arrache un peu à mon père et cela me blesse beaucoup.
En tant que femme, Mathilde est-elle en avance sur son temps ? Nous savons que le poids des traditions empêche l’épanouissement de la femme. Le Maroc a-t-il beaucoup changé ?
Je crois que Mathilde est, en effet, une femme à part, en France comme au Maroc. Elle est libre, combattive, elle a un fort désir d’aventures. Elle n’est pas conformiste. Oui, la vie des femmes au Maroc a beaucoup changé par rapport à la génération de ma grand-mère par exemple. Mais il reste beaucoup à faire, surtout au niveau des mentalités, pour que les femmes marocaines puissent vivre, dans l’espace public et dans l’espace privé, sur un pied d’égalité avec les hommes.
A-t-elle finalement choisi cette vie au Maroc ou a-t-elle plutôt fui la vie banale qui l’attendait en Alsace ?
Je crois qu’au départ, elle a surtout voulu fuir une vie trop banale et trop bourgeoise dans son Alsace natale. Elle pensait sans doute arriver dans « les colonies » comme on disait à l’époque et vivre une vie beaucoup plus excitante. Mais finalement, il me semble qu’elle s’attache beaucoup à ce pays, à cette terre et surtout à ses habitants. Elle va devenir, au fil des autres livres, de plus en plus marocaine.
Mathilde semble insensible à la souffrance de sa fille à l’école. Pourquoi selon vous ? Est-ce parce qu’elle met l’éducation, la culture au-dessus de tout ou est-ce qu’elle a du mal à reconnaître comme sienne cette enfant métisse ?
D’abord, je crois qu’il faut se remettre dans le contexte des années 50 : à l’époque, on ne considérait pas les enfants comme aujourd’hui. Les parents étaient moins préoccupés par le bienêtre des enfants, par la psychologie. Mathilde considère que sa fille a de la chance d’avoir une bonne éducation surtout dans un pays où beaucoup d’enfants n’ont pas cette chance.
Il est difficile de trouver le héros ou l’héroïne de votre roman. Mathilde, Aïcha ou le père Amine pour qui être l’époux d’une Française n’a pas dû être facile. Comment avez-vous pensé les personnages ?
Chaque personnage a sa personnalité propre, ses aspirations personnelles et ce qui m’intéressait, c’était de confronter ces désirs individuels à la fois aux autres personnages et à la situation historique dans laquelle ils se trouvent. Selma, par exemple, aspire à la liberté et à l’amour. Elle vit dans un conflit permanent avec ses frères et sa mère. Elle continue de croire que l’époque dans laquelle elle vit va lui permettre de réaliser son désir d’émancipation, d’indépendance. Mais les évènements vont lui prouver qu’il y a encore beaucoup d’obstacles à surmonter pour les jeunes filles qui rêvent de liberté.
Il n’y a pas de personnage véritablement heureux dans ce récit. Est-ce volontaire de votre part ?
Je ne sais pas si des gens véritablement heureux existent. On est heureux par moments, puis malheureux à d’autres. La vie, comme je le disais, n’est jamais toute noire ou toute blanche. Nos existences sont faites de nuances de gris où se mêlent les joies et les peines, où nous agissons de manière juste puis injuste. C’est ce que j’aime dans la littérature : elle est une manière de dire cette profonde ambiguïté qui est au cœur de toute existence.
Libé : Comment vivez-vous ce confinement collectif ?
Leïla Slimani : Le confinement est un état assez naturel pour moi. Quand je travaille sur un roman, il m’arrive de ne pas sortir pendant des jours, de ne parler à personne. Mais la grande différence avec ce que nous vivons aujourd’hui, c’est que mon confinement littéraire est volontaire. Je peux l’arrêter quand je veux. L’autre différence, c’est que je suis inquiète pour mes amis, ma famille et de manière générale, pour tous les gens qui m’entourent en cette période de crise sanitaire.
Ce confinement pourrait-il devenir le sujet d’un prochain roman ?
e ne crois pas. Bien que ce soit un moment historique et fascinant, il faudra beaucoup de temps avant que cela puisse devenir le sujet d’un grand roman. Regardez le 11 septembre 2001 : Ça a été un événement spectaculaire, énorme et très peu de grands romans en sont sortis. La littérature demande un long moment de digestion.
Vous êtes de retour en librairie avec votre nouveau roman «Le pays des autres». Est-ce un livre sur le Maroc à l’époque coloniale ?
Je ne sais pas, c’est plutôt l’histoire d’une famille dans un Maroc colonisé. Je ne voulais pas écrire un roman historique au sens classique du terme. Je voulais vraiment que les personnages et leurs sentiments restent au centre de ce livre et qu’on aborde les évènements historiques à travers leur regard, leur point de vue.
Dans votre roman, il y a deux France, une France coloniale qui traite les indigènes comme des esclaves et une France qui pousse à s’épanouir via l’école et la culture. Est-ce que cela reflète les deux faces du colonialisme ?
En tout cas, il me semble que ces deux faces existaient. C’est ce que m’ont raconté mes parents et mes grands-parents. Mon père a été insulté, moqué mais il a aussi croisé des gens, français, qui l’ont aidé et lui ont transmis des choses positives. Notamment une vieille dame de la médina de Fès qui lui a légué tous ses livres. Je ne crois pas au bien et au mal, chaque période comme chaque être humain renferme de la lumière et des zones d’ombre. C’est le rôle du romancier de raconter ça.
Vous abordez également la question de l’engagement des soldats africains dans l’armée française pendant la guerre. Peut-on dire que l’histoire de ces hommes a été occultée par la République ?
Absolument ! Je pense que la France n’a pas suffisamment œuvré à leur témoigner de la reconnaissance. Et il faut aussi que les artistes, les cinéastes et les écrivains se saisissent de cette histoire pour rendre hommage au courage de ces hommes extraordinaires sans lesquels l’Europe ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui.
Vous parlez du combat pour l’indépendance en évoquant les incendies dans les villages. Très peu de romans racontent l’indépendance du Maroc alors qu’ils sont très nombreux à traiter de l’indépendance de l’Algérie. Quel regard portez-vous sur la décolonisation du Maroc ?
Comme beaucoup de gens, je pensais que tout s’était passé de manière plutôt pacifique. J’avais en tête les images de la guerre d’Algérie et j’occultais les violences qui avaient eu lieu au Maroc. Et puis la relation du Maroc et de la France, encore aujourd’hui, est moins emplie de colère et d’amertume que chez nos voisins algériens. C’est peut-être aussi ce qui fausse notre regard sur la décolonisation. Mais là encore, en interrogeant les témoins de l’époque, en me plongeant dans les documents d’archives, j’ai découvert avec beaucoup d’intérêt les flambées de violence de la pré-indépendance.
Vous avez déclaré que vous avez trouvé l’inspiration pour l’écriture de ce dernier roman dans le cinéma. Comment cela se manifeste-t-il ?
Tous mes livres trouvent une part de leur inspiration dans le cinéma. Je travaille à partir de l’œil, de la vision. Je construis chaque chapitre comme une scène de cinéma. J’aime imaginer le décor, les costumes, la façon dont les personnages se déplacent et s’adressent les uns aux autres. Quelle est la part d’autobiographie dans ce récit ? Je me suis inspirée du couple de mes grands-parents : ma grandmère alsacienne et mon grand-père spahi dans l’armée française. J’avais envie, c’est vrai, de savoir d’où je viens, pourquoi je suis ce que je suis. Souvent, au Maroc, on m’a dit que je n’étais pas « une vraie Marocaine », parce que j’ai grandi dans un microcosme bourgeois, parce que je suis francophone, parce que je viens d’une famille métissée où différentes religions ont coexisté entre elles. Avant, j’en avais honte, honte de ne pas être une bonne Marocaine, de ne pas parler l’arabe aussi bien que je le voudrais. Mais je me dis maintenant que je suis Marocaine, un point c’est tout et que je suis aussi le produit de l’histoire de ce pays avec les mélanges et les douleurs que cela comporte.
Dans votre roman, personne n’est dans son pays. Chacun semble vivre dans le pays des autres. Est-ce que vous ressentez parfois votre double origine ?
Je le ressens tout le temps. Mais je dois dire que c’est plus douloureux au Maroc qu’en France. En France, si quelqu’un me dit de manière un peu raciste que je ne suis pas Française, ça me met en colère mais ça ne me blesse pas. Au Maroc, ça me blesse parce que je ne comprends pas ce rejet. Je crois qu’il n’y a pas une seule façon d’être Marocain et c’est d’ailleurs ce qui fait la beauté et la complexité de ce pays. Le Maroc, c’est aussi mon père, mort et enterré à Rabat. Quand on me refuse ma marocanité, on m’arrache un peu à mon père et cela me blesse beaucoup.
En tant que femme, Mathilde est-elle en avance sur son temps ? Nous savons que le poids des traditions empêche l’épanouissement de la femme. Le Maroc a-t-il beaucoup changé ?
Je crois que Mathilde est, en effet, une femme à part, en France comme au Maroc. Elle est libre, combattive, elle a un fort désir d’aventures. Elle n’est pas conformiste. Oui, la vie des femmes au Maroc a beaucoup changé par rapport à la génération de ma grand-mère par exemple. Mais il reste beaucoup à faire, surtout au niveau des mentalités, pour que les femmes marocaines puissent vivre, dans l’espace public et dans l’espace privé, sur un pied d’égalité avec les hommes.
A-t-elle finalement choisi cette vie au Maroc ou a-t-elle plutôt fui la vie banale qui l’attendait en Alsace ?
Je crois qu’au départ, elle a surtout voulu fuir une vie trop banale et trop bourgeoise dans son Alsace natale. Elle pensait sans doute arriver dans « les colonies » comme on disait à l’époque et vivre une vie beaucoup plus excitante. Mais finalement, il me semble qu’elle s’attache beaucoup à ce pays, à cette terre et surtout à ses habitants. Elle va devenir, au fil des autres livres, de plus en plus marocaine.
Mathilde semble insensible à la souffrance de sa fille à l’école. Pourquoi selon vous ? Est-ce parce qu’elle met l’éducation, la culture au-dessus de tout ou est-ce qu’elle a du mal à reconnaître comme sienne cette enfant métisse ?
D’abord, je crois qu’il faut se remettre dans le contexte des années 50 : à l’époque, on ne considérait pas les enfants comme aujourd’hui. Les parents étaient moins préoccupés par le bienêtre des enfants, par la psychologie. Mathilde considère que sa fille a de la chance d’avoir une bonne éducation surtout dans un pays où beaucoup d’enfants n’ont pas cette chance.
Il est difficile de trouver le héros ou l’héroïne de votre roman. Mathilde, Aïcha ou le père Amine pour qui être l’époux d’une Française n’a pas dû être facile. Comment avez-vous pensé les personnages ?
Chaque personnage a sa personnalité propre, ses aspirations personnelles et ce qui m’intéressait, c’était de confronter ces désirs individuels à la fois aux autres personnages et à la situation historique dans laquelle ils se trouvent. Selma, par exemple, aspire à la liberté et à l’amour. Elle vit dans un conflit permanent avec ses frères et sa mère. Elle continue de croire que l’époque dans laquelle elle vit va lui permettre de réaliser son désir d’émancipation, d’indépendance. Mais les évènements vont lui prouver qu’il y a encore beaucoup d’obstacles à surmonter pour les jeunes filles qui rêvent de liberté.
Il n’y a pas de personnage véritablement heureux dans ce récit. Est-ce volontaire de votre part ?
Je ne sais pas si des gens véritablement heureux existent. On est heureux par moments, puis malheureux à d’autres. La vie, comme je le disais, n’est jamais toute noire ou toute blanche. Nos existences sont faites de nuances de gris où se mêlent les joies et les peines, où nous agissons de manière juste puis injuste. C’est ce que j’aime dans la littérature : elle est une manière de dire cette profonde ambiguïté qui est au cœur de toute existence.
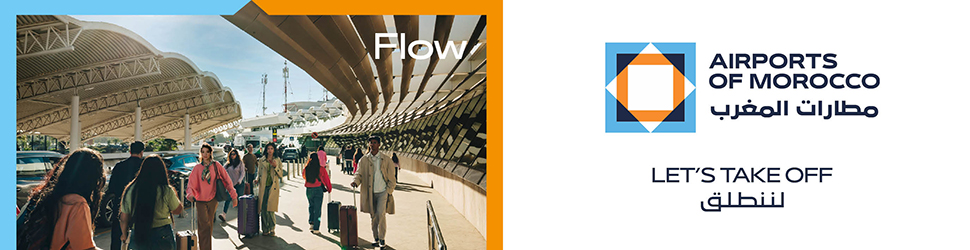




















 Classements, brevets et partenariats: l’USMS s’impose sur la scène académique
Classements, brevets et partenariats: l’USMS s’impose sur la scène académique