Autres articles
-
Classements, brevets et partenariats: l’USMS s’impose sur la scène académique
-
Emmanuel Dupuy : Les Etats-Unis pourraient donc être les véritables facilitateurs d’un rapprochement entre l’Algérie et le Maroc, davantage que la France
-
Moussaoui Ajlaoui : Le grand événement survenu le 31 octobre 2025 rappelle celui du 16 octobre 1975, deux moments charnières séparés par 50 ans d’évolutions
-
Abdelaziz Oussaih : Le Festival Iminig a démontré que la passion, lorsqu’elle s’accompagne de conviction, peut transformer les difficultés en opportunités et les obstacles en passerelles vers l’innovation
-
Dr Adil Ouzzane : La téléchirurgie est une réponse concrète à l’iné gale répartition des compétences médicales
Le privilège de l’écrivain est de nous entraîner là où il veut et où nous ne serions pas allés sans lui. Et comme le lecteur disposant d’outils de recherche, il va d’aventure en aventure pour pouvoir solliciter les plis et replis du texte afin d’en dégager un sens et en déguster sa part du plaisir qu’il lui offre.
Nos écrivains sont là pour nous ouvrir, à nous lecteurs, quelques pistes de lecture et même des outils, un avant-goût de ces jouissances amenant la satisfaction, voire la satiété, étant leurs complices.
Libé : Comment avez-vous pu et su adopter l’écriture, cette monture indomptable et si capricieuse, et l’adapter à vos exigences?
Bouthaïna Azami : Je n’ai jamais vu l’écriture comme une monture indomptable à apprivoiser, mais comme une complice. Plus que cela, une sorte de double salvateur qui parle pour moi, se fait écho des mouvements intérieurs les plus imperceptibles, voix des silences les plus inextricables, les plus étouffés, les plus étouffants. Et l’on se remet à respirer quand on croyait suffoquer en plongeant au plus profond de soi pour laisser voie à ces bruissements de mémoires, d’émotions, que seule l’écriture a le pouvoir de révéler. Non pas même de raconter, de dire. Mais de donner à ressentir. Dans leurs tremblées, leurs palpitations, leur souffle montant ou manquant, leur musicalité, le frissonnement de leur cheminement dans la chair, dans le sang. C’est une sorte de corps-à-corps où l’écriture devient une sorte de travail d’excavation et de déchiffrement de l’enfoui, l'intangible, dont elle se met à l’écoute dans un processus de lecture de l’intangible avant la libération du verbe. Et c’est là que la magie opère: dans l’accord parfait de l’intangible et des mots agencés pour l’incarner et le rendre perceptible.
Quel a été votre premier texte, nouvelle, roman ou poème, que vous avez publié, que vous avez soumis au lecteur ?
Mon premier roman publié est «La Mémoire des temps», paru aux éditions L’Harmattan en 1998. Etrangement, dès les premières phrases, j’ai senti que j’irais plus loin, cette fois, que les éternelles feuilles volantes que je laissais derrière moi depuis l’enfance. J’ai d’ailleurs écrit ce roman sans penser un instant à une éventuelle publication. Une fois achevé, il a traîné sur mon bureau pendant plusieurs années, et ce sont des amis qui m’ont encouragée à le soumettre à une maison d'édition. Dans ce roman, je me suis immergée dans le personnage d’une petite fille vendue, par ses parents, à une famille bourgeoise. Chaque nuit, pendant plus d’une année, je me suis mise dans la peau de cette enfant. Le livre s’ouvre sur un cri: celui de la petite fille arrachée aux bras de sa mère. Puis le silence s’abat comme un couperet. A partir de là, l’écriture va travailler à sonder ce silence, saisissant, qui s’est emparé de l’enfant à un moment, violent, de rupture annihilante où elle devient spectatrice d’un monde qui la tient à l’écart, qui ne l’accueille pas.
La langue française a su se soumettre à votre volonté, à vos volontés, à vos exigences. Quels sont alors les écrivains ayant influencé votre manière de regarder les faits et de les écrire? En est-il de même pour vous?
Dès mon plus jeune âge, je me suis passionnée pour la littérature. Comme je fréquentais l’école française, j’ai baigné dans les grandes œuvres littéraires et poétiques françaises. Le théâtre, le grand roman classique du XIXème siècle, les grands poètes, parmi lesquels Baudelaire, aujourd’hui encore, tient une place particulière. Se servir de la langue pour extraire, par l’acte poétique, de la beauté (les fleurs) du «mal», tel est certainement tout le pouvoir et le sens de l’écriture. Puis il y a eu un tournant, au début de l’adolescence, lorsque j’ai découvert, à travers les espaces francophones, toute une littérature à laquelle nous n’étions pas sensibilisés à l’école. Cela a véritablement été un événement. J’ai découvert une autre langue française, déterritorialisée, parfois malmenée pour, par exemple, chez Mohamed Khaïr-Eddine, mettre en scène la déroute identitaire dans la déroute de la langue (comme dans Agadir, où «je» devient tour à tour «tu» et «il», comme si «je» n’était plus qu’une expérience radicale de l’altérité). De même, Césaire, en se servant de la métaphore du volcan, hurle à la face du monde ce que le monde ne nomme pas, ce que les livres d’Histoire taisent et les consciences ignorent, les «malheurs de ceux qui n’ont point de bouche» et dont un décret n’aura pas suffi à abolir les souffrances qui, des siècles plus tard, persistent dans une contemporanéité dont «le ventre est encore fécond d’où est sorti la bête immonde». Il se sert ainsi de la métaphore du volcan pour jouer une transfiguration, secouer l’univers et le reconfigurer pour redonner à l’homme une identité, une dignité par delà le déni, dans le creux même de la blessure, dans le grondement de tonnerre de ce mot «Nègre» qu’il va investir d’une «valeur de force, une valeur force».
Les exemples sont nombreux. Tout cela pour dire que les écrivains dont j’aime à me nourrir simulent l’espace d’une violence, inscrite dans le texte, pour une autre vérité qui dérange, malmène le monde tel qu’il nous est donné à voir; l’espace d’une transfiguration, aussi, où le démantèlement de la langue, l’éclatement de l’espace et la déroute du temps participent d’une «œuvre de libération», comme dirait Edouard Glissant.
Pour Proust, la vie écrite est plus intense que la vie vécue. Qu’en pensez-vous ?
Etrangement, elles débordent l’une sur l’autre. J’ai écrit, comme plusieurs autres de mes romans, La Mémoire des temps pendant la nuit. Mais, durant la journée, les personnages continuaient de me suivre, de vivre en moi. En quelque sorte, le livre continuait de s’écrire. Par ailleurs, oui, il y a certes une intensité propre à la vie écrite du fait, peut-être, que nous y vivons plusieurs vies en un laps de temps relativement court et que, de plus, comme le dit Deleuze, la littérature est « une sorte de double du monde capable d’en recueillir la violence et l’excès ».
«Ecrire, c’est le double plaisir de raconter et de se raconter une histoire, et c’est aussi le plaisir d’écrire, qui est inexplicable», dit Françoise Sagan dans un entretien accordé au Magazine littéraire en juin 1969
Quand je commence un livre, je pars d’une émotion que je file avant de la laisser m’emporter dans une histoire que je n’ai pas préméditée. Je ne sais jamais vraiment où l’écriture va m’entraîner lorsque j’écris les premiers mots. Il y a, bien sûr, le plaisir d’écrire qui se fait ressentir dès la première phrase, lorsque celle-ci parvient à rendre, de façon presque miraculeuse, les mouvements, le souffle, les frémissements, les sursauts de cette émotion première, inaugurale. Et il y a le plaisir tout aussi magique de l’aventure romanesque, lorsqu’on découvre le livre pendant qu’il s’écrit comme en dehors de soi, qu’il nous emmène là où l’on ne pensait pas consciemment aller.
Le critique et écrivain Milan Kundera dit que le roman est le lieu de l’ambiguïté, le lieu où les choses ne sont jamais tranchées de manière définitive, le lieu de l’absence d’une morale manichéenne. Est-ce que cela pourrait s’appliquer à vos romans ?
Je serais tentée de répondre par l’affirmative, car il n’y a jamais eu de place, en effet, pour une morale manichéenne dans mes romans qui peuvent tous être décrits comme autant de parcours initiatiques. On y suit des personnages dont on partage les sentiments, les sensations, les douleurs, et dont on suit l’évolution à l’épreuve des jours. La littérature et la poésie sont des espaces sensibles qui exacerbent, de façon vertigineuse, l’humain en nous, dans ce qu’il a de plus noble. La sensibilité rassemble, accueille. La morale divise, éloigne, suppose un jugement.
Dans votre roman «Le Cénacle des solitudes», comment expliqueriez-vous ce silence des personnages, cette aphasie dont vous vous êtes sentie prise, vous aussi, est une sorte de cri, comme vous l’avez dit dans certains de vos entretiens?
Le Cénacle des solitudes est marqué par le silence qui s’abat sur les êtres dans les moments les plus insoutenables. La violence frappe de mutisme, et c’est ce silence suffocant, tourmenté, bouillonnant, incisif, inscrit dans la chair et le souffle, saccadé ou suspendu, que le texte cherche à parler, dont il cherche à simuler la violence dans le rythme parfois oppressant de phrases interminables, rythme du temps à la fois absenté et harcelant dans son refus d’accueillir, une scansion particulière, des répétitions et des ruptures où se fomentent une folie en gestation, celle de l’être dérobé à lui-même. L’événement se situe en deçà, en deçà du monde négateur et de ses mots. Il est là où la parole ne cherche plus à dire mais à donner à voir et à sentir l’innommable; là où, impuissante, elle capitule et laisse place à des images, des dessins qui traversent la page blanche, corps, tourmentés, distordus, qui exhibent les stigmates d’une souffrance étouffée, palimpseste.
Mais si les mots cherchent à traduire l’indicible, ils ont aussi ce pouvoir de tromper la mort, de redonner vie dans la transcendance des obstacles d’une réalité enfermante qui empêche d’être au monde. Ainsi, dans Le Cénacle des solitudes, à un moment où elle craint de voir mourir son petit frère, la jeune narratrice se met à débiter un conte interminable comme si les mots pouvaient redonner souffle, redonner vie, redonner corps : «Et j’ai raconté pour te tenir éveillé et garder la mort éloignée, une histoire sans fin. Une histoire cousue dans des bribes que j’étais allée mendier à une enfance, qui survivait comme éclatée en moi. Des fragments de légendes, dont je rapiéçais un à un les lambeaux et je tissais pour toi un rêve interminable déroulé et tiré sur trois jours et trois nuits durant lesquelles pas une fois je ne me suis interrompue, sûre que tu te ferais happer à l’instant même où je me tairais».
Peut-être parce qu’il n’y a plus que les mots pour garder vivants et restituer une dignité à ceux que le monde nie. Ce pouvoir salvateur des mots est présent dans tous mes romans, dès le premier notamment où une conteuse cherche à sauver d’elle-même l’enfant-narratrice.
Propos recueillis par Mouhoub Abdelkrim
Nos écrivains sont là pour nous ouvrir, à nous lecteurs, quelques pistes de lecture et même des outils, un avant-goût de ces jouissances amenant la satisfaction, voire la satiété, étant leurs complices.
Libé : Comment avez-vous pu et su adopter l’écriture, cette monture indomptable et si capricieuse, et l’adapter à vos exigences?
Bouthaïna Azami : Je n’ai jamais vu l’écriture comme une monture indomptable à apprivoiser, mais comme une complice. Plus que cela, une sorte de double salvateur qui parle pour moi, se fait écho des mouvements intérieurs les plus imperceptibles, voix des silences les plus inextricables, les plus étouffés, les plus étouffants. Et l’on se remet à respirer quand on croyait suffoquer en plongeant au plus profond de soi pour laisser voie à ces bruissements de mémoires, d’émotions, que seule l’écriture a le pouvoir de révéler. Non pas même de raconter, de dire. Mais de donner à ressentir. Dans leurs tremblées, leurs palpitations, leur souffle montant ou manquant, leur musicalité, le frissonnement de leur cheminement dans la chair, dans le sang. C’est une sorte de corps-à-corps où l’écriture devient une sorte de travail d’excavation et de déchiffrement de l’enfoui, l'intangible, dont elle se met à l’écoute dans un processus de lecture de l’intangible avant la libération du verbe. Et c’est là que la magie opère: dans l’accord parfait de l’intangible et des mots agencés pour l’incarner et le rendre perceptible.
Quel a été votre premier texte, nouvelle, roman ou poème, que vous avez publié, que vous avez soumis au lecteur ?
Mon premier roman publié est «La Mémoire des temps», paru aux éditions L’Harmattan en 1998. Etrangement, dès les premières phrases, j’ai senti que j’irais plus loin, cette fois, que les éternelles feuilles volantes que je laissais derrière moi depuis l’enfance. J’ai d’ailleurs écrit ce roman sans penser un instant à une éventuelle publication. Une fois achevé, il a traîné sur mon bureau pendant plusieurs années, et ce sont des amis qui m’ont encouragée à le soumettre à une maison d'édition. Dans ce roman, je me suis immergée dans le personnage d’une petite fille vendue, par ses parents, à une famille bourgeoise. Chaque nuit, pendant plus d’une année, je me suis mise dans la peau de cette enfant. Le livre s’ouvre sur un cri: celui de la petite fille arrachée aux bras de sa mère. Puis le silence s’abat comme un couperet. A partir de là, l’écriture va travailler à sonder ce silence, saisissant, qui s’est emparé de l’enfant à un moment, violent, de rupture annihilante où elle devient spectatrice d’un monde qui la tient à l’écart, qui ne l’accueille pas.
La langue française a su se soumettre à votre volonté, à vos volontés, à vos exigences. Quels sont alors les écrivains ayant influencé votre manière de regarder les faits et de les écrire? En est-il de même pour vous?
Dès mon plus jeune âge, je me suis passionnée pour la littérature. Comme je fréquentais l’école française, j’ai baigné dans les grandes œuvres littéraires et poétiques françaises. Le théâtre, le grand roman classique du XIXème siècle, les grands poètes, parmi lesquels Baudelaire, aujourd’hui encore, tient une place particulière. Se servir de la langue pour extraire, par l’acte poétique, de la beauté (les fleurs) du «mal», tel est certainement tout le pouvoir et le sens de l’écriture. Puis il y a eu un tournant, au début de l’adolescence, lorsque j’ai découvert, à travers les espaces francophones, toute une littérature à laquelle nous n’étions pas sensibilisés à l’école. Cela a véritablement été un événement. J’ai découvert une autre langue française, déterritorialisée, parfois malmenée pour, par exemple, chez Mohamed Khaïr-Eddine, mettre en scène la déroute identitaire dans la déroute de la langue (comme dans Agadir, où «je» devient tour à tour «tu» et «il», comme si «je» n’était plus qu’une expérience radicale de l’altérité). De même, Césaire, en se servant de la métaphore du volcan, hurle à la face du monde ce que le monde ne nomme pas, ce que les livres d’Histoire taisent et les consciences ignorent, les «malheurs de ceux qui n’ont point de bouche» et dont un décret n’aura pas suffi à abolir les souffrances qui, des siècles plus tard, persistent dans une contemporanéité dont «le ventre est encore fécond d’où est sorti la bête immonde». Il se sert ainsi de la métaphore du volcan pour jouer une transfiguration, secouer l’univers et le reconfigurer pour redonner à l’homme une identité, une dignité par delà le déni, dans le creux même de la blessure, dans le grondement de tonnerre de ce mot «Nègre» qu’il va investir d’une «valeur de force, une valeur force».
Les exemples sont nombreux. Tout cela pour dire que les écrivains dont j’aime à me nourrir simulent l’espace d’une violence, inscrite dans le texte, pour une autre vérité qui dérange, malmène le monde tel qu’il nous est donné à voir; l’espace d’une transfiguration, aussi, où le démantèlement de la langue, l’éclatement de l’espace et la déroute du temps participent d’une «œuvre de libération», comme dirait Edouard Glissant.
Pour Proust, la vie écrite est plus intense que la vie vécue. Qu’en pensez-vous ?
Etrangement, elles débordent l’une sur l’autre. J’ai écrit, comme plusieurs autres de mes romans, La Mémoire des temps pendant la nuit. Mais, durant la journée, les personnages continuaient de me suivre, de vivre en moi. En quelque sorte, le livre continuait de s’écrire. Par ailleurs, oui, il y a certes une intensité propre à la vie écrite du fait, peut-être, que nous y vivons plusieurs vies en un laps de temps relativement court et que, de plus, comme le dit Deleuze, la littérature est « une sorte de double du monde capable d’en recueillir la violence et l’excès ».
«Ecrire, c’est le double plaisir de raconter et de se raconter une histoire, et c’est aussi le plaisir d’écrire, qui est inexplicable», dit Françoise Sagan dans un entretien accordé au Magazine littéraire en juin 1969
Quand je commence un livre, je pars d’une émotion que je file avant de la laisser m’emporter dans une histoire que je n’ai pas préméditée. Je ne sais jamais vraiment où l’écriture va m’entraîner lorsque j’écris les premiers mots. Il y a, bien sûr, le plaisir d’écrire qui se fait ressentir dès la première phrase, lorsque celle-ci parvient à rendre, de façon presque miraculeuse, les mouvements, le souffle, les frémissements, les sursauts de cette émotion première, inaugurale. Et il y a le plaisir tout aussi magique de l’aventure romanesque, lorsqu’on découvre le livre pendant qu’il s’écrit comme en dehors de soi, qu’il nous emmène là où l’on ne pensait pas consciemment aller.
Le critique et écrivain Milan Kundera dit que le roman est le lieu de l’ambiguïté, le lieu où les choses ne sont jamais tranchées de manière définitive, le lieu de l’absence d’une morale manichéenne. Est-ce que cela pourrait s’appliquer à vos romans ?
Je serais tentée de répondre par l’affirmative, car il n’y a jamais eu de place, en effet, pour une morale manichéenne dans mes romans qui peuvent tous être décrits comme autant de parcours initiatiques. On y suit des personnages dont on partage les sentiments, les sensations, les douleurs, et dont on suit l’évolution à l’épreuve des jours. La littérature et la poésie sont des espaces sensibles qui exacerbent, de façon vertigineuse, l’humain en nous, dans ce qu’il a de plus noble. La sensibilité rassemble, accueille. La morale divise, éloigne, suppose un jugement.
Dans votre roman «Le Cénacle des solitudes», comment expliqueriez-vous ce silence des personnages, cette aphasie dont vous vous êtes sentie prise, vous aussi, est une sorte de cri, comme vous l’avez dit dans certains de vos entretiens?
Le Cénacle des solitudes est marqué par le silence qui s’abat sur les êtres dans les moments les plus insoutenables. La violence frappe de mutisme, et c’est ce silence suffocant, tourmenté, bouillonnant, incisif, inscrit dans la chair et le souffle, saccadé ou suspendu, que le texte cherche à parler, dont il cherche à simuler la violence dans le rythme parfois oppressant de phrases interminables, rythme du temps à la fois absenté et harcelant dans son refus d’accueillir, une scansion particulière, des répétitions et des ruptures où se fomentent une folie en gestation, celle de l’être dérobé à lui-même. L’événement se situe en deçà, en deçà du monde négateur et de ses mots. Il est là où la parole ne cherche plus à dire mais à donner à voir et à sentir l’innommable; là où, impuissante, elle capitule et laisse place à des images, des dessins qui traversent la page blanche, corps, tourmentés, distordus, qui exhibent les stigmates d’une souffrance étouffée, palimpseste.
Mais si les mots cherchent à traduire l’indicible, ils ont aussi ce pouvoir de tromper la mort, de redonner vie dans la transcendance des obstacles d’une réalité enfermante qui empêche d’être au monde. Ainsi, dans Le Cénacle des solitudes, à un moment où elle craint de voir mourir son petit frère, la jeune narratrice se met à débiter un conte interminable comme si les mots pouvaient redonner souffle, redonner vie, redonner corps : «Et j’ai raconté pour te tenir éveillé et garder la mort éloignée, une histoire sans fin. Une histoire cousue dans des bribes que j’étais allée mendier à une enfance, qui survivait comme éclatée en moi. Des fragments de légendes, dont je rapiéçais un à un les lambeaux et je tissais pour toi un rêve interminable déroulé et tiré sur trois jours et trois nuits durant lesquelles pas une fois je ne me suis interrompue, sûre que tu te ferais happer à l’instant même où je me tairais».
Peut-être parce qu’il n’y a plus que les mots pour garder vivants et restituer une dignité à ceux que le monde nie. Ce pouvoir salvateur des mots est présent dans tous mes romans, dès le premier notamment où une conteuse cherche à sauver d’elle-même l’enfant-narratrice.
Propos recueillis par Mouhoub Abdelkrim
Biographie
Bouthaïna Azami est née à Tanger en 1964 et a vécu à Rabat, avant de se rendre en Suisse où elle a étudié la psychologie et les lettres modernes. Elle est l’auteure de plusieurs romans publiés aux Editions L’Harmattan : La Mémoire des temps (1998), Etreintes (2000), Le Cénacle des solitudes (2002) et Fiction d’un deuil (2004). Des romans qui ont fait l’objet de nombreux essais et ont reçu plusieurs prix. Son dernier livre, Au café des faits divers (éditions La Croisée des chemins, 2013), a obtenu le Prix Sofitel Madame Figaro 2014. Parallèlement à son activité d’écrivaine, Bouthaïna Azami aime aussi l’image à travers le dessin, la peinture et le graphisme et a à son actif plusieurs expositions collectives et individuelles.
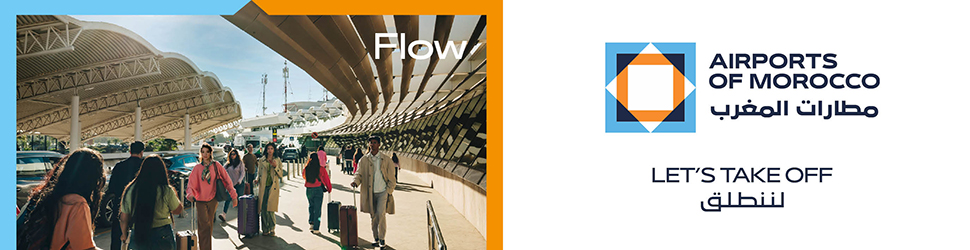





















 Classements, brevets et partenariats: l’USMS s’impose sur la scène académique
Classements, brevets et partenariats: l’USMS s’impose sur la scène académique





