-
SM le Roi félicite l’Emir de l’Etat du Koweït à l’occasion du deuxième anniversaire de son accession au pouvoir
-
Le rôle du Maroc dans l’inscription de la lutte contre la corruption à l’agenda du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU mis en avant à Doha
-
CMR : Journées portes ouvertes au profit des nouveaux retraités
-
L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif présente sa stratégie de soutien au secteur du commerce à Al Qods au titre de l'année 2026
«Une nouvelle alternance sur une base socio-démocratique», c’est le slogan retenu par l’USFP pour les échéances électorales de l’année 2021 qui représentent un moment politique historique reflétant le besoin du peuple marocain d’un nouveau souffle démocratique tel que voulu et consolidé par la vision du Parti quant à une prochaine étape dans le parcours de progrès et de développement que connaît notre pays et dont il a fait part dans son mémorandum sur le Nouveau modèle de développement en soulignant, surtout suite aux retombées et aux défis imposés par la pandémie de Covid-19, «Un Etat fort et une société moderniste et solidaire».
Le pôle sociétal constitue l’une des principales composantes du programme électoral de l’USFP et qui reflète les attentes et les revendications du peuple marocain et en particulier celles des catégories subissant exclusion et marginalisation et l’orientation du Parti dictée par les principes du socialisme démocratique.
Les différentes conclusions et recommandations qui reposent sur le suivi et l’analyse de documents référentiels, d’études, et de rapports dont ceux concernant les rencontres et les conférences thématiques organisées avec plusieurs associations et autres experts reposent sur la nécessité de «repenser la justice sociale». C’est là un axe principal du modèle de développement du pays sachant qu’une nouvelle alternance ne peut être réalisée qu’à travers la mise en œuvre de politiques de justice sociale à même de préserver le Maroc des effets des nombreuses tensions populaires et de renforcer les choix et mécanismes consistant à réduire les disparités et les inégalités et à instaurer justice, égalité et équité.
Cette vision est basée sur le démantèlement de fondements ayant depuis des décennies consacré des disparités se rapportant aux conditions de vie au détriment des femmes et des jeunes en particulier, les privant de l’accès à la protection sociale et aux différents services de base qui permettent l’indépendance des individus et des institutions sociétales en fonction d’un modèle centré sur la nécessité d’offrir à tous la possibilité de l’intégration sociale, de l’équité et de l’indépendance.
Si la justice est à la base de la démocratie, c’est bien le droit qui est la base de la justice et qui en garantit une concrète réalisation. Il ne peut y avoir de justice, ni de démocratie sans la consolidation de la valeur du droit. Nous visons de ce fait, dans notre programme électoral, à faire valoir le droit au sein de toutes les composantes de la société dans le but de surmonter les défaillances affectant les différents services ou les lois et législations qui s’y rapportent. Les nombreuses études réalisées récemment démontrent que l’élargissement des disparités sociales pousse les catégories les plus touchées à amoindrir l’investissement dans le capital humain et notamment dans l’éducation, ce qui impacte négativement le développement économique, les liens sociaux, les opérations politiques et la préservation du capital naturel.
Les disparités sont liées au mode de la répartition des richesses, à la pauvreté et à un trop faible accès au bien-être social. Elles se renforcent encore plus avec leur implantation dans le système social à travers l’éducation et la formation. Les disparités sociales relevées en dehors de l’école trouvent leur origine et leur développement dans le système scolaire luimême et ses différents parcours. Par là même ; le modèle de développement que doit adopter tout pays doit se fixer pour objectif de sortir de la pauvreté et la vulnérabilité, de garantir la santé à la population, de préserver la terre pour les générations futures et d’édifier des sociétés jouissant de sécurité et de paix pour que chaque citoyen soit en mesure de vivre avec dignité.
Les propositions et les mesures adoptées par l’USFP misent sur le dépassement des dysfonctionnements enregistrés par les politiques sociales au Maroc. La concrétisation de cette ambition nécessite la réalisation de deux opérations étroitement liées : lutter contre les disparités d’une part et garantir l’autonomisation institutionnelle et la capacité individuelle de manière à permettre à tous et en particulier les jeunes et les femmes ainsi que les catégories vulnérables de jouir des mêmes droits et des mêmes possibilités d’accès aux différentes opportunités proposées présentement ou à l’avenir, de participer au développement et d’en récolter les fruits.
Le programme du Parti adopte dans le domaine socio-sociétal une série de mesures et de propositions créatives servant le renforcement des rôles et des missions des institutions politiques et des acteurs partisans pour la réalisation d’une justice sociale en accord avec les consensus sociétaux liés au nouveau modèle de développement. Les propositions, critères et mesures prônés par le programme du parti partent de la nécessité d’élaborer des politiques, des programmes et des projets visant à réduire les disparités entre citoyens et entre domaines territoriaux de même que d’un système d’analyses et de diagnostics selon toute une série de procédés :
-Prendre connaissance des disparités existant au centre du système sociétal.
-Adopter une approche globale pour s’attaquer aux disparités sociales tout en prenant en considération les dimensions économique, politique, institutionnelle, culturelle et comportementale
-Mettre en place un modèle de développement gestionnaire basé sur la justice sociale et poussant le pays vers l’adhésion à l’opération de développement économique et vers l’édification d’une société d’équité et de l’égalité des chances.
I- Diagnostic
L’échec des politiques sociales au Maroc est principalement dû à leur incapacité à réduire les disparités sociales et à réaliser la justice sociale ce qui a débouché sur un sentiment d’injustice et de dédain développé particulièrement auprès des femmes, des jeunes et des personnes en situation de handicap à cause de tant de manifestations de discrimination, d’exclusion et d’oppression sociale.
Les disparités sociales se manifestent entre disparités territoriales et disparités entre sexes ou selon l’âge. C’est là un héritage social et des répercussions qui entravent la réalisation d’une intégration sociale équitable pour l’ensemble des Marocains. Les disparités sociales constituent un déficit social représenté par la pauvreté, la vulnérabilité des familles, l’analphabétisme des parents et la difficulté à laquelle ils doivent faire face dans le suivi des études de leurs enfants.
Les disparités et l’absence d’une justice sociale impactent les opportunités d’accès aux services et aux droits essentiels et constituent une raison principale de violation des droits humains, résultat de discrimination, de violence, de mauvais traitement et de l’impossibilité de parvenir à la justice. Le développement des disparités sociales conduit à la réduction des opportunités d’accéder aux compétences et entrave l’intégration sociale et la promotion économique. Ainsi qu’à l’instauration d’un climat d’appréhension, de vulnérabilité et d’insécurité et un manque de confiance à l’égard des institutions et du gouvernement, à l’exacerbation des tensions au sein de la société avec ce qui s’ensuit comme violence et conflits. L’absence de la justice sociale constitue un obstacle au développement du capital humain vu qu’elle reproduit les disparités sociales et les inégalités, avec en sus, l’incapacité des gouvernements successifs à présenter des solutions à une crise devenue chronique. Les dysfonctionnements qui ont marqué la gouvernance du système social au Maroc constituent l’une des premières causes du déficit social et des disparités sociales ce qui est dû aux politiques adoptées par les gouvernements à tous les niveaux durant la dernière décennie et qui se sont de plus opposés à tout renouveau faisant en sorte que toute intention de changement a dû se transformer en chantiers inachevés.

- Garantir sa protection et mettre fin à toute discrimination à l’égard de l’enfance marocaine. - Garantir l’égalité homme / femme.
- Garantir l’équité et l’intégration socio-économique de la jeunesse.
- Garantir l’intégration sociale des personnes en situation de handicap.
- Réaliser l’autonomisation des personnes âgées.
- Réaliser l’intégration culturelle et socio-économique des migrants.
- Une société civile indépendante, influente et porteuse de valeurs démocratiques.
- Un sport marocain fort au service de la cohésion sociale.
L’enfance
L’enfance peut être définie comme la période comprise entre la naissance et la puberté. Elle se caractérise par la croissance continue et le développement progressif physiquement et mentalement de même qu’elle est marquée par la formation et la constitution de la personnalité. C’est pour ces raisons qu’elle revêt une importance capitale dans la vie de l’homme. En effet, la personnalité se forge d’une manière saine à partir d’une genèse et une formation saines. Aussi, tous les acteurs concernés, famille, société doivent-ils pleinement assumer la responsabilité de prodiguer aux enfants une formation saine, les préserver des dangers qu’ils encourent et leur offrir des conditions de vie séantes à même de leur permettre de constituer une existence saine à tout point de vue.
Dans ce contexte, les politiques publiques destinées aux enfants sont considérées comme le fondement de toute planification futuriste de l’édification d’une société cohérente et de la préparation d’une génération capable d’assumer ses responsabilités et faire face à tous les enjeux. Toutefois, on constate qu’au Maroc, en dépit de quelques réalisations fructueuses, la situation de l’enfance continue de manquer de développement efficient et d’interventions fermes pour atteindre le niveau souhaité d’une protection globale et séante. L’USFP, à ce propos, adopte une vision globaliste accompagnée de mesures stratégiques et de décisions urgentes ciblant la situation de l’enfance sous divers aspects : la législation, le contrôle, les équipements … et aspirant à améliorer la situation des enfants au milieu de tous les espaces qui les abritent tels que la famille, les établissements d’enseignement, les espaces publics, en plus de la lutte contre la vulnérabilité à travers une politique équilibrée fondée sur la justice territoriale et sociale.
I- Diagnostic :
Les formes de détresse de l’enfance au Maroc sont multiples et affectent des niveaux de dangerosité disparates allant des pires comme la posture des enfants de la rue et ceux victimes de violence et d’agressions sexuelles jusqu’à celle des enfants abandonnés, des enfants travailleurs, de l’abandon scolaire et de la privation de scolarisation des jeunes filles … Les statistiques révèlent : - Le nombre d’enfants de la rue qui n’ont pas de domicile fixe et qui ne bénéficient d’aucun entretien est estimé à 30.000 garçons et filles. - Aggravation du phénomène de la violence exercée sur les enfants, particulièrement sexuelle dont sont souvent victimes les jeunes filles. Là-dessus, on déplore une hausse du taux de mariages d’enfants, atteignant 11% (15.235 enfants dont 99% de filles). - Plus d’un million d’enfants de 7 à 14 ans travaillent dans divers secteurs (dont la moitié est constituée de filles). 78% des enfants contraints de travailler sont issus de milieux ruraux. Et on note également que les parents poussant leurs enfants à aller travailler le font du fait de leur fragilité matérielle et leur vulnérabilité ou par cupidité considérant leur progéniture comme un investissement à exploiter. L’aggravation de ce phénomène résulte, par ailleurs, de l’absence d’une loi claire à même de l’endiguer ou le limiter. (Le Code du travail dispose, tout de même, qu’il est interdit d’employer des enfants, précisant que les contrevenants à cette disposition sont passibles de peines d’emprisonnement).
- Recrudescence des abandons scolaires d’enfants (400 mille annuellement). Sur le plan institutionnel et en matière de gouvernance, il est à noter :
- Non habilitation des centres d’assistance sociale d’une manière équitable et non adaptation de ces centres aux besoins des enfants (activités, structures, équipements, encadrement …).
- Non efficience des mesures prises concernant les enfants en situation de handicap et absence de prise en compte des différences de leurs catégories sociales, leurs besoins….).
- Faiblesse de l’action du ministère en charge du secteur quant à l’encadrement et au contrôle des employés dans les centres d’assistance sociale, et insuffisance des équipements nécessaires, des cadres et des formations.
- Non respect des lois et législations internationales relatives à l’enfance en dépit de leur ratification par le Maroc. Là-dessus, l’inexistence d’une justice territoriale quant au traitement des affaires de l’enfance constitue un facteur déterminant dans l’inefficacité des mesures prises dans le but de faciliter l’accès de l’enfant aux services essentiels (éducation, santé, loisirs), ce qui engendre des disparités flagrantes entre enfants du milieu urbain et ceux du milieu rural.
II- Propositions de l’USFP en vue d’assurer la protection de l’enfance et réduire la ségrégation entre enfants :
Nécessité d’élaboration d’une stratégie nationale générale à partir des dispositions constitutionnelles et des législations internationales relatives à l’enfance, associant tous les acteurs. Cette stratégie vise l’adoption du principe de la primauté des droits de l’enfant par rapport aux autres considérations et aux autres parties. A cet effet, l’USFP propose :
1-Mise en place d’un arsenal juridique et législatif global axé sur la protection et la prévention de toutes les formes de violation des droits de l’enfant, tout en lui assurant des conditions de vie séantes et la sécurité à travers le respect de ses droits économiques, sociaux et civils tels que l’éducation, l’hébergement convenable, l’assistance sanitaire, psychologique, culturelle et distractive.
2-Intégration des droits de l’enfant dans les politiques publiques et les budgets sectoriels, dans les programmes régionaux et locaux de développement, dans les plans communaux, tout cela en sus d’un diagnostic territorial de la situation des enfants à même d’en déterminer les problématiques et les nécessités.
3-Création d’une commission régionale de la protection de l’enfance qui s’emploie à illustrer la politique intégrée de la protection de l’enfance dans les plans d’action des collectivités territoriales, à établir les budgets et à évaluer les réalisations.
4-Formation des acteurs en charge de l’enfance au sein de l’ensemble des institutions concernées dans le but d’améliorer et de valoriser leur action (santé, éducation, sécurité, distractions..)
5-Prise de mesures préventives de lutte contre le phénomène de l’emploi des enfants.
6-Elaboration d’un plan national de lutte contre l’abandon scolaire et généralisation de l’obligation d’enseignement.
7-Elaboration d’une stratégie nationale autour des loisirs, des colonies de vacances se rapportant aux enfants en situation de handicap tout en encourageant et en favorisant leur prise en charge.
8-Inciter les collectivités locales à créer et financer des espaces publics intégrés d’animation éducative au profit des enfants.
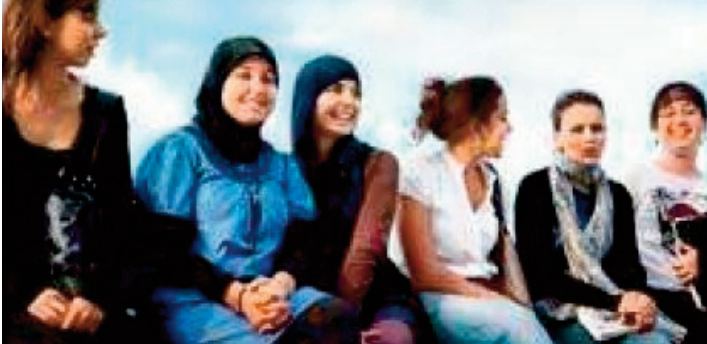
« Il n'y a pas d'autre solution que de vivre notre temps et d'avancer vers l'avenir avec la pleine contribution des femmes, qui devraient figurer à la tête des priorités du nouveau modèle de développement, car elles sont - comme le prouvent les expériences des pays démocratiques développés - un acteur clé de la construction démocratique, du développement et du progrès de la société». (Plateforme d’orientation pour l’encadrement du dialogue ittihadi concernant la conjoncture actuelle). Rendre justice aux femmes est un sujet de préoccupation majeur pour les gouvernements successifs depuis les années 1990.Les femmes ont pu obtenir un certain nombre d’acquis importants dans tous les domaines politique, économique, juridique et social.
Cependant, malgré les dispositions de la nouvelle Constitution au chapitre II relatif aux libertés et droits fondamentaux, et notamment l’article 19 qui dispose : « L'homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Royaume… », l’on remarque qu’après les élections de 2011 et la présidence du gouvernement par le PJD pendant 10 ans, les dispositions de la Constitution n’ont pas été mises en œuvre adéquatement en fonction de son esprit, notamment les dispositions concernant les droits des femmes. Tout au contraire, les décisions, les positions et les projets de loi de ces gouvernements ont été teintés par une vision rétrograde et conservatrice de la femme et de son rôle dans la société, ce qui a suscité une profonde inquiétude au sein de la société politique et civile en raison de la suspension du processus de réforme qui a libéré les femmes et la société en général.
Partant de là, l'USFP est déterminée, conformément à ses principes et son référentiel, à faire face à cette interprétation conservatrice portant atteinte à l'égalité entre les deux sexes et, partant, oeuvrant à freiner la modernité et à nous faire revenir à des époques anciennes de l'histoire, époques qui ne sont pas du tout compatibles avec le développement historique et normal de la société marocaine. L'USFP s’attache à son référentiel social-démocrate moderniste, car celui-ci permet la construction d'une société ouverte à toutes les énergies sans discrimination fondée sur le sexe ou autre critère, mais, au contraire, l’USFP considère que la société ne peut se développer sans une intégration effective des femmes et la garantie d’une pleine citoyenneté pour elles sur la base de la pleine égalité dans tous les domaines politique, économique, social, culturel, environnemental et autres.
Ainsi, il propose un ensemble de mesures et de mécanismes qui sont à même de garantir leurs droits, que ce soit dans le domaine de la politique, de l’économie, de l'éducation, de la santé, de l'emploi, et d'autres domaines vitaux dans la vie des femmes et de la société en général, et ce, après un diagnostic mettant à nu quelques dysfonctionnements.
Le diagnostic
Selon le rapport du HCP intitulé « Analyse genre de l’impact du coronavirus sur la situation économique, sociale et psychologique des ménages », la crise sanitaire a impacté négativement la situation financière des femmes, en raison de la précarité de la femme marocaine sur le marché du travail. Le rapport a souligné que «globalement et au moment de la crise, les ménages dirigés par les femmes déclarent les salaires comme source principale de revenus. Ils représentent 18% du nombre total des ménages ayant à leur tête une femme contre 25.5% chez ceux dirigés par les hommes», ajoutant que cela est vrai indépendamment de leurs milieux de résidence, leurs secteurs d’activité ou la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent. Selon ce rapport, la différence entre hommes et femmes « s’explique par la nature des postes que ces dernières occupent et qui sont « moins importants » que ceux des hommes. Ainsi, en situation de crise, elles sont les premières à être sacrifiées ». Et le même document d’ajouter : « Etant donné la nature des postes occupés par les femmes, en situation de crise, elles sont plus facilement licenciées ». Et l’on observe la même réalité dans les activités de services.
« Et vu que la culture de l’égalité n’est encore qu’un slogan dans notre pays, et vu que la mentalité masculine est encore enracinée chez les hommes de l’administration et même parfois chez ses femmes, nous avons constaté qu’une mesure aussi bonne comme celle de la distribution des aides financières aux familles défavorisées disposant ou non de la carte Ramed n’a profité qu’aux pères de ménages. Or, on trouve à la tête de plus d’un quart de ménages au Maroc des femmes (en dépit de la présence du père et sa capacité à travailler). Dans les pays développés, l’on voit qu’ils ont distribué les aides équitablement entre le père et la mère du ménage, alors que dans les pays en développement en Amérique latine, l’aide a été versée aux femmes seulement, car elles sont plus soucieuses de prendre soin de leurs familles et de leurs enfants. Le gouvernement aurait, donc, pu verser les aides financières aussi bien aux femmes qu’aux hommes pour préserver la dignité des femmes et l’équilibre des ménages » (Plateforme d’orientation pour l’encadrement du dialogue ittihadi concernant la conjoncture actuelle).
D'une manière générale, tous les rapports des organisations nationales et internationales brossent un tableau sombre des conditions des femmes qui travaillent au Maroc, où elles souffrent encore de discrimination en termes de salaires et de conditions de travail, et que le taux des femmes qui travaillent dans les zones urbaines a diminué de 18%, et que 82 % des femmes dans les villes n’ont pas de travail. Cela signifie qu’elles n'ont ni revenu ni statut social, ce qui constitue une menace pour leur capacité à exercer leurs droits fondamentaux. Et malgré les données officielles indiquant que les femmes occupent le tiers des postes dans la haute fonction au Maroc et plus de la moitié des ouvriers et employés, celles qui ont un compte bancaire ne dépassent pas 27%, contre 52% pour les hommes.
Le travail des femmes marocaines est concentré dans des secteurs connus dans lesquels les conditions de travail sont difficiles, tels que l'agriculture, le travail domestique, l'habillement et le textile, en plus de l'économie parallèle. Les femmes rencontrent également des difficultés à s’impliquer dans l’action syndicale. D'autres rapports ont également montré que sur 13,4 millions de femmes âgées de 15 à 74 ans, plus de 7,6 millions ont été victimes de violences, quelles qu'en soient les formes et les domaines, ce qui représente 57% des femmes. La même source a souligné que le taux de prévalence de la violence est de 58% en milieu urbain (5,1 millions de femmes) et de 55% en milieu rural (2,5 millions de femmes).Le HCP a révélé que les femmes ne sont pas toujours en mesure, et cela dans les villes plus qu’à la campagne, d’accéder et de profiter des espaces publics en toute sécurité au même titre que les hommes en raison des violences qui peuvent être pratiquées à leur encontre dans ces espaces. Il y a donc de nombreux dysfonctionnements qui concernent tous les niveaux, notamment :
Au niveau juridique :
Les dysfonctionnements juridiques se manifestent dans l'ensemble des lois promulguées au cours des dix dernières années et qui sont teintées de conservatisme et de discrimination à l'égard des femmes et perpétuent par conséquent leur statut d’infériorité dans la société, ou des lois qui ont été promulguées avant cette époque et qui ne suivent plus le rythme de l'évolution de la société, et qui n'ont pas été mises à jour, et ont même approfondi leur nature conservatrice. Dans ce qui suit, nous nous concentrons sur trois exemples : le Code de la famille, la loi relative à la lutte contre la violence et le Code du travail.
Le Code de la famille
16 ans après l’adoption de ce Code, qui a constitué une véritable révolution à l'époque, et du fait du développement de la réalité sociétale, de la prise de conscience collective, et la longue pratique de ce Code, plusieurs insuffisances, faiblesses et manque de cohérence ont été relevées dans ses dispositions, voire la contradiction de plusieurs de ses articles entre eux, qu'il s'agisse de notifier le mariage pour les couples mariés sans acte (article 16), ou le mariage de mineurs (article 20) et sa contradiction avec les dispositions de l'article 19, qui stipulent que la capacité matrimoniale s'acquiert, pour le garçon et la fille jouissant de leurs facultés mentales, à 18 ans, ou la manière de répartition des biens communs, ou l’établissements de la filiation et de ses effets et la garde et la tutelle sur les enfants. Nous constatons également des dysfonctionnements importants concernant le Fonds d’entraide familiale, comme la difficulté d’y accéder en raison de la complexité des conditions d’accès, que ce soit au niveau administratif ou financier, d’où la nécessité de le réformer. Outre les lacunes du texte juridique, nous notons que la jurisprudence est limitée, que beaucoup de décisions des juges sont teintées du conservatisme, que les tribunaux se contredisent, et certains d’entre eux n’ont pas suivi le rythme du développement scientifique et ne sont pas imprégnés de l’esprit de la Constitution, notamment au niveau du respect des droits de l’Homme et de la primauté des conventions internationales sur les lois nationales, d’où l’urgence de modifier le Code de la famille.
La loi relative à la lutte contre les violences faites aux femmes (n°103-13) Cette loi a suscité un grand débat et a été critiquée par les associations féminines et les secteurs de la femme relevant des partis politiques modernistes. Les plus importantes de ces critiques peuvent être résumées dans les points suivants : ° L’absence de préambule de cette loi précisant le référentiel adopté et la stratégie qui a été définie, ainsi que le contexte général qui l'encadre. ° Cette loi s'est contentée d'apporter des modifications partielles au Code pénal et au Code de procédure pénale, à un moment où l'élimination de la violence nécessite l’adoption d'une loi spéciale indépendante du Code pénal, une loi globale qui inclut la prévention, la protection, la prise en charge et la lutte contre l’impunité.
° Le fait qu’elle stipule que la victime renonce à la plainte constitue une atteinte au rôle du ministère public dans le déclenchement de l’action publique, en particulier lorsque les crimes de violence contre les femmes sont très graves, ce qui nécessite le maintien du rôle du ministère public dans ces affaires pour assurer la justice.
° La loi n'a pas fait référence au traitement des moyens de preuve dont manquent les femmes, notamment en ce qui concerne les violences faites au sein du domicile conjugal, et a conservé les moyens de preuve traditionnels malgré la spécificité de ce type de délit, et donc la victime qui fait l'objet de l'agression doit être considérée comme un témoin.
° Quand l’on évoque le délit de harcèlement sexuel, on le rattache au harcèlement fait de façon répétée. Il s’agit d’une notion vague et ambiguë, qui laisse place au pouvoir discrétionnaire du juge en fonction de son référentiel.
° Concernant les mécanismes de prise en charge des femmes victimes de violences (mécanismes de protection), le texte parle de cellules et commissions de prise en charge (aux niveaux local, régional et national) qui assumeront les tâches d'accueil, d'écoute, d'orientation et de contrôle auprès des juridictions de première instance et les cours d’appel et les représentants de l'administration. La loi évoque aussi d'un texte réglementaire qui n’a pas encore vu le jour.
° Cette loi sous-estime le rôle de la société civile et le marginalise même si la Constitution met en valeur l’importance de cette société civile qui, d’ailleurs, fait preuve d’efficacité dans ce domaine, car les associations féminines sont les premières à créer des centres d’accueil des femmes violentées et s’activent bénévolement sans l'aide de l'Etat dans ce domaine.
° L'absence de toute allusion à la formation et à l’accompagnement des personnes concernées dans ce domaine, telles que la police, la gendarmerie et autres Ainsi, il apparaît que cette loi contient un ensemble de lacunes et d’insuffisances pour faire face au phénomène des violences faites aux femmes, qui s’accentuent considérablement et qui coûtent excessivement à l’Etat et à la société sur le plan sanitaire et financier. D'autant plus que le taux d'impunité est élevé, car seul un faible pourcentage des cas de violence sont portés devant les tribunaux, selon les statistiques du HCP. On peut souligner que la recrudescence de ce phénomène est due aux mécanismes limités de protection et de prise en charge des femmes victimes de violences, et l'absence de prévention de ce ans toutes les politiques publiques y afférentes telles que l'éducation et les médias. Cette recrudescence est également due au manque d'autonomie économique de certaines femmes victimes de violences et à leur faible statut social, ainsi qu'à la méconnaissance de leurs droits.
Le Code du travail
Le développement de la société a conduit à l’insertion des femmes dans le marché du travail et dans la vie professionnelle, ce qui les a amenées à participer à l’effort collectif, à l’interaction avec la société, et donc à la promotion de leur autonomisation économique. Mais dans quelle mesure les femmes marocaines ont-elles pu participer à la vie économique en l’absence d’une vision claire de la concrétisation de l'égalité des sexes dans le domaine du travail ? Les femmes en milieu rural, par exemple, effectuent des travaux difficiles, car elles participent aux travaux agricoles et assument en même temps la charge domestique, mais, paradoxalement, elles constituent le groupe le plus vulnérable dans le secteur agricole pour plusieurs raisons, dont notamment la mentalité patriarcale prédominante et la marginalisation institutionnelle, ainsi que la difficulté d'accès à la propriété et à l'exploitation de la terre.
Bien que le Code du travail stipule le rejet de toute forme de discrimination, il existe des difficultés rencontrées par la salariée ou le demandeur d'emploi lorsqu'il s'agit de prouver que l'employeur fait une distinction entre les salariés en termes d'emploi, de privilèges ou de salaires. De nombreuses femmes, en outre, travaillent sans contrat écrit, ne disposent pas de couverture sanitaire, dans des secteurs non protégés et, ainsi ne sont pas couvertes par le Code du travail. Cela s'ajoute au fait que la grande majorité des femmes dans le monde rural travaillent sans rémunération et dans des conditions difficiles qui menacent leur sécurité. Un nombre important d'entre elles travaillent dans des secteurs peu qualifiés, ou exercent des métiers vulnérables, et la plupart d'entre elles sont incapables d'obtenir des prêts. Et par conséquent, les femmes sont plus exposées à la vulnérabilité et à la marginalisation.
Au niveau économique et social :
Les rapports internationaux classent le Maroc dans les derniers rangs en ce qui concerne les disparités entre les sexes. Ainsi, le Maroc est classé 133ème sur 142 pays en 2014. En ce qui concerne la participation économique des femmes, le Maroc est 135ème. Il est classé également 24ème sur 30 en termes de politiques et de mécanismes de soutien et d’accompagnement des entreprises dirigées par des femmes et dotées de capacités avérées. Tous les rapports nationaux soulignent la baisse du pourcentage de femmes actives sur le marché du travail passant ainsi de 28,1 % en 2000 à moins de 20 % en 2019, et indiquent que les trois quarts des femmes actives travaillent comme aides domestiques. Quant au chômage de longue durée, qui frappe les jeunes, notamment les diplômés de l'enseignement supérieur, il touche 26,8% des femmes, contre 14,8% des hommes en 2013.
Par ailleurs, les femmes ne représentent qu'un tiers des cadres supérieurs, alors qu'elles représentent plus de la moitié des salariés (52,8%). Elles sont également fortement présentes dans des secteurs vulnérables, tels que l'agriculture, le travail domestique et l'économie informelle. La proportion de femmes fonctionnaires dans les administrations publiques atteint 43% de l'effectif total, mais la plupart d'entre elles se situent dans les niveaux les plus bas, et leur représentation dans les postes de responsabilité n'atteint que 23%. Pis encore, les femmes ont du mal à accéder aux sources de financement pour créer leur entreprise, contrairement au microcrédit dont bénéficient 55% des femmes en 2013. Pour cette raison, les entreprises féminines ne représentent que 12% du nombre total d'entreprises. Plusieurs raisons expliquent cette situation déplorable, dont le taux élevé de l'analphabétisme chez les femmes, notamment dans les zones rurales, la division traditionnelle des rôles entre les sexes, et le confinement des rôles des femmes dans le travail domestique et dans les rôles de reproduction. Pourtant, ces raisons ne sont que des alibis pour justifier l’exclusion des femmes. S'il est possible d'évoquer le taux élevé d'analphabétisme chez les femmes par rapport aux hommes, cette justification reste insuffisante au regard de la performance scolaire des femmes au Maroc depuis des années et à tous les niveaux scolaires, ce qui prouve l'existence de discrimination à l'égard des femmes pour les exclure de la vie publique, du marché du travail et de l'activité économique, en dépit de leurs capacités et de leurs qualifications.
La femme détenue
Cette catégorie vulnérable n'a été abordée dans aucun programme gouvernemental précédent, malgré le fait qu'elles souffrent doublement, d’abord en raison de leur sexe, et ensuite parce qu'elles sont privées de leur liberté. Selon les rapports internationaux et nationaux, le pourcentage de femmes détenues constitue une très petite minorité, atteignant 5% au niveau mondial et 3% au niveau national. La détention des femmes entraîne des problèmes complexes qui affectent négativement leur famille et leurs enfants, car elles sont souvent responsables de leur éducation. C’est pourquoi, la femme emprisonnée a besoin de beaucoup d'attention et de soins pour être réintégrée dans la société.
Les 3% mentionnés ci-dessus (c'est-à-dire une femme détenue sur environ 25 détenus), créent des problèmes pour l'administration dans l’aménagement des établissements pénitentiaires et la mise en place de quartiers spéciaux pour les détenues, et elles sont de ce fait placées dans des annexes ou des prisons temporaires qui manquent généralement d'équipements qui tiennent en compte de leur statut exceptionnel et particulier en tant que catégorie vulnérable au sein d'une grande catégorie vulnérable (à savoir les prisonniers en général). Par conséquent, des mesures doivent être prises pour améliorer les conditions de détention pour cette catégorie de femmes.
Au niveau politique et décisionnel
Personne ne nie l’évolution de la représentation des femmes dans le champ politique. Ainsi, 2 femmes (le Groupe socialiste) sont entrées au Parlement en 1993, ainsi qu'en 1998, mais le grand saut a été enregistré en 2002 avec l’adoption de la liste nationale qui a permis aux femmes d'occuper 30 sièges, ainsi que l’adoption de la liste supplémentaire en 2009 pour les élections communales. La nouveauté est apportée par les lois organiques concernant les élections de 2021. Il s’agit en l’occurrence du remplacement de la liste nationale par les listes régionales, dont une partie doit être réservée aux femmes, notamment la première et la deuxième place, avec l’adoption d’un tiers dans le reste des conseils.
La liste régionale s'inscrit dans le cadre de la loi organique de la Chambre des représentants qui prévoit que cette Chambre est composée de 395 membres élus, au suffrage universel direct, au scrutin de liste, et répartis comme suit : 305 membres sont élus au niveau des circonscriptions électorales locales et 90 membres sont élus au titre des circonscriptions électorales régionales. C'est dans ces dernières listes que les femmes seront présentes, et le nombre pour chaque liste est déterminé en fonction de la population dénombrée au dernier recensement national. Le champ politique constitue une exception par rapport aux champs syndical, économique ou de la société civile où l’on enregistre les dysfonctionnements suivants :
° Faible représentation des femmes aux postes de direction et de décision, ° Faible représentation des femmes au sein des organisations syndicales, associatives et professionnelles, ° La Domination de la mentalité patriarcale, qui constitue une barrière impénétrable à la pleine parité.






















