
Du 16 au 18 novembre se tiendra à Rome, le Sommet mondial sur la sécurité alimentaire. Depuis la création de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, en 1945, c'est la troisième fois que des chefs d'Etat et de gouvernement se réunissent autour du problème de la faim dans le monde. La situation demeure alarmante : en raison de la crise financiaro-économique, plus de 100 millions de personnes sont venues grossir le cortège des affamés qui sont désormais plus d'un milliard.
Dans un rapport intitulé Climat change : Impact on agriculture and costs of adaptation de septembre 2009, l'International Food Policy Research Institute (IFPRI), basé à Washington, souligne que « l'agriculture sera négativement affectée par le changement climatique, notamment en Asie du Sud, et que ce sont les personnes vulnérables qui sont susceptibles d'être le plus gravement touchés ». Or, près de la moitié de la population active dans les pays en développement - soit 2,5 milliards de personnes - vit de l'agriculture et 75 % de la population mondiale la plus pauvre réside en zone rurale. Pour compenser les impacts négatifs du changement climatique, l'IFPRI préconise d'accroître les investissements de plus de 7 milliards de dollars.
Investir massivement dans le secteur agricole pour accroître la production, telle est la solution préconisée depuis vingt ans, sans réussir pour autant à éradiquer la faim. Depuis la crise alimentaire, de nombreuses initiatives ont pourtant été prises en ce sens aux niveaux international, national et régional.
La Banque mondiale a ainsi investi plus de 800 millions de dollars en réponse à la crise alimentaire. Au sommet du G8 à l'Aquila en juillet 2009, les Etats se sont engagés à verser 2 milliards de dollars pour la sécurité alimentaire, et les Etats-Unis, au travers de l'Agence américaine pour le développement international, investiront en 2010 près de 4,8 milliards de dollars dans la lutte contre la faim. La France a lancé avec plusieurs partenaires, en juin 2009, un Fonds d'investissement pour l'agriculture en Afrique, qui devrait être doté de près de 500 millions d'euros. En Asie, la Chine, l'Inde et les Philippines ont fait d'importants efforts pour réinvestir dans l'agriculture. En Afrique, le Bénin, le Cameroun, la République centrafricaine et Madagascar ont pris des mesures à court terme visant à accroître la production.
Mais investir, même massivement, dans l'agriculture ne signifie pas automatiquement réduire la faim dans le monde. « La crise alimentaire est presque toujours présentée comme étant un problème de production. Pour la pensée capitaliste obnubilée par le monopole, cela veut dire des semences commerciales, de grandes étendues de terres uniformes dédiées à la monoculture, beaucoup d'intrants chimiques et un système commercial et sans entraves ; en conséquence, des sommes d'argents énormes sont mises en jeu pour essayer de suivre la recette proposée (« nourrir le monde»), quand c'est précisément cette recette qui nous a mené au désastre actuel », dénonce l'ONG internationale Grain, dont le siège est à Barcelone, en Espagne.
De fait, la situation de famine ne tient pas à une pénurie alimentaire globale mais à l'incapacité des petits paysans à acheter de la nourriture lors de mauvaises récoltes et à vivre décemment du fruit de leur activité.
Mais à qui profiteront ces investissements ? A l'agrobusiness ou à l'agriculture familiale ?
Dans son deuxième rapport au Comité des droits de l'homme, Olivier de Schutter, le Rapporteur spécial des Nations unies pour le droit à l'alimentation, remet en cause, chiffres à l'appui, l'idée selon laquelle « les investissements en faveur de la sécurité alimentaires auront plus d'efficacité s'ils se concentrent sur les fermes les plus grandes et les plus productives ».
A l'occasion du Sommet mondial, les Etats devront se prononcer sur les deux modèles : l'un basé sur l'agro-business et les multinationales et l'autre sur l'optimisation de l'exploitation familiale. « C'est le grand dilemme du développement » estime Laurent Delcourt, chercheur au Cetri à Louvain-La-Neuve (Belgique). « Au Brésil par exemple, le gouvernement Lula met en place une politique sociale d'aide alimentaire à destination des plus démunis et des enfants des écoles dont 30 % provient de l'agriculture familiale locale.
Mais la politique anticrise menée par l'Etat brésilien repose sur l'amélioration de la balance commerciale consistant à engranger un maximum de devises, près de 200 milliards de dollars actuellement. Or une telle stratégie postule non un renforcement de l'agriculture familiale mais plutôt une agriculture intensive de rente de type agro-exportatrice », poursuit le sociologue belge. On s'interroge d'avance sur la capacité du Sommet mondial de Rome à surmonter ce type de contradictions.
Dans un rapport intitulé Climat change : Impact on agriculture and costs of adaptation de septembre 2009, l'International Food Policy Research Institute (IFPRI), basé à Washington, souligne que « l'agriculture sera négativement affectée par le changement climatique, notamment en Asie du Sud, et que ce sont les personnes vulnérables qui sont susceptibles d'être le plus gravement touchés ». Or, près de la moitié de la population active dans les pays en développement - soit 2,5 milliards de personnes - vit de l'agriculture et 75 % de la population mondiale la plus pauvre réside en zone rurale. Pour compenser les impacts négatifs du changement climatique, l'IFPRI préconise d'accroître les investissements de plus de 7 milliards de dollars.
Investir massivement dans le secteur agricole pour accroître la production, telle est la solution préconisée depuis vingt ans, sans réussir pour autant à éradiquer la faim. Depuis la crise alimentaire, de nombreuses initiatives ont pourtant été prises en ce sens aux niveaux international, national et régional.
La Banque mondiale a ainsi investi plus de 800 millions de dollars en réponse à la crise alimentaire. Au sommet du G8 à l'Aquila en juillet 2009, les Etats se sont engagés à verser 2 milliards de dollars pour la sécurité alimentaire, et les Etats-Unis, au travers de l'Agence américaine pour le développement international, investiront en 2010 près de 4,8 milliards de dollars dans la lutte contre la faim. La France a lancé avec plusieurs partenaires, en juin 2009, un Fonds d'investissement pour l'agriculture en Afrique, qui devrait être doté de près de 500 millions d'euros. En Asie, la Chine, l'Inde et les Philippines ont fait d'importants efforts pour réinvestir dans l'agriculture. En Afrique, le Bénin, le Cameroun, la République centrafricaine et Madagascar ont pris des mesures à court terme visant à accroître la production.
Mais investir, même massivement, dans l'agriculture ne signifie pas automatiquement réduire la faim dans le monde. « La crise alimentaire est presque toujours présentée comme étant un problème de production. Pour la pensée capitaliste obnubilée par le monopole, cela veut dire des semences commerciales, de grandes étendues de terres uniformes dédiées à la monoculture, beaucoup d'intrants chimiques et un système commercial et sans entraves ; en conséquence, des sommes d'argents énormes sont mises en jeu pour essayer de suivre la recette proposée (« nourrir le monde»), quand c'est précisément cette recette qui nous a mené au désastre actuel », dénonce l'ONG internationale Grain, dont le siège est à Barcelone, en Espagne.
De fait, la situation de famine ne tient pas à une pénurie alimentaire globale mais à l'incapacité des petits paysans à acheter de la nourriture lors de mauvaises récoltes et à vivre décemment du fruit de leur activité.
Mais à qui profiteront ces investissements ? A l'agrobusiness ou à l'agriculture familiale ?
Dans son deuxième rapport au Comité des droits de l'homme, Olivier de Schutter, le Rapporteur spécial des Nations unies pour le droit à l'alimentation, remet en cause, chiffres à l'appui, l'idée selon laquelle « les investissements en faveur de la sécurité alimentaires auront plus d'efficacité s'ils se concentrent sur les fermes les plus grandes et les plus productives ».
A l'occasion du Sommet mondial, les Etats devront se prononcer sur les deux modèles : l'un basé sur l'agro-business et les multinationales et l'autre sur l'optimisation de l'exploitation familiale. « C'est le grand dilemme du développement » estime Laurent Delcourt, chercheur au Cetri à Louvain-La-Neuve (Belgique). « Au Brésil par exemple, le gouvernement Lula met en place une politique sociale d'aide alimentaire à destination des plus démunis et des enfants des écoles dont 30 % provient de l'agriculture familiale locale.
Mais la politique anticrise menée par l'Etat brésilien repose sur l'amélioration de la balance commerciale consistant à engranger un maximum de devises, près de 200 milliards de dollars actuellement. Or une telle stratégie postule non un renforcement de l'agriculture familiale mais plutôt une agriculture intensive de rente de type agro-exportatrice », poursuit le sociologue belge. On s'interroge d'avance sur la capacité du Sommet mondial de Rome à surmonter ce type de contradictions.
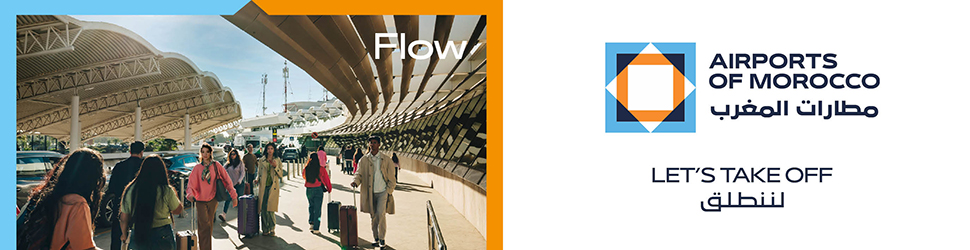


















 Pourquoi Bank Al-Maghrib tarde-t-elle à baisser son taux directeur ?
Pourquoi Bank Al-Maghrib tarde-t-elle à baisser son taux directeur ?





