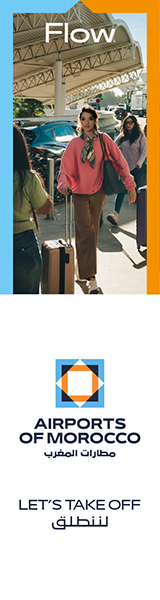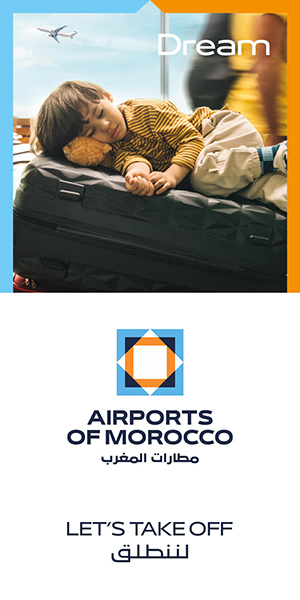-
La France ne reçoit pas de leçons de la réaction internationale, en référence à Rome et Washington
-
Industrie européenne : Bruxelles retarde son projet de relance du «made in Europe»
-
80% des nouveaux emplois créés depuis 2024 occupés par des immigrés
-
Trump augmente sa nouvelle taxe douanière à 15% après le revers infligé par la Cour suprême
La semaine dernière, Washington a d’abord cherché à rassurer le Président Moubarak de son soutien, mais à la suite de la répression des manifestations, il a demandé à son protégé de garantir le droit des manifestants qui lui reprochent notamment de n’avoir jamais levé l’état d’urgence en place depuis près de 30 ans et de n’être nullement arrivé à améliorer leur niveau de vie puisque 40% de la population égyptienne vit avec moins de 2 dollars par jour et par personne.
L’histoire n’offre pas de leçons évidentes. Parfois, les Etats-Unis ont été à même d’accompagner et de domestiquer des changements potentiellement dangereux pour leurs intérêts. Dans les années 70, après la chute des généraux grecs, ils favorisèrent l’arrivée au pouvoir du politicien modéré Caramanlis. De même, au Portugal et en Espagne, ils réussirent à neutraliser les partis communistes et à promouvoir l’émergence de formations politiques pro-occidentales.
Parfois aussi, la situation leur a totalement échappé, comme au Nicaragua en 1979 lorsque leur option – la constitution d’un gouvernement centriste- fut balayée par la victoire militaire sandiniste sur la satrapie des Somoza ou encore en Iran, où les islamistes éliminèrent très rapidement toute alternative modérée après le départ abrupt du Chah.
De surcroît, dans le monde en recomposition qui est le nôtre, la marge de manœuvre de toute puissance, fut-elle la superpuissance américaine, est plus limitée qu’auparavant. De plus en plus conscients de la difficulté de forger le monde à leur image et au gré de leurs intérêts, les Etats-Unis savent qu’ils doivent agir avec beaucoup plus de subtilité qu’au temps de la politique de la canonnière ou des barbouzeries de la CIA en Amérique latine.
Ce qui devrait renforcer une approche plus prudente et plus multilatérale de leur diplomatie, loin des illusions unilatéralistes qui régnèrent au sein de l’administration Bush.