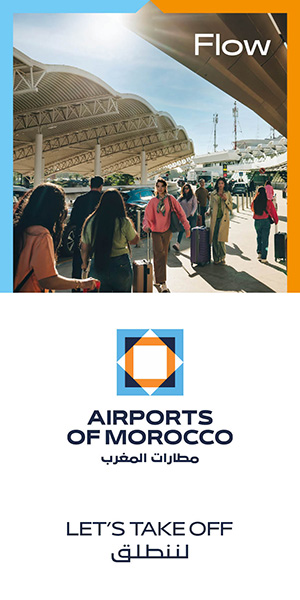Autres articles
-
Ménopause: Les traitements hormonaux n'augmentent pas la mortalité
-
Le musée du cinéma à Ouarzazate, une mémoire vivante du 7e art et de ses métiers
-
Soyouz à la casse: La fin de l'ère russe à Kourou
-
Dans un atelier de prothèses, des vétérans amputés se disent sans regrets
-
Les données des sportifs, un eldorado en devenir ?
Le 23 septembre, une tempête de sable s'est abattue sur Sydney. Une épaisse couche de poussière orange a rapidement recouvert tout ce qui ne bougeait pas, mais de nombreux habitants ont déclaré avoir vu un ciel rose pâle, rouge et même jaune. Pourquoi un nuage orange colore-t-il le ciel en rose, en rouge ou en jaune?
Parce que les particules microscopiques diffusent la lumière du soleil d'une manière particulière, différente de celle des particules macroscopiques. Si le ciel est saturé de poussières de taille nettement supérieure à la plus grande longueur d'onde de la lumière visible (c'est-à-dire plus de 750 nanomètres), l'atmosphère est de la même couleur que les poussières en question, en l'occurrence, orange.
Mais les particules qui constituaient le nuage de Sydney étaient de taille inférieure à 750 nanomètres. Or la lumière subit une diffraction importante lorsqu'elle heurte des particules aussi petites. Les différentes couleurs qui la composent sont alors divisées et diffusées de manière très complexe et seul un nombre limité de longueurs d'onde parvient jusqu'au sol. Dans ce type de circonstances, que les scientifiques ne comprennent pas encore parfaitement, l'atmosphère peut prendre toutes sortes de couleurs, du bleu au rouge profond, et peut même changer de teinte suivant l'endroit où se trouve l'observateur.
Le même principe s'applique à la fumée de cigarette, qui nous semble être de couleur gris-bleu, alors que les particules qui la constituent sont jaunes. (Si vous ne me croyez pas, soufflez de la fumée dans un mouchoir ou, si vous avez le courage, regardez les dents d'un gros fumeur). Même lorsqu'il est dégagé, le ciel obéit aux mêmes principes. A l'état gazeux, les molécules présentes dans l'air sont incolores, mais le ciel nous semble bleu. C'est parce que la lumière du soleil rebondit sur ces molécules, qui renvoient seulement vers le sol les longueurs d'onde plus courtes, qui correspondent au bleu.
Parce que les particules microscopiques diffusent la lumière du soleil d'une manière particulière, différente de celle des particules macroscopiques. Si le ciel est saturé de poussières de taille nettement supérieure à la plus grande longueur d'onde de la lumière visible (c'est-à-dire plus de 750 nanomètres), l'atmosphère est de la même couleur que les poussières en question, en l'occurrence, orange.
Mais les particules qui constituaient le nuage de Sydney étaient de taille inférieure à 750 nanomètres. Or la lumière subit une diffraction importante lorsqu'elle heurte des particules aussi petites. Les différentes couleurs qui la composent sont alors divisées et diffusées de manière très complexe et seul un nombre limité de longueurs d'onde parvient jusqu'au sol. Dans ce type de circonstances, que les scientifiques ne comprennent pas encore parfaitement, l'atmosphère peut prendre toutes sortes de couleurs, du bleu au rouge profond, et peut même changer de teinte suivant l'endroit où se trouve l'observateur.
Le même principe s'applique à la fumée de cigarette, qui nous semble être de couleur gris-bleu, alors que les particules qui la constituent sont jaunes. (Si vous ne me croyez pas, soufflez de la fumée dans un mouchoir ou, si vous avez le courage, regardez les dents d'un gros fumeur). Même lorsqu'il est dégagé, le ciel obéit aux mêmes principes. A l'état gazeux, les molécules présentes dans l'air sont incolores, mais le ciel nous semble bleu. C'est parce que la lumière du soleil rebondit sur ces molécules, qui renvoient seulement vers le sol les longueurs d'onde plus courtes, qui correspondent au bleu.
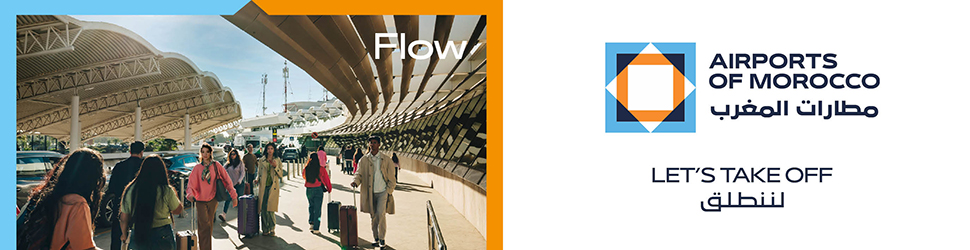


















 Ménopause: Les traitements hormonaux n'augmentent pas la mortalité
Ménopause: Les traitements hormonaux n'augmentent pas la mortalité