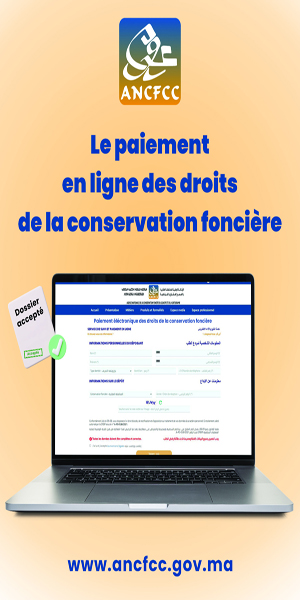-
Un appui de la BAD pour réduire l’usage du cash au Maroc
-
Lancement du programme Solar Rooftop 500 pour le déploiement du solaire en toiture
-
La CGEM et Technopark Morocco scellent un partenariat stratégique en faveur des startups et de l’innovation
-
IDE : Le Maroc conforte son ancrage sur la carte industrielle mondiale
-
Le déficit commercial se creuse à près de 353,15 MMDH en 2025
Ce recul reste relativement modéré si l’on considère que les volumes débarqués ont, eux, enregistré une contraction beaucoup plus prononcée, atteignant 523.765 tonnes, soit une diminution de 16 % en un an. Autrement dit, moins de produits sont arrivés sur le marché, mais leur prix a permis de limiter l’impact financier de cette baisse.
Cette évolution masque cependant des disparités profondes entre les différentes espèces. Les poissons pélagiques, véritable colonne vertébrale de la pêche marocaine, ont été particulièrement touchés. Leur volume s’est effondré de 20 %, pour s’établir à 412.542 tonnes, et leur valeur a reculé de 10 %. La sardine, le maquereau ou encore l’anchois, qui constituent traditionnellement la richesse halieutique du royaume et alimentent massivement les conserveries et les exportations, semblent avoir souffert d’un double phénomène : une pression de pêche accrue et des perturbations environnementales liées au réchauffement des eaux et à la modification des courants marins. Cette situation fragilise toute une filière industrielle, de l’amont à l’aval, et met en évidence la nécessité de revoir en profondeur les politiques de gestion durable des stocks.
D’autres catégories affichent au contraire des résultats remarquables, preuve que la pêche marocaine connaît une transformation progressive. Les coquillages se distinguent avec une progression spectaculaire de 293 % en volume et de 309 % en valeur. Même si les quantités débarquées restent encore limitées, à peine 117 tonnes, la dynamique témoigne d’un regain d’intérêt pour ce produit hautement prisé dans la gastronomie et capable de conquérir des marchés spécialisés. Les algues, quant à elles, poursuivent leur ascension avec une hausse de 16 % en poids et de 24 % en valeur, atteignant près de 6.880 tonnes. Au-delà de leur rôle alimentaire, elles séduisent de plus en plus l’industrie pharmaceutique et cosmétique, confirmant leur potentiel comme nouvelle filière stratégique. Le poisson blanc n’est pas en reste, avec une progression de 13 % en poids et de 12 % en valeur, atteignant 63.064 tonnes. Sa forte demande, tant sur le marché local qu’à l’export, et ses prix plus valorisés expliquent cette bonne performance.
En revanche, les céphalopodes, longtemps considérés comme l’or de la pêche marocaine en raison de la valeur du poulpe et du calmar, connaissent un recul de 16 % en volume et de 3 % en valeur. Les crustacés suivent la même tendance, avec une diminution de 8 % en tonnage et de 2 % en valeur. Ces résultats rappellent que certaines espèces à haute valeur marchande subissent elles aussi les effets conjugués d’une exploitation intensive et de conditions climatiques défavorables.
L’analyse par façade maritime met en lumière un contraste croissant entre Méditerranée et Atlantique. Les ports méditerranéens ont vu débarquer 9.624 tonnes de produits, soit une légère progression de 1 %, pour une valeur de 463,2 millions de dirhams en hausse de 2 %.
Si les volumes y restent modestes, la qualité et la valorisation des espèces expliquent cette performance. À l’inverse, les ports atlantiques, qui concentrent la grande majorité des débarquements, ont enregistré une chute de 17 % des volumes, à 514.141 tonnes, et une baisse de 3 % de la valeur, à 5,68 milliards de dirhams. Cette tendance illustre la vulnérabilité d’un modèle encore très dépendant des pélagiques et donc plus exposé aux fluctuations naturelles et commerciales.
Ces chiffres traduisent une réalité complexe : le secteur halieutique marocain vit une période charnière. Si la baisse des volumes interroge sur la durabilité des ressources et la résilience des filières traditionnelles, l’essor des coquillages, des algues et du poisson blanc révèle aussi une capacité d’adaptation et une diversification bienvenue. Le Maroc, dont la façade atlantique s’étend sur plus de 2.500 kilomètres et qui dispose d’un patrimoine maritime considérable, est confronté à un choix stratégique. Soit il poursuit une logique de volumes, au risque d’épuiser davantage les stocks, soit il accélère la transition vers une pêche plus sélective, plus durable et mieux valorisée.
L’enjeu est d’autant plus crucial que la pêche ne représente pas seulement une activité économique. Elle est aussi un secteur social vital, générant des dizaines de milliers d’emplois directs et indirects et structurant la vie de nombreuses villes côtières. Les chiffres de 2025 rappellent qu’au-delà des variations conjoncturelles, c’est bien l’avenir de tout un écosystème économique, social et environnemental qui se joue dans la gestion de cette ressource.











 Un appui de la BAD pour réduire l’usage du cash au Maroc
Un appui de la BAD pour réduire l’usage du cash au Maroc