Autres articles
-
Le Maroc et l’enjeu de la transformation structurelle du système des droits de l’homme
-
Pourquoi Bank Al-Maghrib tarde-t-elle à baisser son taux directeur ?
-
L’ancrage narratif du changement
-
Edward W. Said: L’intellectuel n’entre pas dans le moule
-
L'intégration est la seule voie possible pour l'Afrique
Il ne s’agit pas de donner à Donald Trump plus d’importance qu’il n’en a mais bien d’inscrire les frasques du candidat républicain aux élections présidentielles américaines dans une perspective plus large.
Isolés, ses propos et ses déclarations n’auraient aucun intérêt; ils en ont, par contre, lorsqu’on considère ce phénomène dans un processus déjà ancien, qui ne fait que s’amplifier, d’érosion et d’affaiblissement de la langue et des valeurs qu’elle nomme.
Dans un entretien sur la perte du sens des mots, Alain de Benoist (La perte du sens des mots) reprend cette parole de Confucius (qui ne date pas d’hier) : «Lorsque les mots perdent leur sens, les gens perdent leur liberté.»
Ce processus de perte du sens pour les mots est double, au moins. Il joue d’abord sur l’appauvrissement quantitatif du lexique; le nombre de mots pour nommer le réel diminue et ceux qui sont conservés et valorisés nourrissent une idéologie et empêchent de nommer (et donc d’affronter) une part de la réalité importante. Ensuite, il galvaude les mots pour les amener à signifier de moins en moins.
Isolés, ses propos et ses déclarations n’auraient aucun intérêt; ils en ont, par contre, lorsqu’on considère ce phénomène dans un processus déjà ancien, qui ne fait que s’amplifier, d’érosion et d’affaiblissement de la langue et des valeurs qu’elle nomme.
Dans un entretien sur la perte du sens des mots, Alain de Benoist (La perte du sens des mots) reprend cette parole de Confucius (qui ne date pas d’hier) : «Lorsque les mots perdent leur sens, les gens perdent leur liberté.»
Ce processus de perte du sens pour les mots est double, au moins. Il joue d’abord sur l’appauvrissement quantitatif du lexique; le nombre de mots pour nommer le réel diminue et ceux qui sont conservés et valorisés nourrissent une idéologie et empêchent de nommer (et donc d’affronter) une part de la réalité importante. Ensuite, il galvaude les mots pour les amener à signifier de moins en moins.
La réduction
du champ lexical
du champ lexical
Quand vous n’avez pas de mot pour désigner une réalité, c’est comme si cette réalité n’existe pas. Dans sa «conférence gesticulée» sur «l’Inculture», Franck Lepage rappelle une étude intéressante menée sur les manuels de management. Dans les années soixante, le mot qui revenait le plus souvent était «hiérarchie». Logique; diriger une entreprise suppose une hiérarchie. D’un point de vue social, une hiérarchie est à la fois ce qui doit, en théorie, permettre un bon fonctionnement (d’une entreprise, d’une administration, d’une association ou d’une armée, voire d’une famille), mais c’est aussi ce contre quoi on peut lutter en cas de désaccord. On se bat contre une hiérarchie ou on essaie d’en gravir les échelons. Au début du vingt-et-unième siècle, la même étude sur les manuels en vigueur à l’époque constate la disparition pure et simple du mot «hiérarchie». Lepage le note, évidemment : cela ne signifie évidemment pas que le sens hiérarchique a disparu et que les patrons, les généraux, les présidents, les petits caporaux (surtout les petits caporaux) n’existent plus. Parallèlement à cette disparition, le mot qui apparaît le plus souvent, désormais, est… «projet». S’il est possible de s’opposer à une hiérarchie, comment s’opposer à un «projet» sans paraître un salaud ? C’est on ne peut plus positif, un projet ! Lepage en rit : bien sûr, on n’y peut rien si c’est toujours le projet du patron…
C’est dans cette mouvance que d’autres opérations lexicales se sont produites, comme le rappelle Alain Deneault dans son récent essai sur La médiocratie. La notion de «métier» – avec ce qu’elle sous-entend de savoir artisanal, de contrôle d’un processus de la source à la réalisation finale – disparaît progressivement dès le dix-neuvième siècle pour laisser la place à «l’emploi», lequel n’est plus tant lié à un savoir particulier qu’à une «location» salariale de sa liberté au profit du capitalisme. Parallèlement, le «politique» va petit à petit s’effacer devant la «gouvernance». Qui n’a pas envie que la «gouvernance», par un bon usage du «gouvernail», permette au navire d’un Etat d’arriver à bon port ? On ne peut pas davantage s’opposer à la gouvernance qu’au projet, d’autant que la gouvernance (la bonne, bien entendu, la «mauvaise» étant «la politique politicienne» ) est le projet commun, depuis que Margaret Thatcher a imposé le dogme du «No Alternative». Une gouvernance qu’il faudrait de plus en plus laisser à des professionnels, des «privés», ainsi que le TTIP est en train de le mettre en place à l’échelle mondiale.
C’est dans cette mouvance que d’autres opérations lexicales se sont produites, comme le rappelle Alain Deneault dans son récent essai sur La médiocratie. La notion de «métier» – avec ce qu’elle sous-entend de savoir artisanal, de contrôle d’un processus de la source à la réalisation finale – disparaît progressivement dès le dix-neuvième siècle pour laisser la place à «l’emploi», lequel n’est plus tant lié à un savoir particulier qu’à une «location» salariale de sa liberté au profit du capitalisme. Parallèlement, le «politique» va petit à petit s’effacer devant la «gouvernance». Qui n’a pas envie que la «gouvernance», par un bon usage du «gouvernail», permette au navire d’un Etat d’arriver à bon port ? On ne peut pas davantage s’opposer à la gouvernance qu’au projet, d’autant que la gouvernance (la bonne, bien entendu, la «mauvaise» étant «la politique politicienne» ) est le projet commun, depuis que Margaret Thatcher a imposé le dogme du «No Alternative». Une gouvernance qu’il faudrait de plus en plus laisser à des professionnels, des «privés», ainsi que le TTIP est en train de le mettre en place à l’échelle mondiale.
Le détournement
des mots
des mots
Cette réduction du champ lexical s’accompagne aussi d’une récupération par l’idéologie ultralibérale des mots qui, pourtant, sont parfois les plus contraires à ses dogmes. «La langue politiquement correcte, le langage fonctionnel des technocrates, les lieux communs médiatiques et les expressions branchées dans lesquels doivent se mouler nos paroles quotidiennes, tout cela contribue à l’édification d’un vaste discours anonyme qui discipline la pensée de tous, tout en faisant taire la singularité de chacun. Dans toute langue de bois, les circonvolutions ont pour fonction de freiner la prise de conscience des enjeux par l’adoucissement des images, outre qu’elles réduisent la compréhension et minimisent les dangers», écrivent justement Isabelle Chevalier et d’autres signataires dans une carte blanche de 2008 (Les mots détournés). Les auteurs dénoncent tout particulièrement la manière dont le vocabulaire progressiste, de gauche, a été récupéré par la droite néolibérale, voire réactionnaire, pour masquer ses objectifs et ses valeurs : «Ainsi la droite s’est approprié la modernité, la réforme, la solidarité, le réalisme, l’internationalisme, espérant faire passer une opération proprement réactionnaire pour une entreprise progressiste». En outre, certains concepts que l’opinion publique, avec la collaboration des médias, accepte comme des vérités conduisent à établir comme d’autres vérités les réalités auxquels ils s’opposent, parfois artificiellement : c’est le cas de «l’altermondialisme» qui conforte l’idée que la «mondialisation» est une réalité incontournable.
Les nazis l’avaient bien compris, qui utilisaient des termes neutres, voire poétiques, pour nommer leur politique d’extermination. «Nuit et brouillard» sonne comme un poème romantique, et Paul Celan ne manquera pas de courage lorsque, après guerre, il décidera de continuer malgré tout à écrire de la poésie en allemand, malgré ce détournement terrible, pour rendre aux mots leur pureté, les nettoyer de ce viol.
La gauche n’est pas en reste; elle a ainsi fait du mot «réactionnaire» une injure terrifiante jetant sans hésitation celui qu’elle vise dans le camp de la droite extrême, voire de l’extrême droite, alors que, dans ses principes mêmes, la révolte est une «réaction» à une situation jugée insupportable.La langue de bois
On en arrive à une langue qui ne signifie plus rien et ne permet plus rien non plus.
Quand les médias, à chaque grève, parlent d’une «prise en otage» des usagers, quand Modrikamen et les autres crypto-fascistes honteux qui n’osent pas dire leur nom parlent «d’invasion» pour désigner les réfugiés qui fuient la guerre et ne demandent rien d’autre que l’application des traités internationaux que nos pays ont signés et dont ils sont les garants, quand on évoque «un bain de sang social», un «tsunami économique», on banalise les problèmes, on réduit la légitimité des conflits, on décrédibilise les partenaires sociaux de tous bords – mais surtout ceux qui pourraient être fondés de contester la dérive ultralibérale de la société.
Lepage toujours, dans la même conférence gesticulée, propose une illustration de cette langue de bois en construisant un discours à l’aide de quelques mots clés, complètement vidés de leur sens.
Les «trumpettes»
du jugement dernier
Les nazis l’avaient bien compris, qui utilisaient des termes neutres, voire poétiques, pour nommer leur politique d’extermination. «Nuit et brouillard» sonne comme un poème romantique, et Paul Celan ne manquera pas de courage lorsque, après guerre, il décidera de continuer malgré tout à écrire de la poésie en allemand, malgré ce détournement terrible, pour rendre aux mots leur pureté, les nettoyer de ce viol.
La gauche n’est pas en reste; elle a ainsi fait du mot «réactionnaire» une injure terrifiante jetant sans hésitation celui qu’elle vise dans le camp de la droite extrême, voire de l’extrême droite, alors que, dans ses principes mêmes, la révolte est une «réaction» à une situation jugée insupportable.La langue de bois
On en arrive à une langue qui ne signifie plus rien et ne permet plus rien non plus.
Quand les médias, à chaque grève, parlent d’une «prise en otage» des usagers, quand Modrikamen et les autres crypto-fascistes honteux qui n’osent pas dire leur nom parlent «d’invasion» pour désigner les réfugiés qui fuient la guerre et ne demandent rien d’autre que l’application des traités internationaux que nos pays ont signés et dont ils sont les garants, quand on évoque «un bain de sang social», un «tsunami économique», on banalise les problèmes, on réduit la légitimité des conflits, on décrédibilise les partenaires sociaux de tous bords – mais surtout ceux qui pourraient être fondés de contester la dérive ultralibérale de la société.
Lepage toujours, dans la même conférence gesticulée, propose une illustration de cette langue de bois en construisant un discours à l’aide de quelques mots clés, complètement vidés de leur sens.
Les «trumpettes»
du jugement dernier
La dernière violence faite au mot – et donc à la pensée et à la démocratie – est celle que prodiguent tous les jours, avec de moins en moins de vergogne, certains politiciens, habitués au pire, à la provocation et au sensationnalisme. Ici, une seule et double règle : frapper toujours plus fort et recourir, si besoin, au double discours après avoir lâché sa bombe.
Quand Nicolas Sarkozy, devant les caméras de la télévision nationale, explique que «les coupables ont été présentés aux juges» (dans l’affaire Clearstream), il bafoue ouvertement le principe de la présomption d’innocence dont il doit être le garant ultime, mais il rencontre la soi-disant «vox populi» selon laquelle «il n’y a pas de fumée sans feu. Quand il traite un citoyen qui refuse de lui serrer la main de «pauv’ con», cette même «vox populi» s’émerveille : en voilà un qui ose parler comme le peuple. Un qui dit tout haut ce que «tout le monde pense tout bas». C’est la ligne de conduite des populistes : la famille Le Pen, Sarkozy, Bart De Wever et même le petit Modrikamen dont nous devons nous féliciter qu’il manque à ce point de charisme, ou encore le tonitruant et richissime Donald Trump qui n’arrête pas de sortir les propos les plus absurdes, les plus idiots, les plus provocants, certains d’être gagnant à tous les coups auprès de l’opinion publique, avec l’assurance d’une couverture médiatique sans commune mesure avec celle dont ils bénéficieraient s’ils tenaient des propos mesurés et intelligents. Et quand l’indignation est trop forte, certains (pas Donald Trump) viennent s’expliquer : ce n’est pas ce qu’ils ont voulu dire, on a détourné leurs propos, on les a cités hors contexte… Leur public cible n’est pas dupe, il sait que la pensée s’accordait avec les mots; quant à la masse des auditeurs, elle est prise d’un doute : «Le pauvre, on ne lui passe rien, on cherche vraiment à l’abattre. Quand on l’entend s’expliquer, cela semble si raisonnable…»
La parole politique s’est décrédibilisée par le galvaudage, par le détournement et par un autre trait de la langue : la fidélité des actes aux mots. L’extrême droite s’est engouffrée dans la brèche en revendiquant une «parole vraie» et des actes en conformité avec celle-ci (ce qui n’est valable qu’aussi longtemps que ses élus ne sont pas aux affaires, car alors on se rend compte que leur gestion est encore plus calamiteuse que celle de leurs prédécesseurs). «Avant de donner la parole», écrivait Alain Finkielkraut dans La défaite de la pensée, «il faut donner la langue». Mais laquelle ? Dans quel état ?
Aujourd’hui, cela ne suffit plus de «donner la langue» ; il faut la régénérer. Rendre aux mots leur sens fort, polémique. Raviver ceux qui ont été enfermés dans les prisons idéologiques parce qu’ils n’auraient pas été «politiquement corrects». Un travail d’Hercule qui semble presque impossible à gagner, tant le populisme fleurit et croît dans l’excès, tant il se nourrit de la dislocation du langage et de la pensée, tant les responsables politiques «traditionnels» sont enfermés, de leur côté, dans un jargon et une rhétorique creuse dont ils ne perçoivent même plus qu’ils ne veulent et ne peuvent plus rien signifier. Et, partant, qu’ils sont impuissants à mener la moindre action concrète sur le réel.
* Romancier, dramaturge
et essayiste belge
Quand Nicolas Sarkozy, devant les caméras de la télévision nationale, explique que «les coupables ont été présentés aux juges» (dans l’affaire Clearstream), il bafoue ouvertement le principe de la présomption d’innocence dont il doit être le garant ultime, mais il rencontre la soi-disant «vox populi» selon laquelle «il n’y a pas de fumée sans feu. Quand il traite un citoyen qui refuse de lui serrer la main de «pauv’ con», cette même «vox populi» s’émerveille : en voilà un qui ose parler comme le peuple. Un qui dit tout haut ce que «tout le monde pense tout bas». C’est la ligne de conduite des populistes : la famille Le Pen, Sarkozy, Bart De Wever et même le petit Modrikamen dont nous devons nous féliciter qu’il manque à ce point de charisme, ou encore le tonitruant et richissime Donald Trump qui n’arrête pas de sortir les propos les plus absurdes, les plus idiots, les plus provocants, certains d’être gagnant à tous les coups auprès de l’opinion publique, avec l’assurance d’une couverture médiatique sans commune mesure avec celle dont ils bénéficieraient s’ils tenaient des propos mesurés et intelligents. Et quand l’indignation est trop forte, certains (pas Donald Trump) viennent s’expliquer : ce n’est pas ce qu’ils ont voulu dire, on a détourné leurs propos, on les a cités hors contexte… Leur public cible n’est pas dupe, il sait que la pensée s’accordait avec les mots; quant à la masse des auditeurs, elle est prise d’un doute : «Le pauvre, on ne lui passe rien, on cherche vraiment à l’abattre. Quand on l’entend s’expliquer, cela semble si raisonnable…»
La parole politique s’est décrédibilisée par le galvaudage, par le détournement et par un autre trait de la langue : la fidélité des actes aux mots. L’extrême droite s’est engouffrée dans la brèche en revendiquant une «parole vraie» et des actes en conformité avec celle-ci (ce qui n’est valable qu’aussi longtemps que ses élus ne sont pas aux affaires, car alors on se rend compte que leur gestion est encore plus calamiteuse que celle de leurs prédécesseurs). «Avant de donner la parole», écrivait Alain Finkielkraut dans La défaite de la pensée, «il faut donner la langue». Mais laquelle ? Dans quel état ?
Aujourd’hui, cela ne suffit plus de «donner la langue» ; il faut la régénérer. Rendre aux mots leur sens fort, polémique. Raviver ceux qui ont été enfermés dans les prisons idéologiques parce qu’ils n’auraient pas été «politiquement corrects». Un travail d’Hercule qui semble presque impossible à gagner, tant le populisme fleurit et croît dans l’excès, tant il se nourrit de la dislocation du langage et de la pensée, tant les responsables politiques «traditionnels» sont enfermés, de leur côté, dans un jargon et une rhétorique creuse dont ils ne perçoivent même plus qu’ils ne veulent et ne peuvent plus rien signifier. Et, partant, qu’ils sont impuissants à mener la moindre action concrète sur le réel.
* Romancier, dramaturge
et essayiste belge
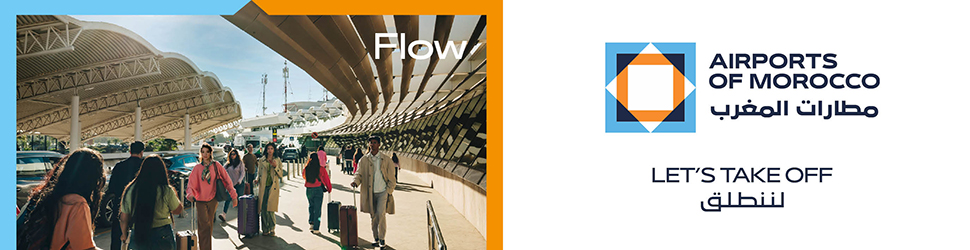





















 Le Maroc et l’enjeu de la transformation structurelle du système des droits de l’homme
Le Maroc et l’enjeu de la transformation structurelle du système des droits de l’homme





