Partout dans le monde, les dettes publiques explosent. Le Maroc n’y échappe pas. La récession sans précédent consécutive à la crise sanitaire du coronavirus a exigé des Etats, dans leurs plans d’urgence, et continue d’exiger d’eux, dans leurs plans de relance, un appui massif aux ménages et aux entreprises. Dans les pays avancés, comme réponses économiques et sociales à cette crise, les pouvoirs publics ont engagé des sommes colossales nécessaires à la mise en œuvre de mesures de tous ordres (fiscales, monétaires, budgétaires : garanties de prêts, reports d’échéance, allocations de chômage, aides directes aux ménages…) représentant l’équivalent de parts élevées de leurs PIB. La hausse vertigineuse des déficits budgétaires qui en a résulté devait normalement se traduire par une explosion de la charge de la dette que ces pays n’auraient pas pu supporter étant, pour la plupart, lourdement endettés. On comprend donc aisément que, c’est sans état d’âme que, tant dans la zone euro, aux Etats-Unis que dans les autres pays de l’OCDE, les banques centrales de ces pays ne se sont pas opposées à la monétisation des dettes publiques, la considérant comme une sorte de «transgression constructive». Monétisation qui, pour faire simple, n’est rien d’autre que l’achat direct ou indirect par une banque centrale de titres financiers émis par l’Etat, le plus souvent avec de longues maturités. Au Maroc, le gouvernement et les autorités monétaires ont été réactifs, audacieux, faisant montre d’un pragmatisme loué par tous. Pragmatisme traduit essentiellement par l’abandon momentané de l’orthodoxie budgétaire et monétaire, devenue, au fil du temps, un sacro-saint cadre de pensée, un quasi-dogme que l’urgence sociale et économique avait rendu caduc. En témoignent la forte hausse du déficit budgétaire et la politique monétaire accommodante de Bank Al-Maghrib (BAM) qui a utilisé tous ses instruments d’intervention (règles prudentielles, taux directeur, réserves obligatoires…) pour desserrer les contraintes pesant sur les banques afin que celles-ci financent plus amplement l’économie réelle. Confronté depuis le début de la crise au surcroît de son endettement consécutif à une forte hausse de son déficit budgétaire, à une dette publique dont la charge annuelle de près de 30 milliards de dirhams (Mdh) représente déjà 12% des dépenses ordinaires du budget général (loi de Finances rectificative 2020 (LFR20)), l’Etat, en réduisant, notamment, les crédits d’investissement de la plupart des ministères, a dû redéfinir ses choix budgétaires pour pouvoir dégager sa contribution de 20 Mdh devant servir de levier au plan de relance de 120 Mdh. Un plan de relance constitué essentiellement de crédits garantis par l’Etat et de fonds aux entreprises dont on sait que les effets sur l’économie mettront du temps à se manifester. L’Etat, en somme, ne va pas injecter plus d’argent directement dans l’économie, ainsi que le montrent les montants quasi inchangés des dépenses globales au titre de la LFR20 et du projet de loi de Finances 2021 (PLF21). Ce faisant, il restreint ses ambitions économiques et sociales, les ajustant à des moyens limités, renonçant ainsi implicitement à relancer l’économie par une augmentation significative de la demande publique. Se contentant de solutions a minima, ainsi que l’atteste, à titre d’exemple, la quasi disparition des aides directes aux ménages dans la LFR20 et dans le PLF21, l’Etat va se trouver dans une situation qui, avec une activité qui ne reprend pas comme prévu, fait craindre des tensions sociales qu’ilserait avisé d’anticiper. Tensions exacerbées par l’accentuation des inégalités qu’illustre particulièrement le retour à la précarité de larges franges d’actifs du secteur informel. Pour les autorités monétaires, le retour rapide à l’orthodoxie financière, incompréhensible pour beaucoup, va s’avérer de plus en plus difficile à justifier, tant sur les plans politique et social, que sur le plan économique ; car jamais la relance de l’activité n’a eu autant besoin de financements publics, ainsi que l’attestent les gigantesques montants mobilisés dans nombre de pays qui ont fortement augmenté leur dépense publique. Moyens mobilisés, pour des parts plus ou moins importantes, grâce à la monétisation de la dette publique. Monétisation dont on peine à comprendre réellement pourquoi elle est exclue, pour le moment du moins, du cadre de pensée de nos responsables. Le PLF21 a prévu d’importantes et ambitieuses mesures en vue de la généralisation de la protection sociale et de l’accélération du plan de relance de l’économie, mais ces mesures, il est important de le rappeler, vont mettre du temps à produire leurs effets. Or, la gravité de la crise appelle une réponse immédiate, à déployer essentiellement sous forme d’aides directes aux ménages et aux entreprises. Pour cela, l’Etat a besoin d’emprunts additionnels substantiels, compensant au moins la perte des 54 Mdh du solde ordinaire du budget général de l’Etat pour 2020 (à savoir le solde positif de 22 Mdh prévu dans la LF20 mais non réalisé, auquel s’ajoute le solde négatif de 32 Mdh de la LFR20). Face à ce défi budgétaire inédit qui, sans que quiconque en soit responsable, a affecté le Maroc, et au vu des expériences de monétisation de la dette publique dans nombre de pays, rien ne s’oppose dans ce contexte de crise à ce que l’Etat compense une partie ou la totalité de ce manque à gagner de 54 Mdh par l’émission, par adjudication sur le marché des titres d’Etat, de bons du trésor (BT) dédiés que rachèterait BAM. Des BT qu’on pourrait appeler « BT corona », afin de bien faire comprendre, aussi bien aux marchés financiers qu’à l’opinion publique, qu’ils’agit d’une facilité exceptionnelle, une opération unique, non renouvelable. Par ailleurs, pour ne pas perturber ces marchés financiers, l’Etat devra emprunter aux taux du marché,sachant qu’il pourra récupérer la charge de sa dette sous forme de dividendes de BAM. Cette proposition de monétisation de la dette peut paraître hérétique, irréaliste… C’est pourtant ce qu’ont fait plusieurs pays avancés que l’on ne pourrait qualifier de laxistes, et que commencent à faire quelques pays émergents comme l’Indonésie. Ce dernier, dont le rupiah n’est pourtant pas une monnaie de réserve comme le dollar ou l’euro, vient de faire racheter par la Banque centrale indonésienne l’équivalent de 27 milliards de dollars, première étape d’un programme de monétisation de sa dette publique, censée financer 64% de sa dette additionnelle pour surmonter la crise. (Oxford Business Group : 21 july 2020). Pourquoi alors, contrairement à ce que font nombre de pays, le Maroc se prive de recourir à la monétisation de sa dette publique, privant ainsi le budget de l’Etat d’importantesressources additionnelles plus que jamais nécessaires pour surmonter la crise ? Les principales raisons avancées à cela sont que cette monétisation risquerait d’une part, de conduire à de hauts niveaux d’inflation, et d’autre part, d’affaiblir la valeur du dirham. - Le risque inflationniste vient immédiatement à l’esprit. Cependant, en cette période de crise, les banques centrales, notamment celles des pays avancés, craignent davantage la désinflation (ralentissement du taux d’inflation) et, encore plus, la déflation (baisse du niveau général des prix). Au Maroc, de fortes tensionsinflationnistes apparaîssent plus qu’improbables quand on sait que, durant cette décennie passée, BAM n’est jamais parvenu à atteindre son objectif cible de 2% d’inflation. Fluctuant entre 0,2% et 1,9%, l’inflation a été en moyenne de 1,2% entre 2009 et 2019. Elle est estimée à 0,4% en 2020 et à 1% en 2021. Des taux que le Haut-Commissariat au plan (HCP), qui appelle depuis des années à « lâcher l’inflation pour relancer la croissance », trouve anormalement bas d’après un benchmark qu’il a fait et où il n’a pas trouvé un seul pays comparable au Maroc réalisant une inflation inférieure à 2%. Cet objectif cible de 2% est devenu, au fil du temps, presque une fin en soi, faisant perdre de vue que c’est aussi une importante variable d’ajustement dansles policy-mix, à savoir cet « art » de combiner politique budgétaire et politique monétaire. Pourtant, une inflation modérée, qu’on postule, dans le cadre de cette réflexion, autour de 4%, aurait le mérite, et non le moindre, d’alléger le poids de l’endettement des agents débiteurs : i) l’Etat, qui pourra desserrerses contraintes budgétaires ; ii) les ménages endettés, dont les crédits habitat et consommation absorbent pas moins du tiers de leurs revenus ; iii) les entreprises, dont les plus endettées ont été particulièrement pénalisées ces dernières décennies du fait d’un taux d’inflation largement inférieur à celui des taux d’intérêt débiteurs. - Le risque d’épuisement rapide des réserves de change est considéré, à juste titre pour le Maroc, comme le risque majeur. Le principal argument avancé est qu’on verrait vite fondre ces réserves car les consommations et investissements additionnels rendus possibles grâce au surcroît de l’endettement public obtenu par monétisation de la dette vont, compte tenu de la forte propension à importer du pays (la valeur des importations représente 41% du PIB, contre 25% en moyenne pour les pays émergents), augmenter les importations plus que les moyens de notre économie ne le permettent. Dit autrement, c’est la crainte que l’enrichissement artificiel consécutif à cet important accroissement de la quantité de monnaie fasse vivre le Maroc au-dessus de ses moyens, avec les conséquences multiples que l’on peut imaginer, en termes, notamment, de dérivesfinancières, de fuite en avant et, in fine, de perte de souveraineté économique. Vision apocalyptique présentée comme épouvantail par ceux qu’une prudence extrême, héritée de la crise financière des années 80, ne pousse pas à explorer les voies offertes par des combinaisons différentes de politiques monétaires, budgétaires et de taux de change, celles conduites notamment en Turquie et en Egypte ; combinaisons qui, malgré lessoubresauts découlant d’une plus grande ouverture de leurs marchés financiers, se sont avérées plus performantes en termes de croissance économique. C’est donc avec les expériences de ces pays que l’infléchissement de la politique monétaire, proposé ici au débat, est à mettre en perspective et non avec celles, très particulières, du Zimbabwe, ou de notre voisin de l’Est, dont la fonte des réserves de change, passées d’un pic de près de 200 M$ en 2014 à 50 M$ prévus fin 2020, s’explique essentiellement par la chute du prix des hydrocarbures, même si le recours massif, depuis 2017, à l’achat direct par l’institut d’émission de titres d’Etat a sans doute contribué, mais dans une mesure difficile à apprécier, à l’épuisement rapide de ces réserves ; [d’après le gouverneur de la Banque centrale d’Algérie, « l’appel de fonds fait par le Trésor en novembre 2018 avait porté l’encours du financement non conventionnel du Trésor auprès de l’institut d’émission à environ 28% du PIB » (www.bank-of-algeria.dz intervention_ apn122018fr). C’est comme si l’Etat marocain avait vendu directement à BAM des bons du Trésor pour l’équivalent de 280 Mdh.] La mise en place des mesures de préférence nationale pour les marchés publics, de barrières non tarifaires (normes techniques, sanitaires…), d’encouragement à la substitution aux importations, traduit la volonté des pouvoirs publics de réduire la sortie de devises. Cependant, le moyen le plus efficace d’infléchir la forte propension à importer du Maroc, est de laisser le dirham s’ajuster librement à l’offre et à la demande du marché des devises. La structure de notre commerce extérieur a bien changé, rendant, tant nos importations que nos exportations, plus sensibles aux prix. C’est le cas notamment des véhicules et des produits finis dont les élasticités par rapport aux prix dans nos échanges extérieurs vont agir mécaniquementsur les volumesimportés et exportés dans le sens respectivement de la baisse et de la hausse. Ce faisant, le glissement du dirham, en renchérissant les prix des biens etservicesimportés, contribuerait plus efficacement à atteindre l’objectif-cible d’inflation de 4% proposé ci-dessus comme hypothèse de travail. Ce que, rappelons-le, l’expansion monétaire toute seule aura du mal à atteindre. Ce serait même, dans l’hypothèse d’une inflexion du policy-mix, le principal levier pour atteindre cet objectif. Cependant, du fait de la flexibilité limitée du régime de change au Maroc, le marché des changes ne joue pas pleinement son rôle de révélateur de la valeur réelle du dirham. En effet, en ajustant le volume des réserves de changes par les emprunts externes en vue de couvrir un minimum de cinq à six mois des besoins du pays en devises, les autorités monétaires, tout en rassurant les marchés, les agences de notation, les opérateurs et partenaires économiques, biaisent, en quelque sorte, le fonctionnement de ce marché. Leur objectif d’assurer une telle disponibilité en offre de devises masque lestensionssur la valeur du dirham devant normalement résulter des déficits structurels de la balance commerciale et du compte des transactions courantes de la balance des paiements. Tensions qui, à défaut de s’exprimer sur le marché actuel, pourraient être prises en considération par les autorités monétaires et donner lieu à la fixation d’un objectif-cible de taux de change du dirham, en cohérence avec l’objectif-cible de l’inflation, à même de rééquilibrer nos comptes extérieurs et de booster la compétitivité ; étant entendu que, si « l’inflation ne se fabrique pas », un renchérissement des prix des importations peut assurément contribuer à atteindre l’objectif-cible de l’inflation. Cependant, les conséquences de ces choix devront être pleinement assumées, sur les plans tant économique, social, que politique. Il est certain que les objectifs-cibles des taux d’inflation et de dépréciation du dirham dont conviendraient éventuellement les autorités monétaires dans une nouvelle policy-mix, vont susciter de fortes résistances et de vifs débats autour de leurs avantages et inconvénients, notamment : i) une moindre incitation à l’épargne financière sachant que, selon le HCP, 3,8% seulement des ménages déclarent épargner une partie de leur revenu ; ii) une baisse, pour les ménages à revenus fixes, du pouvoir d’achat ; baisse momentanée carsupposée s’améliorer par le surcroît de croissance que permet ce nouveau policy-mix ; iii) un renchérissement du coût de la dette externe, à mettre en balance avec les gains des soldes voyages et transferts de la balance des paiements. Des études théoriques et empiriques relatives aux relations entre inflation et croissance divergent dans leurs conclusions. Ce sur quoi la plupart s’accordent, c’est pour dire que si un taux d’inflation stable contribue assurément à accroître le potentiel de croissance d’une économie, un faible taux, et c’est le cas du Maroc, n’est ni un indicateur de la bonne santé d’une économie, ni un gage de sa performance. Ses effets peuvent même être contre-productifs. « Libérées » momentanément d’une certaine orthodoxie budgétaire et financière, les autorités monétaires, avec un peu plus d’audace et de pragmatisme, ont l’occasion aujourd’hui d’utiliser de manière plusingénieuse les variables du taux d’inflation et du taux de change. Maîtrisées, avec des objectifs-cibles que, dans le cadre de cette réflexion, on peut empiriquement se hasarder à estimer (entre 3 et 5% pour le taux d’inflation, et entre 6 et 8 % pour la dépréciation du dirham), elles peuvent être sources de croissance si elles s’inscrivent dans le cadre de cette nouvelle policy-mix dictée, plus par le contexte économique de la crise que par tout autre choix doctrinal. Elles représentent donc une occasion historique d’infléchir la politique économique de notre pays dans un sens plus volontariste, renforcé par le capital confiance en nous et en nos institutions acquis au début de cette crise. Confiance qui s’est délitée depuis, mais qu’on peut renouveler en actionnant tous les instruments de solidarité sociale, donnant de nouveau espoir aux millions de foyers se retrouvant aujourd’hui dansla précarité, en les aidant à rester à flot et à ne pas désespérer. On peut conclure cette réflexion en disant que l’Etat, au début de la pandémie, a fait montre d’une créativité et d’un volontarisme remarqués pour amortir le choc de la crise économique du Covid19. Le plan de relance de l’économie, au vu des grandes incertitudes et de la durée plus longue que prévue de la crise sanitaire, va probablement être revu à la hausse avec des engagements bien plus substantiels du budget de l’Etat. La gravité de la situation ne nous donne pas le choix. La sortie de crise exige une injection de monnaie sousforme d’aides massives de l’Etat aux ménages et aux entreprises, moyen incontournable pour faire redémarrer l’économie. Les montants sans précédent des emprunts nécessaires à cela, devraient logiquement inciter l’Etat à recourir exceptionnellement à la monétisation d’une partie appréciable de ses emprunts additionnels dont il est fait le pari qu’ils seront remboursés par le surcroît de croissance économique qu’ils vont générer. Cette sortie de crise est l’occasion aussi pour le Maroc d’atteindre plus rapidement son objectif d’une plus grande flexibilité du dirham.
Par Mekki Zouaoui Economiste
Universitaire - Faculté de FSJES de Rabat-Agdal
Diplômé des universités de Grenoble-Alpes et de Harvard Kennedy School of Government
Membre du Conseil de surveillance de la BPRK
(Banque régionale populaire Rabat-Kénitra) en tant qu’administrateur indépendant “Bien entendu, je m’exprime ici à titre purement personnel de chercheur-économiste
Universitaire - Faculté de FSJES de Rabat-Agdal
Diplômé des universités de Grenoble-Alpes et de Harvard Kennedy School of Government
Membre du Conseil de surveillance de la BPRK
(Banque régionale populaire Rabat-Kénitra) en tant qu’administrateur indépendant “Bien entendu, je m’exprime ici à titre purement personnel de chercheur-économiste
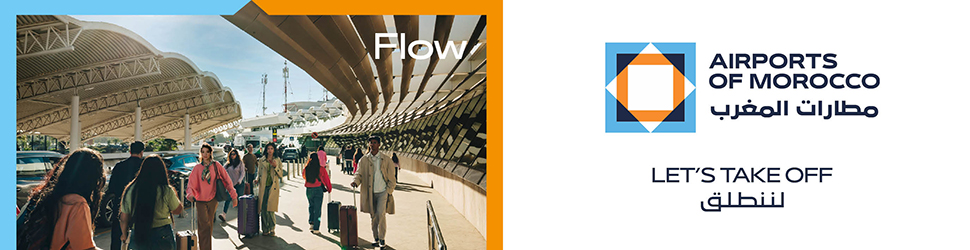




















 Pourquoi Bank Al-Maghrib tarde-t-elle à baisser son taux directeur ?
Pourquoi Bank Al-Maghrib tarde-t-elle à baisser son taux directeur ?





