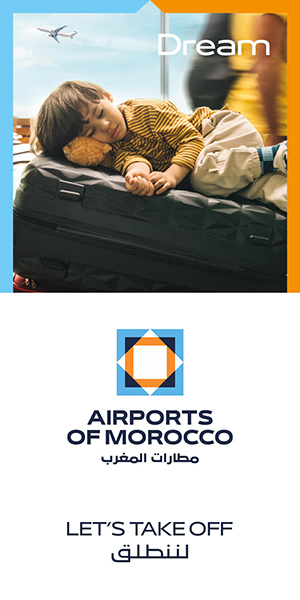Autres articles
-
Le Maroc et l’enjeu de la transformation structurelle du système des droits de l’homme
-
Pourquoi Bank Al-Maghrib tarde-t-elle à baisser son taux directeur ?
-
L’ancrage narratif du changement
-
Edward W. Said: L’intellectuel n’entre pas dans le moule
-
L'intégration est la seule voie possible pour l'Afrique

Rendez-vous est
pris avec l’écrivain
et traducteur
particulièrement
prolixe Faquihi
Sahraoui qui gratifiera pendant tout le mois de Ramadan les
lecteurs de Libé d’une
sélection des meilleures nouvelles arabes
qu’il a lui-même
traduites avec la
maîtrise et la
compétence qu’on lui connaît.
Pour en savoir plus
et en attendant la
première nouvelle avec le premier jour du
Ramadan, Sahraoui Faquihi a bien voulu nous en donner un avant-goût en
expliquant
«l’arbitraire»
de son choix.
«Ce fut d’abord la publication de quelques nouvelles dans un quotidien marocain de langue arabe qui me suggéra ce travail. J’ai commencé par les lire par curiosité. Laquelle curiosité se transforma une semaine après en admiration qui elle même prit la forme au fil des lectures d’un amour. Oui je tombai amoureux de beaucoup de ces nouvelles. J’ai senti alors que cet amour ne pouvait être considéré comme consommé que si je les traduisais, ce qui me força à divorcer d’avec un travail entamé quelques mois plus tôt pour m’atteler à cet ouvrage.
J’eus l’idée au départ de donner comme titre à ce livre «Les meilleures nouvelles de la littérature arabe»; titre que portaient d’ailleurs les nouvelles rencontrées au hasard de la lecture sur les pages du journal cité ci-dessus. Un livre portant ce titre ne manquerait pas de retentir extraordinairement dans une oreille étrangère; et par conséquent, un éditeur ne prendrait pas beaucoup de temps à réfléchir pour le publier. Mais après réflexion, nous avons jugé l’expression d’abord prétentieuse ; car «meilleures nouvelles» par rapport à qui et à quoi ?, puis, cette formulation risque de mécontenter bon nombre de nos auteurs arabes qui, malgré la qualité de leur production, seront vexés qu’aucune de leurs nouvelles n’ait été choisie. Nous avons opté alors pour le titre « Nouvelles appréciées de la littérature arabe ».
Cependant, nous considérons de notre devoir d’avouer aux mécontents potentiels que si certaines de leurs nouvelles ne figurent pas dans ce livre, la faute en revient essentiellement au marché. Souvent, acquérir une nouvelle qui ne se trouve pas dans les librairies n’est pas chose aisée. Bien que théoriquement rien n’est plus facile que d’emprunter un ouvrage. Nous avons couru derrière certains écrits comme on court derrière une denrée rare. Après avoir fait le porte-à-porte des librairies et y avoir cherché désespéramment quelques ouvrages d’auteurs maghrébins sans en trouver trace, nous nous sommes adressés à quelques autorités intellectuelles pensant que leurs bibliothèques ne sauraient souffrir l’absence de certains de ces auteurs. Mais force pour nous était de constater que les intellectuels chez nous comme les politiques -chose curieuse- sont souvent généreux en promesses.
Nous avons contacté les attachés culturels dans les ambassades, aucun d’eux ne daigna donner une réponse à notre quête, fût-elle négative. Nous avons écrit ensuite à des associations ayant un souci culturel (l’Union des écrivains du Maroc, Les amis de la nouvelle, le chef du département de la littérature maghrébine à la faculté d’Oujda et j’en passe… ). Nous eûmes même l’idée d’écrire aux présidents des républiques des trois pays maghrébins car, ils étaient les seuls, pensions-nous ironiquement, à pouvoir nous donner une explication à ce phénomène : comment se fait-il qu’entre deux frontières fermées tout passe (carburant, lait en poudre, aluminium et riz) sauf le livre !.
Lors du dernier Salon du livre à Casablanca, nous avons exposé le cas aux représentants des sociétés d’édition des pays concernés, mais personne parmi eux n’honora ses promesses.
Si donc les auteurs algériens, libyens ou mauritaniens ne sont pas sur la table des matières, c’est que dans nos pays maghrébins ou arabes, les politiciens ne respectent ou ne discernent pas les priorités. Ou bien ils confondent leurs intérêts politicards, leurs visions étriquées, leurs calculs à court terme avec ceux, simples et souvent innocents de leurs peuples.
Le choix des textes
Quel que soit un choix, il reste toujours arbitraire. Si en ce qui nous concerne, nous nous sommes basés sur des critères plutôt thématiques qu’artistiques, peut-être qu’une autre personne aurait opté pour le contraire. Toujours est-il que pour la sélection des produits écrits ci-dessus, nous ne nous sommes pas fiés à notre propre goût. Nous avons opéré une sélection à l’intérieur d’une autre sélection. A partir de trois groupes de nouvelles, le premier relevé d’un journal de langue arabe, de grande audience, le second groupe faisant partie d’une anthologie de nouvelles tunisiennes et le troisième d’un recueil concernant les femmes écrivains d’Arabie Saoudite. Concernant les ouvrages tunisien, saoudien, leurs auteurs affirment avoir passé plus de deux ans à lire et à relire la littérature de ces pays pour enfin en glaner lesdits recueils. Cela ne nous a pas empêchés de nous armer de nos propres outils dont le goût et les tendances pour qu’à notre tour nous ayons un ensemble représentant plus ou moins la crème de la nouvelle en littérature arabe. Nous avons veillé à ce que les thèmes soient d’abord de caractère «humain», qu’ils touchent le maximum de lecteurs (amour, guerre, paix, militantisme démocratie), ensuite à ce qu’ils traitent de problèmes spécifiques au monde arabe, à savoir la condition féminine, les rapports sociaux entre les différents éléments du groupe. Ceci dit, le côté esthétique de l’écriture n’a pas été négligé pour autant».
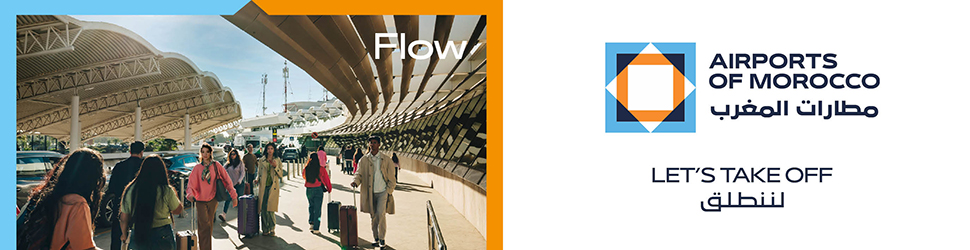


















 Le Maroc et l’enjeu de la transformation structurelle du système des droits de l’homme
Le Maroc et l’enjeu de la transformation structurelle du système des droits de l’homme