Autres articles
-
Les universités chinoises attirent de plus en plus de chercheurs étrangers
-
Le fact-checking fait évoluer les comportements des internautes
-
Mondial 2026 : L’hébergement touristique au cœur des retombées économiques aux Etats-Unis
-
BYD va détrôner Tesla en 2025 sur le tout-électrique
-
Donald Trump, personnalité la plus médiatisée en France en 2025
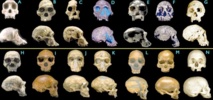
Cartographies de cerveaux déjà publiées, imagerie IRM et logiciels de modélisation informatique : c’est en utilisant cet arsenal high-tech que l’équipe du Pr Marcello Rosa, de l’Ecole des sciences biomédicales de l’Université Monash (Australie), en collaboration avec des chercheurs de l’Université fédérale de Rio de Janeiro (Brésil), a pu comparer certaines régions du cerveau chez 3 espèces de singes - un ouistiti, un singe capucin et un macaque - et chez l’Homme.
Les scientifiques ont constaté, chez les 4 espèces, que deux régions cervicales, le cortex préfrontal latéral et la jonction pariéto-temporale, se sont développées de manière disproportionnée par rapport au reste du cerveau. La première est liée à la planification à long terme, à l’expression de la personnalité, à la prise de décision et à la modification du comportement. La seconde, elle, est liée à la conscience de soi et à la distinction entre soi-même et autrui.
«Nous avons constaté que plus le cerveau est gros, plus ces zones deviennent grandes. Lorsqu’on passe d’un singe de petite taille à un singe de grande taille - du ouistiti au macaque -, elles grossissent par rapport au reste du cortex, et nous voyons la même chose lorsque nous comparons le macaque à l’homme», explique Tristan Chaplin, auteur principal de l’étude.
«Cette tendance va à l’encontre de la vision selon laquelle des mutations humaines spécifiques nous ont donné cet agrandissement de ces régions [du cerveau], nos capacités cognitives et notre comportement avancé, qui sont [en fait] une conséquence de ce qui se passe en termes de développement quand on acquiert un cerveau plus gros», souligne-t-il.
«Nous [scientifiques,] avions observé depuis longtemps que certaines zones du cerveau humain étaient beaucoup plus grandes que ce à quoi l’on pouvait s’attendre connaissant la façon dont le cerveau des singes est organisé. Ce dont personne ne s’était rendu compte, c’est que cet agrandissement sélectif fait partie d’une tendance présente depuis l’aube des primates», conclut à sa manière le Pr Rosa, directeur de l’étude.
Les scientifiques ont constaté, chez les 4 espèces, que deux régions cervicales, le cortex préfrontal latéral et la jonction pariéto-temporale, se sont développées de manière disproportionnée par rapport au reste du cerveau. La première est liée à la planification à long terme, à l’expression de la personnalité, à la prise de décision et à la modification du comportement. La seconde, elle, est liée à la conscience de soi et à la distinction entre soi-même et autrui.
«Nous avons constaté que plus le cerveau est gros, plus ces zones deviennent grandes. Lorsqu’on passe d’un singe de petite taille à un singe de grande taille - du ouistiti au macaque -, elles grossissent par rapport au reste du cortex, et nous voyons la même chose lorsque nous comparons le macaque à l’homme», explique Tristan Chaplin, auteur principal de l’étude.
«Cette tendance va à l’encontre de la vision selon laquelle des mutations humaines spécifiques nous ont donné cet agrandissement de ces régions [du cerveau], nos capacités cognitives et notre comportement avancé, qui sont [en fait] une conséquence de ce qui se passe en termes de développement quand on acquiert un cerveau plus gros», souligne-t-il.
«Nous [scientifiques,] avions observé depuis longtemps que certaines zones du cerveau humain étaient beaucoup plus grandes que ce à quoi l’on pouvait s’attendre connaissant la façon dont le cerveau des singes est organisé. Ce dont personne ne s’était rendu compte, c’est que cet agrandissement sélectif fait partie d’une tendance présente depuis l’aube des primates», conclut à sa manière le Pr Rosa, directeur de l’étude.



















 Les universités chinoises attirent de plus en plus de chercheurs étrangers
Les universités chinoises attirent de plus en plus de chercheurs étrangers




