Autres articles
-
Donald Trump, personnalité la plus médiatisée en France en 2025
-
Malgré les tensions géopolitiques, l'IA chinoise à bas coût fait son trou
-
Les cabines de bronzage triplent le risque de mélanome
-
Pas de lien entre les vaccins et l'autisme
-
La pratique du sport à l'enfance réduit les comportements défiants
Des astronomes ont observé la naissance d'une étoile mettant en évidence une croissance par à-coups, rythmée par de rapides poussées et des jets stellaires de plusieurs milliards de kilomètres, selon une étude publiée mercredi par la revue britannique Nature.
"Ces proto-étoiles (nom scientifique d'un bébé étoile, ndlr) sont si jeunes et si imbriquées les unes dans les autres que, pour l'instant, aucune optique ou télescope à infrarouge n'avait donné une image complète du phénomène et des éjections qui l'accompagnent", a déclaré Adele Plunkett, coauteur de l'étude qui appartenait alors à l'université américaine de Yale.
C'est grâce à ALMA, un radiotélescope géant installé dans les Andes chiliennes qui a la particularité de voir à travers les nuages de poussières d'astres, que les astronomes ont pu décrire cette naissance plutôt mouvementée et très spectaculaire.
Cette observation a eu lieu dans une pouponnière d'étoiles située à 1.400 années-lumière de la Terre.
"Cette jeune proto-étoile subit une succession de périodes de croissance rapide et de calme relatif", a expliqué Adele Plunkett dans un communiqué, rapporté par l’AFP.
Les berceaux des étoiles sont de vastes nuages de gaz froid et de poussières. Au stade de la proto-étoile, les gaz interstellaires se condensent et la fusion nucléaire du coeur de la futur étoile commence.
Sous le double effet de l'énergie dégagée par la matière et du champ magnétique de l'étoile, une partie de la substance est éjectée par les deux pôles de corps céleste.
Ces jets stellaires semblent s'allumer et s'éteindre avec une régularité surprenante, comme un clignotant, semblant passer d'un côté à l'autre de l'astre.
Les données du radiotélescope ont permis de dénombrer 22 jets distincts.
Ils s'étendent jusqu'à 2,46 milliards de kilomètres se mêlant à d'autres au passage. C'est pourquoi, on avait jusqu'ici du mal à les différencier.
"Ces proto-étoiles (nom scientifique d'un bébé étoile, ndlr) sont si jeunes et si imbriquées les unes dans les autres que, pour l'instant, aucune optique ou télescope à infrarouge n'avait donné une image complète du phénomène et des éjections qui l'accompagnent", a déclaré Adele Plunkett, coauteur de l'étude qui appartenait alors à l'université américaine de Yale.
C'est grâce à ALMA, un radiotélescope géant installé dans les Andes chiliennes qui a la particularité de voir à travers les nuages de poussières d'astres, que les astronomes ont pu décrire cette naissance plutôt mouvementée et très spectaculaire.
Cette observation a eu lieu dans une pouponnière d'étoiles située à 1.400 années-lumière de la Terre.
"Cette jeune proto-étoile subit une succession de périodes de croissance rapide et de calme relatif", a expliqué Adele Plunkett dans un communiqué, rapporté par l’AFP.
Les berceaux des étoiles sont de vastes nuages de gaz froid et de poussières. Au stade de la proto-étoile, les gaz interstellaires se condensent et la fusion nucléaire du coeur de la futur étoile commence.
Sous le double effet de l'énergie dégagée par la matière et du champ magnétique de l'étoile, une partie de la substance est éjectée par les deux pôles de corps céleste.
Ces jets stellaires semblent s'allumer et s'éteindre avec une régularité surprenante, comme un clignotant, semblant passer d'un côté à l'autre de l'astre.
Les données du radiotélescope ont permis de dénombrer 22 jets distincts.
Ils s'étendent jusqu'à 2,46 milliards de kilomètres se mêlant à d'autres au passage. C'est pourquoi, on avait jusqu'ici du mal à les différencier.













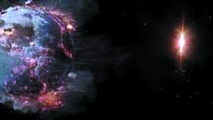








 Donald Trump, personnalité la plus médiatisée en France en 2025
Donald Trump, personnalité la plus médiatisée en France en 2025



