En 1954, Driss Chraïbi publia son roman culte Le Passé simple, à la veille de l’indépendance. Le roman fut bien accueilli partout dans le monde, mais décrié et maudit par la mafia intello du pays. Il relate les vices de la société citadine aliénée en Orient. Elle se dissimule mal face à l’Occident. L’enfant Driss né dans les années 20 vit dans une famille citadine semi-aisée, conservatrice et dévote. Il est envoyé d’abord à l’école coranique où assis avec d’autres gamins, il subit la férule du fquih. Il découvre médusé la pédophilie du maître. Il fréquente ensuite l’école primaire et le lycée français. C’est un contexte moderne et différent sans châtiments. Là, il s’initie à une nouvelle langue et se nourrit d’une autre culture. Les contenus sont axés sur le réel, les faits, la nature, et sur les sciences exactes. La réflexion rationnelle, la liberté d’expression et l’esprit critique en sont les principes. Il les utilise pour égrener avec une ironie mordante les contrastes de sa société.
Driss se révolte donc contre la religion, l’obscurantisme, la culture, la tradition, la société, la famille et le patriarcat. Il perturbe le foyer et pousse à la révolte. Le père, hajj respecté, négociant en thé est décrit comme le seigneur au foyer. Mais dehors, il se dévie et se permet des choses. Chez lui, il invective, frappe, châtie, castre et n’hésite pas à tuer son propre fils qui a osé s’opposer à lui. Pour la famille, la société et le culte en vigueur, le père, chef sacré, a tous les droits sur les siens. Ainsi même choquée, mais sans réagir, la famille enterre. La mère et les femmes de la maison sont des esclaves cloîtrées et au service du bien-être du seigneur le jour. La mère, elle, en plus subit ses caprices de nuit en résignée comme l’exige la religion.
Excédée par ce tyran, source de malheurs (conflits, disputes, fugue, meurtre de son fils Hamid), elle se suicide pour en finir. Son fils aîné le jeune Driss devient bachelier, donc libéré. Dégoûté de l’hypocrisie de la Médina et de la tyrannie paternelle, il s’envole vite pour la France en vue de faire des études d’ingénieur chimiste payées par le seigneur. En rebelle, il changera de carrière après le diplôme. Il erre partout en homme libre. Mais il se jure de rembourser le seigneur, «alors et seulement je me révolterai». C’est ce qu’il a fait dans ses écrits dont Le Passé simple.
Les intellectuels marocains de l’époque sont des fils de notables issus de la bourgeoisie citadine. Ce sont des résistants dans les salons qui se pavanent dans les grands hôtels de l’Orient panarabe. Ils poussent les démunis à la lutte dans les villes et les Atlas. Ils visent le butin colonial et le pouvoir. Ils profitent du contexte international de décolonisation et mettent les pressions politiques. Ils prétendent défoncer « une porte déjà ouverte par l’ONU et la résistance des peuples». Ils divulguent, à dessein, une fausse image du pays. Le Maroc est englouti et emprisonné dans de vieilles traditions et croyances venues de l’Orient lointain.
L’arrivée du roman de Chraïbi Le Passé simple dérange leurs discours et argumentaire opportunistes. Alors ils n’hésitent pas à dénigrer Driss Chraïbi même s’il est de leur classe sociale. Ils le traitent de chien égaré, de collabo avec les colons, de mécréant et d’apostat. Ils l’accusent de vouloir se rapprocher de l’Occident en dévoilant les travers de sa propre société. Ils l’accusent de ridiculiser les clercs de religion (le chérif, le fquih, hajj, les barbus avec chapelets). Ils lui reprochent d’exhiber nos multiples tartufferies (hypocrisies sociales, félonies, mensonges, prières rituelles derrière le seigneur, soumissions, jours de Ramadan passés aux lits, pèlerinages de prestige, aumône islamique non respectée, fausse dévotion).
Ils lui reprochent de ne pas mentir par devoir ! Ils ont le pouvoir à partir de 1956. Ils continuent à blasphémer Driss Chraïbi et à dissimuler le réel. Ils imposent l’arabe comme seule langue acceptable partout et en culture nationale. Ainsi les intellos ne sont pas concurrencés et s’accaparent tout le lectorat. L’Etat a la paix, tout est dissimulé. Ils façonneront sans gêne aucune à l’aune arabo-musulman d’antan les générations à venir.
Ces démagogues, hommes politiques et de lettres interdiront Le Passé simple dans le pays durant 25 ans.
Mais un autre roman de révolte profonde et sincère surgit du réel vécu de la masse des démunis. Il est l’œuvre, le cri de détresse d’un pauvre. Cette fois, c’est un Amazigh sorti des souffrances du Rif. En 1973, au faîte de la crise au Sahara, Mohamed Choukri publie son roman culte : Le Pain nu. Le roman, refusé par toutes les maisons d’éditions marocaines, sera publié en anglais en 1974 et en français en 1980. Interdit au Maroc jusqu’en 2000, il est vite traduit dans plusieurs langues.
Mohamed est né dans les monts du Rif, une décennie après la fin de la glorieuse résistance rifaine. La région connaît dans les années 40 la marginalisation délibérée, l’injustice, la sécheresse, la faim. La famille émigre vers Tanger, au statut international, où tout le monde mange à sa faim, dira la mère. Elle va habiter dans une baraque insalubre dans les collines sordides de la ville où sévit la famine. Le petit Mohamed, affamé, cherche de la nourriture dans les poubelles des chrétiens pour survivre. Un jour, il trouve dans les ordures le cadavre déplumé d’une poule mais sa mère n’en veut pas. Elle ne voudra pas non plus des plantes déracinées des cimetières. Pour elle, le culte passe avant la faim. Pour subvenir aux besoins de sa famille, elle vend des légumes au souk de la ville et peine pour vivre. Le père est souvent absent du foyer. Il est chômeur ou contrebandier. Il est alcoolique et très violent. Il insulte, qualifie son épouse de «pute et fille de pute» et ses enfants de bâtards et de fils de pute. Il frappe sans merci la mère et ses enfants et finit par tuer un de ses fils. Il sera enterré sans problèmes avec la bénédiction du fquih.
La mère est consternée, abattue. Dès lors, Mohamed déteste ce père assassin et voudra le tuer comme Driss dans Le passé simple. Par crainte de soupçons d’infanticide, la famille émigre pour un moment à Tétouan et revient à Tanger. Personne n’inquiète le meurtrier.
Pour les mythes d’Orient, le père a tous les droits sur ses enfants, même celui de les «sacrifier». Dans Le pain nu, l’enfant Mohamed vit à la dérive dans les rues sordides de Tanger. Petit garçon de café, il voit la déchéance de la société musulmane. Etendus sur de sales nattes, les hommes consomment alcools et drogues (haschich, kif). Ils initient l’enfant à la débauche. Pubère et ado, il connaît une sexualité envahissante et succombe à l’onanisme maladif et à la zoophilie. Il émigre pour un moment aux environs d’Oran et travaille comme domestique chez des colons. Mais il se rebelle et revient à Tanger. Il fait divers métiers (cireur, guide, contrebandier). Dans une société empêtrée de tabous, il obéit à ses instincts de violence et ses fantasmes sexuels. Il vit caché avec des prostituées. Ils boivent du vin, fument et se droguent en continu.
Le roman décrit sans concession les bas fonds de Tanger d’antan où règnent la misère, la prostitution, la pédophilie, la félonie, insultes crues.
Le récit contient des passages durs à lire et à supporter qui reflètent une réalité toujours actuelle (la personne qui écrit ces lignes a vécu dans les monts infâmes de Tanger à Dradb en 52/55 et confirme ce réel). Le jeune Mohamed se voit mêlé aux manifestations anticoloniales violentes avec des morts et il est emprisonné. C’est de là que vient sa délivrance. Il prend conscience de son analphabétisme et décide d’entrer à l’école à 20 ans et deviendra même instituteur. Revenu à Tanger, il reprend sa vie d’homme libre.
Le Pain nu écrit par un démuni ayant vécu l’injustice et la pauvreté dénude notre société hypocrite. Le style est direct, sans concession et sans détour souvent associé au tamazight du Rif. Durant trois décennies, tout ce qui vient du Rif est banni par le Makhzen. Ses scribes et clercs vont interdire Le Pain nu au Maroc prétextant protéger la religion, les mœurs. Mais de fait, en vrais démagogues, ils exploitent la sensibilité religieuse des Marocains pour maintenir leurs privilèges. De nos jours, les voilées de corps et barbus d’esprit continuent dans ce sens en disciples surdoués de Machiavel.
Cette année est sorti «Much loved» du réalisateur Nabil Ayouch dont l’actrice principale est une Amazighe militante. Le film décrit le plus vieux métier du monde dans une ville impériale du pays appréciée par les touristes d’Orient et d’Occident. Sans le visionner en entier, les manitous islamistes au pouvoir lui jettent l’opprobre et l’interdisent.
Ils se présentent en indignés et protecteurs de la femme marocaine; alors qu’ils la cloitrent au foyer ou dehors sous des tentes noires, suffocantes. Bien sûr, toute cette mascarade sacrée, autour d’un film simple, se fait à la veille des élections communales. La fin justifie les moyens. Ce qui serait visé ici, c’est d’élargir leur électorat qui s’effrite et s’amoindrit. Le film décrit le quotidien de quatre prostituées dans un pays où il y en a des milliers comme partout ailleurs. Il n’est pas basé sur une histoire bien construite tirée d’un roman ou d’une œuvre connue. Le verbe est cru, violent mais non étranger à notre discours populaire au bus, au marché ou au café. Les termes orduriers en darija nous blessent venant de femmes, mais c’est le discours du milieu.
Les scènes majeures relatent des faits triviaux, réels, connus de tous (dialogue entre prostituées ou avec un gay, départ vers une maison close pour riches d’Orient, danses orientales, alcools, tabac, drogue, simulation de rapports sexuels hétéro et homo, viols). Il met en exergue le fait connu de tous, à savoir que les nantis du Golfe considèrent les jeunes du pays comme leurs concubines et éphèbes de toujours depuis les Omeyyades. Ils revivent ici leurs fantasmes médiévaux.
Le film n’épargne pas les Occidentaux non plus qui profitent sans remords de la misère de nos enfants. Il décrit les déviances de ces touristes délinquants (pédérastie, pédophilie, impuissance, viols, violences, mépris de la jeunesse marocaine). Il révèle que l’argent devient maître de nos corps et âmes. Il essaie d’exorciser un mal qui nous ronge de l’extérieur. Les actrices dont trois du métier paraît-il, sont formidables et humaines.
Elles défendent une cause juste, en empathie avec les prostituées réelles. Elles montrent admirablement que ces marginales de la société hypocrite luttent pour subvenir aux besoins de leurs familles qui les rejettent sous la pression continue de la mafia des voilées et barbus violents qui se substituent souvent à l’Etat pour appliquer leurs lois et semer la panique partout. Le public intoxiqué par les médias islamistes confond les actrices et leurs rôles et s’en prend à elles ! L’actrice principale est dénigrée, insultée (la Chlha boîteuse), car elle a fait son métier de comédienne. Menacée via Internet, elle se serait réfugiée très loin de la terre de ses ancêtres amazighs.
* Professeur universitaire à la retraite
Driss se révolte donc contre la religion, l’obscurantisme, la culture, la tradition, la société, la famille et le patriarcat. Il perturbe le foyer et pousse à la révolte. Le père, hajj respecté, négociant en thé est décrit comme le seigneur au foyer. Mais dehors, il se dévie et se permet des choses. Chez lui, il invective, frappe, châtie, castre et n’hésite pas à tuer son propre fils qui a osé s’opposer à lui. Pour la famille, la société et le culte en vigueur, le père, chef sacré, a tous les droits sur les siens. Ainsi même choquée, mais sans réagir, la famille enterre. La mère et les femmes de la maison sont des esclaves cloîtrées et au service du bien-être du seigneur le jour. La mère, elle, en plus subit ses caprices de nuit en résignée comme l’exige la religion.
Excédée par ce tyran, source de malheurs (conflits, disputes, fugue, meurtre de son fils Hamid), elle se suicide pour en finir. Son fils aîné le jeune Driss devient bachelier, donc libéré. Dégoûté de l’hypocrisie de la Médina et de la tyrannie paternelle, il s’envole vite pour la France en vue de faire des études d’ingénieur chimiste payées par le seigneur. En rebelle, il changera de carrière après le diplôme. Il erre partout en homme libre. Mais il se jure de rembourser le seigneur, «alors et seulement je me révolterai». C’est ce qu’il a fait dans ses écrits dont Le Passé simple.
Les intellectuels marocains de l’époque sont des fils de notables issus de la bourgeoisie citadine. Ce sont des résistants dans les salons qui se pavanent dans les grands hôtels de l’Orient panarabe. Ils poussent les démunis à la lutte dans les villes et les Atlas. Ils visent le butin colonial et le pouvoir. Ils profitent du contexte international de décolonisation et mettent les pressions politiques. Ils prétendent défoncer « une porte déjà ouverte par l’ONU et la résistance des peuples». Ils divulguent, à dessein, une fausse image du pays. Le Maroc est englouti et emprisonné dans de vieilles traditions et croyances venues de l’Orient lointain.
L’arrivée du roman de Chraïbi Le Passé simple dérange leurs discours et argumentaire opportunistes. Alors ils n’hésitent pas à dénigrer Driss Chraïbi même s’il est de leur classe sociale. Ils le traitent de chien égaré, de collabo avec les colons, de mécréant et d’apostat. Ils l’accusent de vouloir se rapprocher de l’Occident en dévoilant les travers de sa propre société. Ils l’accusent de ridiculiser les clercs de religion (le chérif, le fquih, hajj, les barbus avec chapelets). Ils lui reprochent d’exhiber nos multiples tartufferies (hypocrisies sociales, félonies, mensonges, prières rituelles derrière le seigneur, soumissions, jours de Ramadan passés aux lits, pèlerinages de prestige, aumône islamique non respectée, fausse dévotion).
Ils lui reprochent de ne pas mentir par devoir ! Ils ont le pouvoir à partir de 1956. Ils continuent à blasphémer Driss Chraïbi et à dissimuler le réel. Ils imposent l’arabe comme seule langue acceptable partout et en culture nationale. Ainsi les intellos ne sont pas concurrencés et s’accaparent tout le lectorat. L’Etat a la paix, tout est dissimulé. Ils façonneront sans gêne aucune à l’aune arabo-musulman d’antan les générations à venir.
Ces démagogues, hommes politiques et de lettres interdiront Le Passé simple dans le pays durant 25 ans.
Mais un autre roman de révolte profonde et sincère surgit du réel vécu de la masse des démunis. Il est l’œuvre, le cri de détresse d’un pauvre. Cette fois, c’est un Amazigh sorti des souffrances du Rif. En 1973, au faîte de la crise au Sahara, Mohamed Choukri publie son roman culte : Le Pain nu. Le roman, refusé par toutes les maisons d’éditions marocaines, sera publié en anglais en 1974 et en français en 1980. Interdit au Maroc jusqu’en 2000, il est vite traduit dans plusieurs langues.
Mohamed est né dans les monts du Rif, une décennie après la fin de la glorieuse résistance rifaine. La région connaît dans les années 40 la marginalisation délibérée, l’injustice, la sécheresse, la faim. La famille émigre vers Tanger, au statut international, où tout le monde mange à sa faim, dira la mère. Elle va habiter dans une baraque insalubre dans les collines sordides de la ville où sévit la famine. Le petit Mohamed, affamé, cherche de la nourriture dans les poubelles des chrétiens pour survivre. Un jour, il trouve dans les ordures le cadavre déplumé d’une poule mais sa mère n’en veut pas. Elle ne voudra pas non plus des plantes déracinées des cimetières. Pour elle, le culte passe avant la faim. Pour subvenir aux besoins de sa famille, elle vend des légumes au souk de la ville et peine pour vivre. Le père est souvent absent du foyer. Il est chômeur ou contrebandier. Il est alcoolique et très violent. Il insulte, qualifie son épouse de «pute et fille de pute» et ses enfants de bâtards et de fils de pute. Il frappe sans merci la mère et ses enfants et finit par tuer un de ses fils. Il sera enterré sans problèmes avec la bénédiction du fquih.
La mère est consternée, abattue. Dès lors, Mohamed déteste ce père assassin et voudra le tuer comme Driss dans Le passé simple. Par crainte de soupçons d’infanticide, la famille émigre pour un moment à Tétouan et revient à Tanger. Personne n’inquiète le meurtrier.
Pour les mythes d’Orient, le père a tous les droits sur ses enfants, même celui de les «sacrifier». Dans Le pain nu, l’enfant Mohamed vit à la dérive dans les rues sordides de Tanger. Petit garçon de café, il voit la déchéance de la société musulmane. Etendus sur de sales nattes, les hommes consomment alcools et drogues (haschich, kif). Ils initient l’enfant à la débauche. Pubère et ado, il connaît une sexualité envahissante et succombe à l’onanisme maladif et à la zoophilie. Il émigre pour un moment aux environs d’Oran et travaille comme domestique chez des colons. Mais il se rebelle et revient à Tanger. Il fait divers métiers (cireur, guide, contrebandier). Dans une société empêtrée de tabous, il obéit à ses instincts de violence et ses fantasmes sexuels. Il vit caché avec des prostituées. Ils boivent du vin, fument et se droguent en continu.
Le roman décrit sans concession les bas fonds de Tanger d’antan où règnent la misère, la prostitution, la pédophilie, la félonie, insultes crues.
Le récit contient des passages durs à lire et à supporter qui reflètent une réalité toujours actuelle (la personne qui écrit ces lignes a vécu dans les monts infâmes de Tanger à Dradb en 52/55 et confirme ce réel). Le jeune Mohamed se voit mêlé aux manifestations anticoloniales violentes avec des morts et il est emprisonné. C’est de là que vient sa délivrance. Il prend conscience de son analphabétisme et décide d’entrer à l’école à 20 ans et deviendra même instituteur. Revenu à Tanger, il reprend sa vie d’homme libre.
Le Pain nu écrit par un démuni ayant vécu l’injustice et la pauvreté dénude notre société hypocrite. Le style est direct, sans concession et sans détour souvent associé au tamazight du Rif. Durant trois décennies, tout ce qui vient du Rif est banni par le Makhzen. Ses scribes et clercs vont interdire Le Pain nu au Maroc prétextant protéger la religion, les mœurs. Mais de fait, en vrais démagogues, ils exploitent la sensibilité religieuse des Marocains pour maintenir leurs privilèges. De nos jours, les voilées de corps et barbus d’esprit continuent dans ce sens en disciples surdoués de Machiavel.
Cette année est sorti «Much loved» du réalisateur Nabil Ayouch dont l’actrice principale est une Amazighe militante. Le film décrit le plus vieux métier du monde dans une ville impériale du pays appréciée par les touristes d’Orient et d’Occident. Sans le visionner en entier, les manitous islamistes au pouvoir lui jettent l’opprobre et l’interdisent.
Ils se présentent en indignés et protecteurs de la femme marocaine; alors qu’ils la cloitrent au foyer ou dehors sous des tentes noires, suffocantes. Bien sûr, toute cette mascarade sacrée, autour d’un film simple, se fait à la veille des élections communales. La fin justifie les moyens. Ce qui serait visé ici, c’est d’élargir leur électorat qui s’effrite et s’amoindrit. Le film décrit le quotidien de quatre prostituées dans un pays où il y en a des milliers comme partout ailleurs. Il n’est pas basé sur une histoire bien construite tirée d’un roman ou d’une œuvre connue. Le verbe est cru, violent mais non étranger à notre discours populaire au bus, au marché ou au café. Les termes orduriers en darija nous blessent venant de femmes, mais c’est le discours du milieu.
Les scènes majeures relatent des faits triviaux, réels, connus de tous (dialogue entre prostituées ou avec un gay, départ vers une maison close pour riches d’Orient, danses orientales, alcools, tabac, drogue, simulation de rapports sexuels hétéro et homo, viols). Il met en exergue le fait connu de tous, à savoir que les nantis du Golfe considèrent les jeunes du pays comme leurs concubines et éphèbes de toujours depuis les Omeyyades. Ils revivent ici leurs fantasmes médiévaux.
Le film n’épargne pas les Occidentaux non plus qui profitent sans remords de la misère de nos enfants. Il décrit les déviances de ces touristes délinquants (pédérastie, pédophilie, impuissance, viols, violences, mépris de la jeunesse marocaine). Il révèle que l’argent devient maître de nos corps et âmes. Il essaie d’exorciser un mal qui nous ronge de l’extérieur. Les actrices dont trois du métier paraît-il, sont formidables et humaines.
Elles défendent une cause juste, en empathie avec les prostituées réelles. Elles montrent admirablement que ces marginales de la société hypocrite luttent pour subvenir aux besoins de leurs familles qui les rejettent sous la pression continue de la mafia des voilées et barbus violents qui se substituent souvent à l’Etat pour appliquer leurs lois et semer la panique partout. Le public intoxiqué par les médias islamistes confond les actrices et leurs rôles et s’en prend à elles ! L’actrice principale est dénigrée, insultée (la Chlha boîteuse), car elle a fait son métier de comédienne. Menacée via Internet, elle se serait réfugiée très loin de la terre de ses ancêtres amazighs.
* Professeur universitaire à la retraite
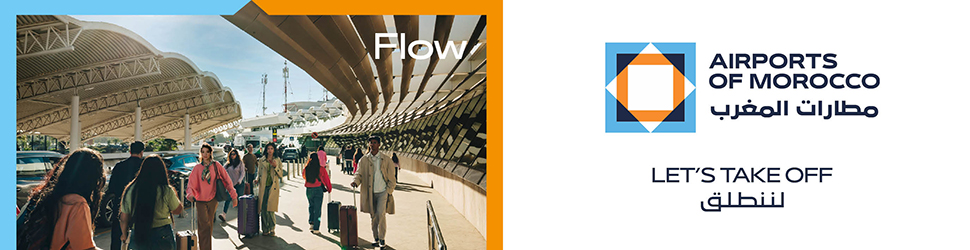




















 Pourquoi Bank Al-Maghrib tarde-t-elle à baisser son taux directeur ?
Pourquoi Bank Al-Maghrib tarde-t-elle à baisser son taux directeur ?





