Autres articles
-
Emmanuel Dupuy : Les Etats-Unis pourraient donc être les véritables facilitateurs d’un rapprochement entre l’Algérie et le Maroc, davantage que la France
-
Moussaoui Ajlaoui : Le grand événement survenu le 31 octobre 2025 rappelle celui du 16 octobre 1975, deux moments charnières séparés par 50 ans d’évolutions
-
Abdelaziz Oussaih : Le Festival Iminig a démontré que la passion, lorsqu’elle s’accompagne de conviction, peut transformer les difficultés en opportunités et les obstacles en passerelles vers l’innovation
-
Dr Adil Ouzzane : La téléchirurgie est une réponse concrète à l’iné gale répartition des compétences médicales
-
Rachid Benzine : La question de l'immigration est avant tout une question ouvrière
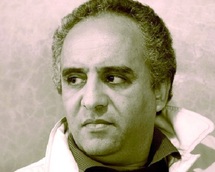
Mohamed Ameskane est natif de Marrakech. Après des études en sociologie et histoire de l’art en France,
il embrasse une
carrière de
journaliste dès 1990 au Libéral, à la Gazette du Tourisme, au Matin du Sahara, à la Gazette du Maroc et, actuellement, à Challenge. Auteur de deux livres sur
les chansons
marocaines et maghrébines, Mohamed Ameskane est coréalisateur
de la série
documentaire «Filbali
oughniyatoun». Entretien.
Libé : Dans votre livre «Chansons maghrébines, une mémoire commune», vous mettez en avant diversité et connexions culturelles et artistiques entre les pays du Maghreb. Qu’est-ce qui a motivé cette expérience enrichissante à plusieurs niveaux ?
Mohamed Ameskane : «Chansons maghrébines, une mémoire commune» est sorti après «30 refrains de la mémoire, tubes de la variété marocaine», inspiré de l’émission «Filbali oughniyatoun». Après l’hommage rendu aux artistes marocains, je voulais continuer avec les Algériens, Tunisiens, Mauritaniens et Libyens. Les deux livres ont été publiés dans le cadre du Festival Awtar, Printemps culturel du Haouz, où des dizaines de tubes marocains et maghrébins ont été revisités par une pléiade de jeunes filles et garçons aux voix prometteuses. De Benguerir, de l’arrière-pays, en compagnie de Mohamed Ennaji, on a voulu transmettre un message ou plutôt mettre en évidence une réalité historique. C’est ce que j’avais noté dans l’introduction du livre, à savoir que ces artistes sont d’une même famille, partageant les expériences, les frustrations et les créations. Ne considéraient-ils pas le Maghreb leur pays et ses peuples leur public ? Difficile de dire qu’un tel genre est originaire d’un pays ou d’un autre. Le chaâbi algérien, qu’on surnommait au départ le Moghrabi, influencé par le malhoun, n’a-t-il pas été importé du Maroc par le cheikh Mustapha Nador ? Le gharnati, qu’on appelait Dzairi, n’a-t-il pas débarqué chez nous, à Oujda et à Rabat, grâce aux maîtres algériens Mohamed Bensmail et Mohamed Benghabrit ? Les chants tunisiens de cheikh Elafrit et de Saliha ne sont-ils pas puisés du répertoire populaire libyen, transmis par les judéo-arabes Moshé J’bali et Asher Mizrahi ? Les frontières au Maghreb restent politiques. Quant à la musique, elle les transgresse et transcende le temps. C’est le message «politique» mais surtout artistique qu’on avait envoyé de Benguerir. N’est-il pas aujourd’hui d’une actualité brûlante?
Vous avez largement contribué à l’organisation et la concrétisation de projets culturels dans la ville des Alizés. Après une rupture de deux ans, comment évaluez-vous ce parcours ? Et où est-ce que vous positionnez les acquis de ces réalisations dans les contextes culturel, social et institutionnel de la ville?
J’ai donné un coup de main à mes amis Mohamed Ennaji et André Azoulay. On a conçu deux éditions mémorables du Festival des Andalousies atlantiques avec des hommages vibrants à Abdessadek Chekara et Samy Elmaghribi où l’ensemble de la programmation a été façonné autour de leurs personnages et héritages avec la publication de deux livrets. Moments gravés dans la mémoire des festivaliers et des Souiris. Comment oublier les fusions Thami Harrak et Haim Louk, Estrella Morente, El Gusto, dont le film de Safinez Bousbia sort en France, le DVD et le livre attendus pour le mois de juin? Comment oublier El Librejano, Pasion Vega, Benomar Ziani et le grand Paco Ibanez qui s’asseyait aux dernières rangées avec le petit peuple d’Essaouira? Pour les Alizés, je reste fier du documentaire de 52 minutes, «L’envol des mouettes», que j’avais coréalisé avec Mohamed Minkhar et qui a été diffusé par la première chaîne nationale. Une trace de l’un des festivals de musique classique les plus originaux à travers le monde arabe! Les manifestations continuent avec d’autres responsables à qui je ne peux que souhaiter bon vent…des Alizés!
Dans votre émission «Filbali oughniyatoun, vous avez revivifié un patrimoine musical en voie d’oubli par la génération actuelle. Comment évaluez-vous cette expérience sur les plans technique, artistique, et surtout humain?
Il faut être à la fois fou et passionné pour s’engager dans un tel projet ! Il nous a fallu des années, car ce fut un travail d’équipe, pour concevoir et finaliser l’idée, retrouver les témoins et surtout les archives. Des journées et des nuits de stress, de quête et de visionnage de centaines de cassettes. Au bout, il y a la satisfaction et la jouissance du travail bien accompli. L’émission ne cesse d’être rediffusée et d’être plagiée ! Cela reste une manière de revivifier une part intégrante de notre mémoire, comme vous le dites, de contribuer à l’écriture de son histoire, de donner du plaisir aux Marocains à travers une programmation à la fois culturelle et attrayante. Le résultat est que le public en demande. Ce travail documentaire a été complété par l’édition dudit livre, inspiré de l’émission.
Vous avez également fait vos premières armes dans la presse depuis 1990. Ne pensez-vous pas que la culture a perdu espace, qualité et attractivité depuis plusieurs années dans la presse écrite?
Il fut un temps où la culture avait sa place dans le champ médiatique national. Une effervescence liée à un contexte bien précis avec ses débats, suppléments riches des quotidiens et publication d’une infinité de revues. Les temps ont changé avec les nouvelles technologies, la mondialisation et le recul de l’écrit et de la lecture face à la Toile avec les mordus du net, du Facebook et autres Twitter, entre autres. Mais la culture, car c’est ce qui reste en fin de compte, est au centre du débat. La culture est le moyen de se «positionner» et de donner sens aux fracas du monde.
Des projets à venir?
Pleins ! Je continue mes recherches sur les thématiques de la chanson marocaine, maghrébine et arabe, la chanson et la littérature judéo-marocaines…
il embrasse une
carrière de
journaliste dès 1990 au Libéral, à la Gazette du Tourisme, au Matin du Sahara, à la Gazette du Maroc et, actuellement, à Challenge. Auteur de deux livres sur
les chansons
marocaines et maghrébines, Mohamed Ameskane est coréalisateur
de la série
documentaire «Filbali
oughniyatoun». Entretien.
Libé : Dans votre livre «Chansons maghrébines, une mémoire commune», vous mettez en avant diversité et connexions culturelles et artistiques entre les pays du Maghreb. Qu’est-ce qui a motivé cette expérience enrichissante à plusieurs niveaux ?
Mohamed Ameskane : «Chansons maghrébines, une mémoire commune» est sorti après «30 refrains de la mémoire, tubes de la variété marocaine», inspiré de l’émission «Filbali oughniyatoun». Après l’hommage rendu aux artistes marocains, je voulais continuer avec les Algériens, Tunisiens, Mauritaniens et Libyens. Les deux livres ont été publiés dans le cadre du Festival Awtar, Printemps culturel du Haouz, où des dizaines de tubes marocains et maghrébins ont été revisités par une pléiade de jeunes filles et garçons aux voix prometteuses. De Benguerir, de l’arrière-pays, en compagnie de Mohamed Ennaji, on a voulu transmettre un message ou plutôt mettre en évidence une réalité historique. C’est ce que j’avais noté dans l’introduction du livre, à savoir que ces artistes sont d’une même famille, partageant les expériences, les frustrations et les créations. Ne considéraient-ils pas le Maghreb leur pays et ses peuples leur public ? Difficile de dire qu’un tel genre est originaire d’un pays ou d’un autre. Le chaâbi algérien, qu’on surnommait au départ le Moghrabi, influencé par le malhoun, n’a-t-il pas été importé du Maroc par le cheikh Mustapha Nador ? Le gharnati, qu’on appelait Dzairi, n’a-t-il pas débarqué chez nous, à Oujda et à Rabat, grâce aux maîtres algériens Mohamed Bensmail et Mohamed Benghabrit ? Les chants tunisiens de cheikh Elafrit et de Saliha ne sont-ils pas puisés du répertoire populaire libyen, transmis par les judéo-arabes Moshé J’bali et Asher Mizrahi ? Les frontières au Maghreb restent politiques. Quant à la musique, elle les transgresse et transcende le temps. C’est le message «politique» mais surtout artistique qu’on avait envoyé de Benguerir. N’est-il pas aujourd’hui d’une actualité brûlante?
Vous avez largement contribué à l’organisation et la concrétisation de projets culturels dans la ville des Alizés. Après une rupture de deux ans, comment évaluez-vous ce parcours ? Et où est-ce que vous positionnez les acquis de ces réalisations dans les contextes culturel, social et institutionnel de la ville?
J’ai donné un coup de main à mes amis Mohamed Ennaji et André Azoulay. On a conçu deux éditions mémorables du Festival des Andalousies atlantiques avec des hommages vibrants à Abdessadek Chekara et Samy Elmaghribi où l’ensemble de la programmation a été façonné autour de leurs personnages et héritages avec la publication de deux livrets. Moments gravés dans la mémoire des festivaliers et des Souiris. Comment oublier les fusions Thami Harrak et Haim Louk, Estrella Morente, El Gusto, dont le film de Safinez Bousbia sort en France, le DVD et le livre attendus pour le mois de juin? Comment oublier El Librejano, Pasion Vega, Benomar Ziani et le grand Paco Ibanez qui s’asseyait aux dernières rangées avec le petit peuple d’Essaouira? Pour les Alizés, je reste fier du documentaire de 52 minutes, «L’envol des mouettes», que j’avais coréalisé avec Mohamed Minkhar et qui a été diffusé par la première chaîne nationale. Une trace de l’un des festivals de musique classique les plus originaux à travers le monde arabe! Les manifestations continuent avec d’autres responsables à qui je ne peux que souhaiter bon vent…des Alizés!
Dans votre émission «Filbali oughniyatoun, vous avez revivifié un patrimoine musical en voie d’oubli par la génération actuelle. Comment évaluez-vous cette expérience sur les plans technique, artistique, et surtout humain?
Il faut être à la fois fou et passionné pour s’engager dans un tel projet ! Il nous a fallu des années, car ce fut un travail d’équipe, pour concevoir et finaliser l’idée, retrouver les témoins et surtout les archives. Des journées et des nuits de stress, de quête et de visionnage de centaines de cassettes. Au bout, il y a la satisfaction et la jouissance du travail bien accompli. L’émission ne cesse d’être rediffusée et d’être plagiée ! Cela reste une manière de revivifier une part intégrante de notre mémoire, comme vous le dites, de contribuer à l’écriture de son histoire, de donner du plaisir aux Marocains à travers une programmation à la fois culturelle et attrayante. Le résultat est que le public en demande. Ce travail documentaire a été complété par l’édition dudit livre, inspiré de l’émission.
Vous avez également fait vos premières armes dans la presse depuis 1990. Ne pensez-vous pas que la culture a perdu espace, qualité et attractivité depuis plusieurs années dans la presse écrite?
Il fut un temps où la culture avait sa place dans le champ médiatique national. Une effervescence liée à un contexte bien précis avec ses débats, suppléments riches des quotidiens et publication d’une infinité de revues. Les temps ont changé avec les nouvelles technologies, la mondialisation et le recul de l’écrit et de la lecture face à la Toile avec les mordus du net, du Facebook et autres Twitter, entre autres. Mais la culture, car c’est ce qui reste en fin de compte, est au centre du débat. La culture est le moyen de se «positionner» et de donner sens aux fracas du monde.
Des projets à venir?
Pleins ! Je continue mes recherches sur les thématiques de la chanson marocaine, maghrébine et arabe, la chanson et la littérature judéo-marocaines…


















 Emmanuel Dupuy : Les Etats-Unis pourraient donc être les véritables facilitateurs d’un rapprochement entre l’Algérie et le Maroc, davantage que la France
Emmanuel Dupuy : Les Etats-Unis pourraient donc être les véritables facilitateurs d’un rapprochement entre l’Algérie et le Maroc, davantage que la France



