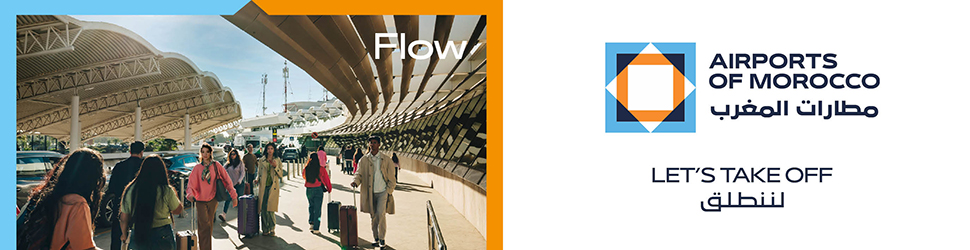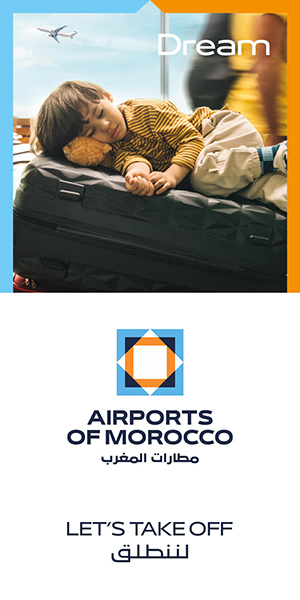|
|||||||
Economie - 24/02/2026
La Convention du travail maritime a 20 ans
|
Elle a une journée internationaleLa démocratie … ou quand on a besoin des peuples !Mustapha Elouizi
Lundi 15 Septembre 2014

La démocratie. Voilà un concept qui a fait couler beaucoup d’encre et de sang. Tout le monde en veut dans l’absolu. Rares ceux et celles qui en saisissent la valeur. Le mécanisme devant être huilé, beaucoup le fuient pour d’autres formes moins payantes. Depuis que les Grecs l’ont conçu comme étant un mode de gouvernance pour le peuple par le peuple, l’on ne cessa de l’altérer, voire de le dénaturer. Et pour cause, il freine les envies, les caprices et différentes formes de fantaisies … Les Nations unies lui ont consacré une Journée internationale célébrée 15 septembre de chaque année. Il y a de quoi, puisque l’on se le rappelle uniquement lorsqu’on a besoin des peuples. Et sans souvent s’en rendre compte, les peuples paupérisés ont dû mener des luttes acharnées pour bénéficier des retombées sociales et économiques, mais aussi politiques. D’ailleurs, le Petit Robert en donne la définition suivante : «Doctrine politique d’après laquelle la souveraineté doit appartenir à l’ensemble des citoyens …». Ses grands principes ne sont plus à présenter : l’égalité des citoyens, la liberté de conscience et d’expression, le suffrage universel, la justice sociale, la séparation des pouvoirs, le droit des minorités et le respect des différences … La démocratie reste le dénominateur commun de toutes les dynamiques politiques et sociales ayant mis l’homme au centre de leur projet. Les philosophes des Lumières lui avaient donné son aura. Ils l’ont glorifiée et appelé à sa renaissance. La Révolution française en constitua l’une des premières véritables tentatives de mise en œuvre. Le socle était la Déclaration universelle des droits de l’Homme et du citoyen. La démocratie était et reste ainsi au centre de tous les débats, des polémiques et des réflexions… Une seule donne en changeait à chaque fois la forme, le contenu et le principe: comment traduire des Grecs anciens ? Se mettre au service du peuple avait, en effet, pris à chaque fois un sens différent, une appréhension différente et un contenu différent. Philosophes, idéologues ou encore politiques ne se sont jamais mis d’accord sur un mode unique ni pour une seule application. Certes, les différences des structures sociales, du contexte culturel et civilisationnel imposaient souvent une approche différente d’agir et d’en cristalliser la teneur. Mais, l’envie des despotes, des dictateurs et des fascistes, oeuvrant eux aussi au nom du peuple et pour le peuple, éloignait les rouages de la gestion politique des modalités et soubassements de la démocratie. Et c’est ainsi qu’on l’a conjuguée à tous les temps et mêlée à tous les genres: démocraties chrétienne, libérale, populaire, socialiste, fasciste… Depuis l’agora, le peuple était censé agir et exercer sa souveraineté dans une démocratie directe. Après, on avait créé des modes d’organisation où le peuple n’était qu’une simple masse composite inféodée au pouvoir du comité central, des lobbies, d’un roi, d’une junte militaire, d’institutions financières … Bien évidemment, la mise en place d’institutions dites démocratiques, ne s’était pas accompagnée automatiquement d’une vie réellement démocratique. C’était aussi une manière de camoufler les pires atrocités … En démocratie, c'est le peuple qui choisit ses dictateurs, dit-on, car c’est bien là le nom qu’on donne au peuple lorsqu’on a besoin de lui ! Lu 1188 fois
Nouveau commentaire :
Dans la même rubrique :
Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe |
|
|||||
|
|||||||