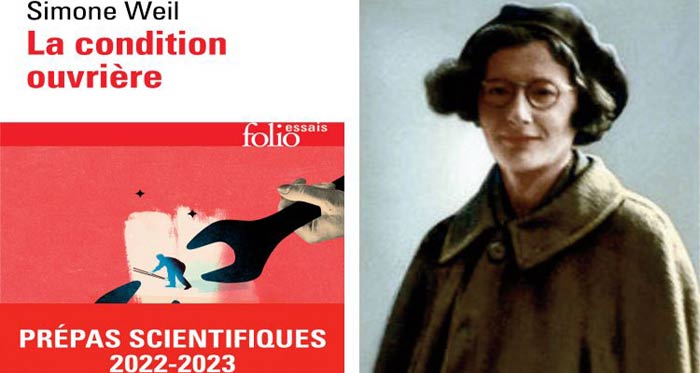
Chercher du travail ou se plaindre du travail, c’est actuellement le quotidien de la plupart des gens. Le programme des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles de l’année prochaine (2022-2023) propose un thème intéressant, au cœur de la vie et des préoccupations de tout le monde. Le thème du travail sera étudié à travers trois œuvres que sont Les Géorgiques de Virgile, La Condition ouvrière de Simone Weil et Par-dessus bord de Michel Vinaver. Les étudiants auront donc la chance d’accéder à toute une littérature variée (‘chant latin’ pour le livre de Virgile, théâtre, essai philosophique) qui concerne directement leur avenir : le travail. La variation des genres s’accompagne d’une variation d’époques. A côté du vingtième siècle où prend place une philosophe complétement engagée, se trouve l’un des grands classiques de la littérature latine, Virgile. Quelle chance d’avoir à étudier le travail avant de travailler !
Dans les lignes qui suivront, j’aborderai quelques pistes de réflexions (quelques idées essentielles) concernant le livre de Simone Weil, à savoir La Condition ouvrière, dans une tentative de cerner certaines problématiques fondamentales qui traversent l’œuvre de l’auteure.
Ce livre est publié à titre posthume en 1951. Il contient des lettres et des articles de Weil rassemblés par Albert Camus et qui ont pour point commun la condition des ouvriers, la conception de la philosophe du travail et quelques solutions qu’elle propose à ce sujet. Simone Weil s’est engagée dans quelques usines pour connaître de près les conditions du travail et pour préparer un essai sur le sujet.
A la lecture de Simone Weil, on dirait que tout le problème tourne autour de l’idée de la «déshumanisation». Le travail est certes une valeur essentielle, une activité vitale dont on ne pourrait se détacher, il est même défini comme étant la grandeur de l’homme. Dans un livre intitulé La Pesanteur de la grâce, Weil avance que «la grandeur de l’homme est toujours de recréer sa vie». Pour elle, c’est le travail qui permet l’accès à cette recréation qui mène à la grandeur. Cependant, le travail est servile et avilissant. Dans l’une des premières lettres inscrites dans La Condition ouvrière, Simone Weil résume son projet en disant : «j’ai beaucoup souffert de ces mois d’esclavage, mais je ne voudrais pour rien au monde ne pas les avoir traversés. Ils m’ont permis de m’éprouver moi-même et de toucher du doigt tout ce que je n’avais pu qu’imaginer. J’en suis sortie bien différente de ce que j’étais quand j’y suis entrée – physiquement épuisée, mais moralement endurcie». (p.56) [toutes les indications des pages se réfèrent à l’édition GF, prescrite au programme] La phrase de Weil montre bel et bien que son ouvrage est une sorte de témoignage qui a pour objectif de rendre compte d’une expérience douloureuse dont on ne sort pas indemne, celle de l’esclavage. Le mot sonne fort au début du livre mais il va permettre d’introduire toute une argumentation pour prouver l’aspect servile du travail à l’usine.
En effet, l’auteure ne cesse de reprendre l’idée de l’esclavage et de la servilité au cours des lettres adressées aux amis ou au directeur des usines Rosières. Dans un processus de déshumanisation, le travail manuel et machinal aux usines porte atteinte à l’intelligence, la liberté et la santé de l’ouvrier. Celui-ci se trouve incapable de penser à cause de la monotonie et l’épuisement qu’engendrent les tâches rebutantes du travail. «Quand je dis machinal, ne croyez pas qu’on puisse rêver à autre chose en le faisant, encore moins réfléchir». (p.71) Pour la philosophe, c’est ce qui rend la « situation tragique». A travers cette expérience vécue dans une usine, Simone Weil décrit minutieusement les rituels avilissants du travail. L’ouvrier devient une espèce de machine, un objet qui n’a qu’à obéir aux ordres : «Cette situation fait que la pensée se recroqueville, se rétracte, comme la chair se rétracte devant un bistouri. On ne peut pas être conscient». (p.61) La docilité des ouvriers s’apparente pour Weil à une «seconde nature», pour reprendre les mots d’un philosophe qui ne peut ne pas venir à l’esprit en lisant le livre : Etienne de La Boétie. Cette seconde nature est le résultat direct de l’oppression. Pour Weil, la subordination et son corrélatif l’oppression mènent l’ouvrier à une soumission irrésistible : «J’ai tiré en somme deux leçons de mon expérience, dit Weil, la première, la plus amère et la plus imprévue, c’est que l’oppression, à partir d’un certain degré d’intensité, engendre non une tendance à la révolte, mais une tendance presque irrésistible à la plus complète soumission». (p.102) Même la philosophe qui a entamé l’expérience de l’usine pour des raisons de militantisme avoue qu’elle s’est complétement convertie à la docilité. Que dire alors des simples ouvriers qui, pour la plupart, souffrent d’ignorance comme le déclare la philosophe. On retrouve ici une idée marxiste : l’aliénation du travail est irréfragable.
Selon les dires de l’auteure, tout travail manuel est inéluctablement lié à la servitude : «il y a dans le travail des mains et en général dans le travail d’exécution, qui est le travail proprement dit, un élément irréductible de servitude que même une parfaite équité sociale n’effacerait pas» (p.261) C’est justement cette corrélation entre la servitude et le travail qui rend la tâche difficile à la philosophe militante. Comment éviter l’inévitable ? Comment humaniser ce qui se définit par l’esclavage ?
Pour Weil, l’ouvrier est toujours conduit à comprendre qu’il ne compte pour rien, qu’il ne vaut rien et que ses gestes automatiques n’ont aucune valeur. Cette sensation humiliante fait que le travailleur se sous-estime et se conçoit comme une chose : «le subordonné joue presque le rôle d’une chose maniée par l’intelligence d’autrui. Telle était ma situation». (p.123) Comme le répète Simone Weil, le problème ne réside pas exactement dans la subordination (elle est quand même nécessaire), mais dans ce sentiment d’inintelligence, voire d’insignifiance, qu’ont les ouvriers de se voir dépossédés de toute initiative, de toute création, de tout esprit critique. L’ouvrier travaille sans savoir à quoi aboutit sa tâche. La division des tâches à l’usine abrutit l’ouvrier. Il passe des heures à effectuer une même tâche qui est une petite étape de la fabrication d’un objet. Cette situation lui donne l’impression de ne rien accomplir d’intéressant parce qu’il n’a pas accès au produit final pour y voir sa propre touche. Faire une seule tâche et passer parfois de l’une à l’autre sans savoir pourquoi donnent l’impression qu’il s’agit d’obéir à des ordres arbitraires de la part des supérieurs. Ce sentiment de l’arbitraire est selon Weil «incompatible avec la dignité humaine» (p.130) Parmi les concepts fondamentaux de Simone Weil sont «la nécessité» et son opposé «la finalité». L’ouvrier ne travaille pas pour un but mais parce qu’il a besoin de travailler pour survivre : «c’est le fait qu’il est gouverné par la nécessité, non par la finalité. On l’exécute à cause d’un besoin, non en vue d’un bien». (p.261). Dans La Pesanteur de la grâce, l’auteure le formulera plus clairement : «Faire effort par nécessité et non pour un bien - poussé, non attiré – pour maintenir son existence telle qu’elle est – c’est toujours servitude». Ainsi, pour humaniser le travail, il faut des efforts à finalité et non des efforts par nécessité.
Subordination donc, ignorance, servitude et arbitraire. Telles sont, entre autres, les souffrances des ouvriers. Cette condition est apparemment d’une laideur inouïe. Ajoutons donc la laideur.
Que faut-il faire alors ? Les textes de Simone Weil ne se limitent pas à la simple description des faits. La philosophe militante, tout en avouant qu’elle rêve d’un idéal difficile à atteindre (le mot idéal est aussi fondamental parce qu’il rend compte d’un réalisme lucide de la part de l’auteure), présente quelques «solutions» pour amoindrir les douleurs des ouvriers. En nous référant aux souffrances susnommées, nous pouvons énoncer les issues proposées par Weil comme suit : moins de subordination, moins d’ignorance, moins de servitude, moins d’arbitraire et moins de laideur. Il s’agit en somme d’humaniser le travail.
Plutôt collaboration que subordination, semble clamer Simone Weil. Dans les lettres adressées à Victor Bernard, directeur des usines Rosières, l’auteure formule ce vœu humaniste en disant : «En ce qui concerne les usines, la question que je me pose […] est celle d’un passage progressif de la subordination totale à un certain mélange de subordination et de collaboration, l’idéal étant la coopération pure». (p.112) Simone Weil reproche au directeur de l’usine de confondre pouvoir (qui est une qualité humaine) et toute-puissance (qualité divine). Les ouvriers sont traités comme des serfs alors qu’ils devraient être vus comme des humains. Il est donc nécessaire de passer de la servilité à la coopération. Si les patrons retrouvent leur statut humain, ils se conduiront d’homme à homme avec les ouvriers, ce qui est le principe même d’une collaboration. Et par conséquent, le travail s’humanisera. L’humanisation du travail se perçoit dans le choix même des mots, le préfixe «co-» (dans collaboration et coopération) indique un rapport d’échange et d’égalité et éradique toute subordination.
Plutôt connaissance qu’ignorance. Simone Weil dénonce l’ignorance des ouvriers, accentuée par l’abrutissement qui provient du travail rébarbatif et acharné. Il est inconcevable, pour Weil, d’humaniser le travail sans une certaine éducation : «Si […] l’ignorance des ouvriers arrivait à être reconnue d’un commun accord comme constituant l’un des obstacles à une organisation plus humaine, ne serait-ce pas là la seule introduction possible à une série d’articles de véritable vulgarisation ?» (p.104) La proposition est encore adressée au directeur des usines Rosières, Victor Bernard. Weil précise qu’il est de sa responsabilité de diminuer l’ignorance des ouvriers qui engendre leur sentiment de «ne compter pour rien». La philosophe rêve d’un travail qui puisse «constituer une éducation» (p.119) Pour ce faire, elle se propose de lancer un projet de vulgarisation, elle souhaite rendre les chefs-d’œuvre de la poésie grecque «accessibles aux masses populaires», les jugeant «plus proches du peuple» que «la littérature française classique et moderne» (p.127) Pour Weil, cette littérature grecque, profondément ancrée dans le politique, est en passe de permettre aux ouvriers d’en tirer des leçons de vie sur le plan professionnel. Elle propose Antigone de Sophocle où le personnage éponyme est l’exemple de l’opprimé, l’isolé, le souffrant qui arrive à contester les ordres, à désobéir, à se révolter. Weil demande à Victor Bernard de lui permettre de publier dans le journal de l’usine ses lectures de la littérature grecque pour que les ouvriers en profitent. En vue de valoriser le travail des ouvriers, ceux-ci doivent comprendre, selon l’auteure, «qu’ils fabriquent des objets qui sont appelés par des besoins sociaux, et qu’ils ont un droit limité, mais réel, à en être fiers». (p.243) C’est la seule façon qui permettrait le passage de la nécessité à la finalité. L’ouvrier se sent utile et supporte mieux les souffrances du travail. Tout est donc question de conscience, de connaissance.
Plutôt liberté que servitude. Simone Weil a la conviction que le travail manuel peut combiner entre la rigueur et la liberté. L’auteure préconise «le pouvoir créateur du travailleur» (p.144) Celui-ci devrait avoir le monopole et prendre l’initiative. Simone Weil déplore le fait que l’ouvrier n’est qu’une «chose livrée à la volonté d’autrui» (p.162) Retrouver son caractère humain, c’est retrouver l’initiative et le choix. En plus, pour qu’il y ait liberté, il faut qu’il y ait stabilité. La philosophe s’insurge contre la peur qui sévit dans les usines. Tout le monde a peur d’un renvoi, justifié ou arbitraire. Weil elle-même en a souffert sans recevoir aucune justification «Qu’est-ce qu’on a contre moi ? On n’a pas daigné me le dire». (p.157) Ces renvois arbitraires sèment la peur dans les cœurs des ouvriers qui travaillent dans la crainte perpétuelle.
Enfin, plutôt beauté que laideur. Pour Simone Weil, le salut se trouve dans la beauté. Dostoïevski l’avait dit : «la beauté sauvera le monde». La philosophe en est amplement consciente : «une seule chose rend supportable la monotonie, c’est une lumière d’éternité ; c’est la beauté. Il y a un seul cas où la nature humaine supporte que le désir de l’âme se porte non pas vers ce qui pourrait être ou ce qui sera, mais vers ce qui existe. Ce cas, c’est la beauté». (p.266-267) A la fin de ce livre plein de douleurs liées au travail, l’auteure se métamorphose en une mystique imprégnée de sagesse stoïcienne. Faute de pouvoir éviter la souffrance, acceptons-la (accepter n’est pas se soumettre pour Weil ; amor fati, dirait Nietzsche), et atténuons-la par la beauté. Celle-ci réside, selon l’auteure, dans la poésie. Non pas «la poésie enfermée dans les mots», l’ouvrier «a besoin que la substance quotidienne de sa vie soit elle-même poésie». (p.267)
Cette poésie a une source : C’est Dieu. «Cette poésie ne peut être que religion» explique l’auteure. Pour éviter l’esclavage et la souffrance, seule une lumière d’éternité peut rendre vivable la condition ouvrière. Ces propos tirés de La Pesanteur de la grâce résument parfaitement la fin de La Condition ouvrière, ils n’ont pas besoin de commentaire : «Les travailleurs ont besoin de poésie plus que de pain. Besoin que leur vie soit une poésie. Besoin d’une lumière d’éternité. Seule la religion peut être la source de cette poésie. Ce n’est pas la religion, c’est la révolution qui est l’opium du peuple. La privation de cette poésie explique toutes les formes de démoralisation. L’esclavage, c’est le travail sans lumière d’éternité, sans poésie, sans religion. Que la lumière éternelle donne, non pas une raison de vivre et de travailler, mais une plénitude qui dispense de chercher cette raison. A défaut de cela, les seuls stimulants sont la contrainte et le gain. La contrainte, ce qui implique l’oppression du peuple. Le gain, ce qui implique la corruption du peuple».
DAOUD El Yazid
Professeur agrégé de lettres françaises
Dans les lignes qui suivront, j’aborderai quelques pistes de réflexions (quelques idées essentielles) concernant le livre de Simone Weil, à savoir La Condition ouvrière, dans une tentative de cerner certaines problématiques fondamentales qui traversent l’œuvre de l’auteure.
Ce livre est publié à titre posthume en 1951. Il contient des lettres et des articles de Weil rassemblés par Albert Camus et qui ont pour point commun la condition des ouvriers, la conception de la philosophe du travail et quelques solutions qu’elle propose à ce sujet. Simone Weil s’est engagée dans quelques usines pour connaître de près les conditions du travail et pour préparer un essai sur le sujet.
A la lecture de Simone Weil, on dirait que tout le problème tourne autour de l’idée de la «déshumanisation». Le travail est certes une valeur essentielle, une activité vitale dont on ne pourrait se détacher, il est même défini comme étant la grandeur de l’homme. Dans un livre intitulé La Pesanteur de la grâce, Weil avance que «la grandeur de l’homme est toujours de recréer sa vie». Pour elle, c’est le travail qui permet l’accès à cette recréation qui mène à la grandeur. Cependant, le travail est servile et avilissant. Dans l’une des premières lettres inscrites dans La Condition ouvrière, Simone Weil résume son projet en disant : «j’ai beaucoup souffert de ces mois d’esclavage, mais je ne voudrais pour rien au monde ne pas les avoir traversés. Ils m’ont permis de m’éprouver moi-même et de toucher du doigt tout ce que je n’avais pu qu’imaginer. J’en suis sortie bien différente de ce que j’étais quand j’y suis entrée – physiquement épuisée, mais moralement endurcie». (p.56) [toutes les indications des pages se réfèrent à l’édition GF, prescrite au programme] La phrase de Weil montre bel et bien que son ouvrage est une sorte de témoignage qui a pour objectif de rendre compte d’une expérience douloureuse dont on ne sort pas indemne, celle de l’esclavage. Le mot sonne fort au début du livre mais il va permettre d’introduire toute une argumentation pour prouver l’aspect servile du travail à l’usine.
En effet, l’auteure ne cesse de reprendre l’idée de l’esclavage et de la servilité au cours des lettres adressées aux amis ou au directeur des usines Rosières. Dans un processus de déshumanisation, le travail manuel et machinal aux usines porte atteinte à l’intelligence, la liberté et la santé de l’ouvrier. Celui-ci se trouve incapable de penser à cause de la monotonie et l’épuisement qu’engendrent les tâches rebutantes du travail. «Quand je dis machinal, ne croyez pas qu’on puisse rêver à autre chose en le faisant, encore moins réfléchir». (p.71) Pour la philosophe, c’est ce qui rend la « situation tragique». A travers cette expérience vécue dans une usine, Simone Weil décrit minutieusement les rituels avilissants du travail. L’ouvrier devient une espèce de machine, un objet qui n’a qu’à obéir aux ordres : «Cette situation fait que la pensée se recroqueville, se rétracte, comme la chair se rétracte devant un bistouri. On ne peut pas être conscient». (p.61) La docilité des ouvriers s’apparente pour Weil à une «seconde nature», pour reprendre les mots d’un philosophe qui ne peut ne pas venir à l’esprit en lisant le livre : Etienne de La Boétie. Cette seconde nature est le résultat direct de l’oppression. Pour Weil, la subordination et son corrélatif l’oppression mènent l’ouvrier à une soumission irrésistible : «J’ai tiré en somme deux leçons de mon expérience, dit Weil, la première, la plus amère et la plus imprévue, c’est que l’oppression, à partir d’un certain degré d’intensité, engendre non une tendance à la révolte, mais une tendance presque irrésistible à la plus complète soumission». (p.102) Même la philosophe qui a entamé l’expérience de l’usine pour des raisons de militantisme avoue qu’elle s’est complétement convertie à la docilité. Que dire alors des simples ouvriers qui, pour la plupart, souffrent d’ignorance comme le déclare la philosophe. On retrouve ici une idée marxiste : l’aliénation du travail est irréfragable.
Selon les dires de l’auteure, tout travail manuel est inéluctablement lié à la servitude : «il y a dans le travail des mains et en général dans le travail d’exécution, qui est le travail proprement dit, un élément irréductible de servitude que même une parfaite équité sociale n’effacerait pas» (p.261) C’est justement cette corrélation entre la servitude et le travail qui rend la tâche difficile à la philosophe militante. Comment éviter l’inévitable ? Comment humaniser ce qui se définit par l’esclavage ?
Pour Weil, l’ouvrier est toujours conduit à comprendre qu’il ne compte pour rien, qu’il ne vaut rien et que ses gestes automatiques n’ont aucune valeur. Cette sensation humiliante fait que le travailleur se sous-estime et se conçoit comme une chose : «le subordonné joue presque le rôle d’une chose maniée par l’intelligence d’autrui. Telle était ma situation». (p.123) Comme le répète Simone Weil, le problème ne réside pas exactement dans la subordination (elle est quand même nécessaire), mais dans ce sentiment d’inintelligence, voire d’insignifiance, qu’ont les ouvriers de se voir dépossédés de toute initiative, de toute création, de tout esprit critique. L’ouvrier travaille sans savoir à quoi aboutit sa tâche. La division des tâches à l’usine abrutit l’ouvrier. Il passe des heures à effectuer une même tâche qui est une petite étape de la fabrication d’un objet. Cette situation lui donne l’impression de ne rien accomplir d’intéressant parce qu’il n’a pas accès au produit final pour y voir sa propre touche. Faire une seule tâche et passer parfois de l’une à l’autre sans savoir pourquoi donnent l’impression qu’il s’agit d’obéir à des ordres arbitraires de la part des supérieurs. Ce sentiment de l’arbitraire est selon Weil «incompatible avec la dignité humaine» (p.130) Parmi les concepts fondamentaux de Simone Weil sont «la nécessité» et son opposé «la finalité». L’ouvrier ne travaille pas pour un but mais parce qu’il a besoin de travailler pour survivre : «c’est le fait qu’il est gouverné par la nécessité, non par la finalité. On l’exécute à cause d’un besoin, non en vue d’un bien». (p.261). Dans La Pesanteur de la grâce, l’auteure le formulera plus clairement : «Faire effort par nécessité et non pour un bien - poussé, non attiré – pour maintenir son existence telle qu’elle est – c’est toujours servitude». Ainsi, pour humaniser le travail, il faut des efforts à finalité et non des efforts par nécessité.
Subordination donc, ignorance, servitude et arbitraire. Telles sont, entre autres, les souffrances des ouvriers. Cette condition est apparemment d’une laideur inouïe. Ajoutons donc la laideur.
Que faut-il faire alors ? Les textes de Simone Weil ne se limitent pas à la simple description des faits. La philosophe militante, tout en avouant qu’elle rêve d’un idéal difficile à atteindre (le mot idéal est aussi fondamental parce qu’il rend compte d’un réalisme lucide de la part de l’auteure), présente quelques «solutions» pour amoindrir les douleurs des ouvriers. En nous référant aux souffrances susnommées, nous pouvons énoncer les issues proposées par Weil comme suit : moins de subordination, moins d’ignorance, moins de servitude, moins d’arbitraire et moins de laideur. Il s’agit en somme d’humaniser le travail.
Plutôt collaboration que subordination, semble clamer Simone Weil. Dans les lettres adressées à Victor Bernard, directeur des usines Rosières, l’auteure formule ce vœu humaniste en disant : «En ce qui concerne les usines, la question que je me pose […] est celle d’un passage progressif de la subordination totale à un certain mélange de subordination et de collaboration, l’idéal étant la coopération pure». (p.112) Simone Weil reproche au directeur de l’usine de confondre pouvoir (qui est une qualité humaine) et toute-puissance (qualité divine). Les ouvriers sont traités comme des serfs alors qu’ils devraient être vus comme des humains. Il est donc nécessaire de passer de la servilité à la coopération. Si les patrons retrouvent leur statut humain, ils se conduiront d’homme à homme avec les ouvriers, ce qui est le principe même d’une collaboration. Et par conséquent, le travail s’humanisera. L’humanisation du travail se perçoit dans le choix même des mots, le préfixe «co-» (dans collaboration et coopération) indique un rapport d’échange et d’égalité et éradique toute subordination.
Plutôt connaissance qu’ignorance. Simone Weil dénonce l’ignorance des ouvriers, accentuée par l’abrutissement qui provient du travail rébarbatif et acharné. Il est inconcevable, pour Weil, d’humaniser le travail sans une certaine éducation : «Si […] l’ignorance des ouvriers arrivait à être reconnue d’un commun accord comme constituant l’un des obstacles à une organisation plus humaine, ne serait-ce pas là la seule introduction possible à une série d’articles de véritable vulgarisation ?» (p.104) La proposition est encore adressée au directeur des usines Rosières, Victor Bernard. Weil précise qu’il est de sa responsabilité de diminuer l’ignorance des ouvriers qui engendre leur sentiment de «ne compter pour rien». La philosophe rêve d’un travail qui puisse «constituer une éducation» (p.119) Pour ce faire, elle se propose de lancer un projet de vulgarisation, elle souhaite rendre les chefs-d’œuvre de la poésie grecque «accessibles aux masses populaires», les jugeant «plus proches du peuple» que «la littérature française classique et moderne» (p.127) Pour Weil, cette littérature grecque, profondément ancrée dans le politique, est en passe de permettre aux ouvriers d’en tirer des leçons de vie sur le plan professionnel. Elle propose Antigone de Sophocle où le personnage éponyme est l’exemple de l’opprimé, l’isolé, le souffrant qui arrive à contester les ordres, à désobéir, à se révolter. Weil demande à Victor Bernard de lui permettre de publier dans le journal de l’usine ses lectures de la littérature grecque pour que les ouvriers en profitent. En vue de valoriser le travail des ouvriers, ceux-ci doivent comprendre, selon l’auteure, «qu’ils fabriquent des objets qui sont appelés par des besoins sociaux, et qu’ils ont un droit limité, mais réel, à en être fiers». (p.243) C’est la seule façon qui permettrait le passage de la nécessité à la finalité. L’ouvrier se sent utile et supporte mieux les souffrances du travail. Tout est donc question de conscience, de connaissance.
Plutôt liberté que servitude. Simone Weil a la conviction que le travail manuel peut combiner entre la rigueur et la liberté. L’auteure préconise «le pouvoir créateur du travailleur» (p.144) Celui-ci devrait avoir le monopole et prendre l’initiative. Simone Weil déplore le fait que l’ouvrier n’est qu’une «chose livrée à la volonté d’autrui» (p.162) Retrouver son caractère humain, c’est retrouver l’initiative et le choix. En plus, pour qu’il y ait liberté, il faut qu’il y ait stabilité. La philosophe s’insurge contre la peur qui sévit dans les usines. Tout le monde a peur d’un renvoi, justifié ou arbitraire. Weil elle-même en a souffert sans recevoir aucune justification «Qu’est-ce qu’on a contre moi ? On n’a pas daigné me le dire». (p.157) Ces renvois arbitraires sèment la peur dans les cœurs des ouvriers qui travaillent dans la crainte perpétuelle.
Enfin, plutôt beauté que laideur. Pour Simone Weil, le salut se trouve dans la beauté. Dostoïevski l’avait dit : «la beauté sauvera le monde». La philosophe en est amplement consciente : «une seule chose rend supportable la monotonie, c’est une lumière d’éternité ; c’est la beauté. Il y a un seul cas où la nature humaine supporte que le désir de l’âme se porte non pas vers ce qui pourrait être ou ce qui sera, mais vers ce qui existe. Ce cas, c’est la beauté». (p.266-267) A la fin de ce livre plein de douleurs liées au travail, l’auteure se métamorphose en une mystique imprégnée de sagesse stoïcienne. Faute de pouvoir éviter la souffrance, acceptons-la (accepter n’est pas se soumettre pour Weil ; amor fati, dirait Nietzsche), et atténuons-la par la beauté. Celle-ci réside, selon l’auteure, dans la poésie. Non pas «la poésie enfermée dans les mots», l’ouvrier «a besoin que la substance quotidienne de sa vie soit elle-même poésie». (p.267)
Cette poésie a une source : C’est Dieu. «Cette poésie ne peut être que religion» explique l’auteure. Pour éviter l’esclavage et la souffrance, seule une lumière d’éternité peut rendre vivable la condition ouvrière. Ces propos tirés de La Pesanteur de la grâce résument parfaitement la fin de La Condition ouvrière, ils n’ont pas besoin de commentaire : «Les travailleurs ont besoin de poésie plus que de pain. Besoin que leur vie soit une poésie. Besoin d’une lumière d’éternité. Seule la religion peut être la source de cette poésie. Ce n’est pas la religion, c’est la révolution qui est l’opium du peuple. La privation de cette poésie explique toutes les formes de démoralisation. L’esclavage, c’est le travail sans lumière d’éternité, sans poésie, sans religion. Que la lumière éternelle donne, non pas une raison de vivre et de travailler, mais une plénitude qui dispense de chercher cette raison. A défaut de cela, les seuls stimulants sont la contrainte et le gain. La contrainte, ce qui implique l’oppression du peuple. Le gain, ce qui implique la corruption du peuple».
DAOUD El Yazid
Professeur agrégé de lettres françaises
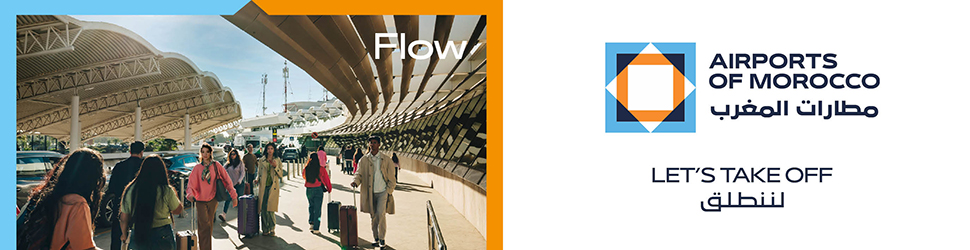










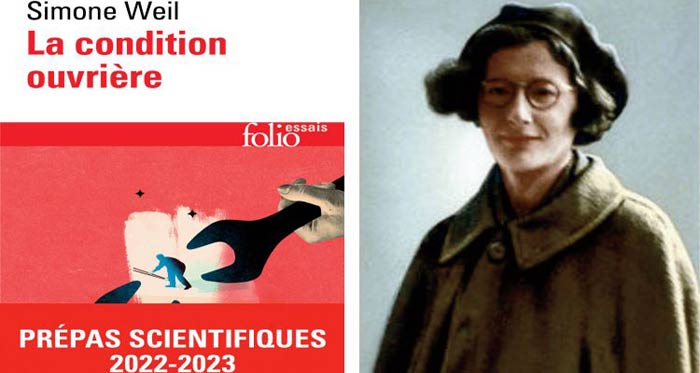








 Pourquoi Bank Al-Maghrib tarde-t-elle à baisser son taux directeur ?
Pourquoi Bank Al-Maghrib tarde-t-elle à baisser son taux directeur ?





