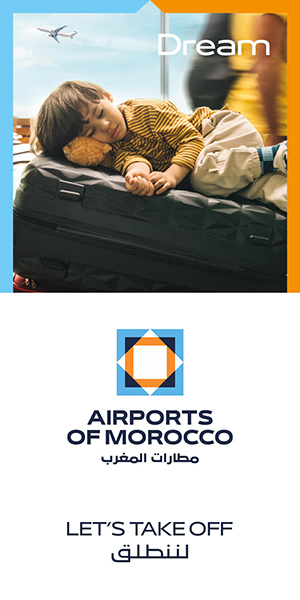Il y a quelques mois, l’opinion publique marocaine était divisée entre un accueil favorable et un accueil défavorable à l’endroit du film Casa Negra, du réalisateur Nourdine Lakhmari. De même, depuis la nouvelle rentrée scolaire, cette opinion se trouve encore une fois partagée sur la position à tenir à la suite de la programmation de la nouvelle Mohawalato Aiche de Mohammed Zafzaf au cycle d’études secondaires. Ces deux événements, quoique distants dans le temps, se rejoignent sur ce même point commun : dans l’une et l’autre œuvres d’art, tandis que l’opinion négative stipule que le langage auquel recourent les deux artistes est un langage désobligeant et révoltant qui risque de dépraver les mœurs en vigueur dans la société en encourageant l’exemple de conduites et de comportements pervers. L’opinion positive soutient qu’il ne s’agit là que d’un malentendu, puisque l’objectif profondément visé est, au contraire, de prévenir les dérapages sociaux qui guettent les jeunes gens.
A y regarder de très près, on voit que le problème gravite autour du langage employé par le réalisateur et par le romancier, langage qui est jugé selon qu’on se range du côté de cette thèse ou de l’autre comme grossier et inconvenable ou comme normal et bien approprié. Quiconque voulant arbitrer ce débat doit, à mon sens, prendre distance vis-vis du zèle qu’affichent les deux camps et se poser le plus neutralement possible la question suivante : qui rend plus service à la société, une œuvre un peu licencieuse ou une œuvre très conformiste ?
Donner un élément de réponse à cette question passe obligatoirement par l’examen du statut sémiologique du signe d’expression employé par l’artiste. Dans les deux exemples qui nous intéressent ici, la pomme de discorde n’est autre que le signe linguistique lui-même. Aux risques de redites, on rappellera que Ferdinand de Saussure1 qui définit le signe linguistique comme une association solidaire entre un signifié et un signifiant (concept et suite sonore respectivement, pour aller vite) n’a pas manqué de remarquer que ce rapport est déplaçable, ce qui signifie, entre autres possibilités d’ailleurs, que le sens évolue même si l’une de ses caractéristiques est d’être stable. En d’autres termes, il est à la fois immutable et mutable. Il ne s’agit ici d’aucun paradoxe ; qu’on se souvienne en effet que cette mutabilité est insensible, progressive et affaire de masse et non d’individus. L’une des voies de cette évolution est que le signifiant ne subit aucune altération phonétique tandis que son sens ne cesse de changer au fil du temps. Cette remarque servira, sur le plan sociolinguistique qui nous concerne ici, à tirer au clair un imbroglio : en matière de jurons, la dimension formelle des expressions continuent de rappeler à la mémoire des locuteurs d’une manière ou d’une autre le sens originel même s’il se trouve que leur usage actuel s’applique à dénoter d’autres sens. Ainsi par exemple, encore que l’expression merde soit employée dans des situations d’étonnement et d’admiration, l’esprit y voit toujours quelques bribes de son sens propre. Il s’ensuit un désaccord parmi les gens sur la signification et la valeur éthique de certaines expressions, désaccord assorti souvent de réactions, sinon conflictuelles du moins contradictoires.
Un autre procédé souvent retenu par les linguistes dans l’explication du changement de sens : l’euphémisme2. Le sens de beaucoup de mots a changé sous cette contrainte morale générale qui interdit, dans le souci de sauvegarder les bonnes manières, l’insolence. Dans cette optique, du moment que certains termes relatifs à nos besoins élémentaires relèvent eux aussi de l’insolent et doivent, du coup, être écartés de la conversation convenable, les usagers se trouvent en perpétuelle quête de mots opaques pour remplacer les mots qui sont devenus transparents. C’est ainsi qu’on a passé, à titre illustratif, successivement de cabinets à lieux d’aisance, puis à petit coin, puis à water-closets, enfin à toilettes. Or, l’euphémisme n’est en fait l’apanage que de la société policée qui, similairement à la notion de langue standard, est une fiction, et ne paraît, par contre, ni usuel pour toutes les couches de la société, ni nécessaire dans toutes les situations de communication interindividuelle. Donc, d’une part, nous avons des contextes où les usagers respectent la bienséance et affectionne un langage propre en conformité avec la situation de communication donnée et, d’autre part, des contextes où les usagers sont moins scrupuleux en matière du choix de leur vocabulaire. Le citoyen marocain est, pour ainsi dire, double, parce que sa source d’apprentissage linguistique est également double.
Si, comme le soulignent les linguistes, l’enfant apprend à parler à partir de la langue environnante, on est conduit à constater que ce concept de langue environnante n’est pas soumis aux mêmes contraintes sociales, c’est-à-dire que les sources d’apprentissage de la langue et de l’enrichissement lexical de l’individu sont multiples et hétérogènes. Il s’ensuit que l’usager enregistre le lexique dans sa globalité et n’opère en fait de sélection limitative sur l’ensemble hétéroclite de son vocabulaire que sous le joug de contextes coercitifs. Cet enregistrement, comme le souligne Saussure, est passif, imposé par la communauté linguistique. Sous cet angle, en suivant les philosophes de langage3, on dira que la langue ne manque pas d’exercer une certaine tyrannie sur le locuteur, en ce sens que son acquisition s’accompagne de la transmission de la variété d’expériences propres à la culture concernée. Non seulement on transmet aux générations futures la langue en tant que telle mais également le fonds ancestral où s’est déposée toute la phylogenèse de la communauté, autrement dit toute la culture entendue comme ensemble de croyances, de pratiques, de fautes, de préjugés, etc.
L’aspect double du caractère du locuteur est souvent à l’origine d’un type particulier d’hypocrisie qu’on appellera, pour la clarté de l’exposé, hypocrisie sociale inconsciente et qui se distinguerait nettement de l’hypocrisie canonique, définie généralement sur la base d’une certaine intentionnalité comme l’attitude à afficher des vertus qu’on n’a pas. Tout le problème donc est de conduire les gens à prendre conscience du fait qu’ils sont linguistiquement dédoublés. Les pistes qui s’offrent à l’analyste sont celles de l’examen minutieux des différentes modalités de l’exercice du langage en situations concrètes de communication. Un tel effort débordant de loin les limites de la présente réflexion, on se bornera à distinguer à cet égard deux types de situations linguistiques, des situations effectives de communication spontanée et des situations d’interaction intellectuelle. Les premières s’appliquent aux différents échanges verbaux quotidiens et les secondes, aux instances particulières d’échange entre un récepteur et un produit d’art quelconque. L’essentiel pour notre part est de montrer que dans chacun de ces deux types de situation, l’usager adopte un comportement particulier qui correspond à un volet de son dédoublement linguistique. Bien sûr, on est conscient de l’existence de niveaux intermédiaires, car on conçoit ces deux pôles non comme les tracés francs de deux domaines opposés mais davantage comme les deux extrémités d’un même continuum.
Les situations concrètes où l’individu est terriblement gêné, irrité et indigné contre la grossièreté d’un propos se produisent lorsqu’il est dans une compagnie éthiquement régie par l’observance des règles sociales de bienséance. En effet, la majorité des Marocains supporteraient avec beaucoup de dépit des mots impudents en présence de leurs parents. Cette attitude ne saura s’expliquer que par la nature du rapport qui unit les enfants à leurs parents, rapport qui, tout bien considéré, relève du sacré dans la majorité des sociétés, abstraction faite des divergences culturelles et religieuses. Mais, seule une minorité peut encore en souffrir en présence des autres membres de la famille, frères, sœurs, cousins, oncles, etc. On nuancera bien sûr cette thèse, convaincu qu’on est que la pudeur entre frères, sœurs, cousins etc., varie sensiblement d’une famille à l’autre, d’une ville à l’autre et d’une région à l’autre. Ce qui est assez sûr, et plusieurs en conviendront d’ailleurs, c’est que presque personne ne se sentira réellement concerné s’il se trouve avec des amis ou tout simplement témoin parmi d’autres concitoyens d’une scène cynique. C’est que la société marocaine ne cesse d’évoluer sous l’influence des habitudes et des idées d’autres cieux et que le domaine d’extension des bonnes manières se voit réduire ses règles et son goût à des cercles de plus en plus restreints des institutions sociales. Si les liens de pudeur vont se relâchant entre frères, sœurs et parents, pourquoi s’étonne-t-on de la licence qui gangrène de proche en proche le respect entre amis, voisins et concitoyens ?
On l’aura compris, ce qui nous blesse, c’est moins les mots en soi qui nous sont imposés dans leurs contenus par la société que les contextes de communication eux-mêmes. Ces mêmes contextes sont également tributaires de l’état d’humeur où l’on est et du degré de maîtrise de soi. N’a-t-on pas souvent vu des gens en colère accabler leurs parents, leurs frères, leurs supérieurs, etc. de propos outrageants couronnés, comme pour se faire immanquablement craindre, de
blasphèmes. ?
La seconde situation est celle qui est créée par la magie et le pouvoir de l’art. L’art a l’avantage, puis-je dire, d’échapper à l’emprise de la réalité même si sa nature est de la refléter et sa mission, à en croire A. Camus4, de la corriger. En principe, l’art met inconsciemment le récepteur dans une prédisposition d’interaction positive, durant laquelle s’instaure entre lui et l’œuvre d’art un va-et-vient ininterrompu d’échanges et de dialogues, dans la mesure où regarder, lire ou écouter un produit artistique est bien un acte volontaire. S’il se sent exaspéré, compte tenu de la normativité haute du contexte où il se trouve, c’est qu’il en vient à prendre conscience de l’impudence des propos employés. Tout au moins peut-on dire dans ce cas que l’œuvre d’art concernée n’a pas manqué de réactiver cette partie passive de la conscience ou, si l’on veut, de la morale du récepteur, en l’amenant à raisonner, ne serait-ce que très vaguement, sur la réalité du malaise où sont mis les gens dans les nombreuses scènes de la vie quotidienne.
Les polémiques houleuses -mais en grande partie très déplacées parce que n’évoluant pas en profondeur- au sujet de l’admission ou du rejet d’une œuvre d’art dans un programme culturel quelconque, rappelle les scandales auxquels ont donné lieu certaines exposions de peinture au XIXe siècle. Cet exemple suffirait à notre propos : les tableaux d’Edouard Manet ont suscité des controverses vives sur les allusions érotiques déclenchées par le nudisme des personnages, mais au fond, chose qu’on a comprise tardivement mais qui n’a pas sauvé, de son vivant, le peintre du discrédit où l’avait précipité l’opinion publique hostile, les bourgeois qui se reconnurent dans les tableaux de Manet étaient en fait moins choqués par l’érotisme que par la mise à nu de leur propre dédoublement, c’est-à-dire de leur hypocrisie sociale ; le public s’étonnait, à la vue de Déjeuner sur l’herbe par exemple, que deux bourgeois, respectables sur l’apparence, puissent accepter de déjeuner, au mépris des valeurs de morale, avec une femme à poil.
Envenimer le scandale sous la houlette de personnes mal informées sur le sujet en agitant frénétiquement l’emblème de la pudeur n’avance pas les choses, car le résultat prévisible d’une telle attitude est d’interdire l’œuvre d’art et, probablement, de faire la guerre à son auteur, ce qui revient à balayer d’un revers de main le problème avant même d’être sérieusement posé. Tel me semble être le vœu de l’opinion défavorable. Mais laisser l’art remplir pleinement sa mission d’éclairer les esprits et de corriger les défauts selon le principe de liberté qui lui est intrinsèque ne pourra que cautionner cette vision qui conçoit la société comme un système autorégulable. Une telle position me paraît assez raisonnable pour cette raison au moins : la société, toutes classes confondues, ignore beaucoup de choses sur elle-même, et tant qu’on n’a pas encore élaboré une comportementale, discipline sociologique qui aura pour but d’étudier et de classer, sous des aspects positifs, les différents comportements de tous les groupes d’individus, rien ne saura ni se mesurer à l’art quant à donner des échantillons d’analyse ni le freiner dans son élan noble de renvoyer, comme un miroir nébuleux, aux gens quelques traits de leurs défauts en société.
Pour conclure, on notera que c’est surtout le métier de cinématographie qui est en butte aux vicissitudes du dédoublement linguistique du public. Il est rare en effet de trouver un film marocain qui emploie un lexique direct, littéral et limpide, susceptible de transposer dans une large mesure celui qui est usité dans la vie réelle des Marocains. Généralement, pour des raisons de convenance, de religion, etc., les Marocains recourent à l’emprunt de termes étrangers à charge d’exprimer leurs tabous. Par exemple, la majorité des expressions qui font partie du champ lexical de la notion de sexe sont remplacées par des mots français qui en atténuent la nudité. Autrement dit, on affectionne des tournures indirectes pour espérer rendre le sens des expressions d’origine. Le résultat n’est pas toujours atteint, car il va de soi que le spectateur marocain boude les parlers snob. On se souviendra que pour les Marocains, parler le français en dehors de quelques institutions, c’est afficher effrontément son snobisme et déclarer ouvertement son suivisme culturel. Aussi, peut-on apercevoir dans cet argument les raisons profondes qui poussaient nos ancêtres sous l’occupation à modifier et à plier les termes français les plus utiles aux pratiques quotidiennes de la vie aux schèmes phonétiques de la langue d’accueil de telle façon qu’ils perdent toute trace de leur identité d’origine.
Pour faire du cinéma au Maroc, le réalisateur a deux voies qui, malheureusement, mènent toutes deux à une impasse : attribuer aux personnages un langage qui n’est pas le langage général des gens ; dans ce cas le réalisateur court le risque inévitable d’être hué et déprécié, ou, au contraire, leur attribuer un langage qui se veut réaliste, le langage que les gens parlent et dont le lexique varie selon les situations de communication et les idéaux de chacun ; dans ce cas aussi, le réalisateur est inexorablement taxé de vulgarité et d’impudence.
Art et pudeur, comme un jeune ménage en période de crise, profiteront plus de l’union des deux familles (les deux camps) que de leur désunion.
* Université Cadi-Ayyad
Faculté Polydisciplinaire-Safi
Notes bibliographiques
1. Cours de linguistique générale, Lausanne, Payot, 1916, nouv. éd., 1972.
2. Voir Nyckees (V), La sémantique, Paris, Belin, 1998.
3. Voir Schaff (A), 1964, Langage et connaissance, Paris, Anthropos 1964, traduc. fr. 1969.
4. L’homme révolté, Paris, Gallimard, 1951.
A y regarder de très près, on voit que le problème gravite autour du langage employé par le réalisateur et par le romancier, langage qui est jugé selon qu’on se range du côté de cette thèse ou de l’autre comme grossier et inconvenable ou comme normal et bien approprié. Quiconque voulant arbitrer ce débat doit, à mon sens, prendre distance vis-vis du zèle qu’affichent les deux camps et se poser le plus neutralement possible la question suivante : qui rend plus service à la société, une œuvre un peu licencieuse ou une œuvre très conformiste ?
Donner un élément de réponse à cette question passe obligatoirement par l’examen du statut sémiologique du signe d’expression employé par l’artiste. Dans les deux exemples qui nous intéressent ici, la pomme de discorde n’est autre que le signe linguistique lui-même. Aux risques de redites, on rappellera que Ferdinand de Saussure1 qui définit le signe linguistique comme une association solidaire entre un signifié et un signifiant (concept et suite sonore respectivement, pour aller vite) n’a pas manqué de remarquer que ce rapport est déplaçable, ce qui signifie, entre autres possibilités d’ailleurs, que le sens évolue même si l’une de ses caractéristiques est d’être stable. En d’autres termes, il est à la fois immutable et mutable. Il ne s’agit ici d’aucun paradoxe ; qu’on se souvienne en effet que cette mutabilité est insensible, progressive et affaire de masse et non d’individus. L’une des voies de cette évolution est que le signifiant ne subit aucune altération phonétique tandis que son sens ne cesse de changer au fil du temps. Cette remarque servira, sur le plan sociolinguistique qui nous concerne ici, à tirer au clair un imbroglio : en matière de jurons, la dimension formelle des expressions continuent de rappeler à la mémoire des locuteurs d’une manière ou d’une autre le sens originel même s’il se trouve que leur usage actuel s’applique à dénoter d’autres sens. Ainsi par exemple, encore que l’expression merde soit employée dans des situations d’étonnement et d’admiration, l’esprit y voit toujours quelques bribes de son sens propre. Il s’ensuit un désaccord parmi les gens sur la signification et la valeur éthique de certaines expressions, désaccord assorti souvent de réactions, sinon conflictuelles du moins contradictoires.
Un autre procédé souvent retenu par les linguistes dans l’explication du changement de sens : l’euphémisme2. Le sens de beaucoup de mots a changé sous cette contrainte morale générale qui interdit, dans le souci de sauvegarder les bonnes manières, l’insolence. Dans cette optique, du moment que certains termes relatifs à nos besoins élémentaires relèvent eux aussi de l’insolent et doivent, du coup, être écartés de la conversation convenable, les usagers se trouvent en perpétuelle quête de mots opaques pour remplacer les mots qui sont devenus transparents. C’est ainsi qu’on a passé, à titre illustratif, successivement de cabinets à lieux d’aisance, puis à petit coin, puis à water-closets, enfin à toilettes. Or, l’euphémisme n’est en fait l’apanage que de la société policée qui, similairement à la notion de langue standard, est une fiction, et ne paraît, par contre, ni usuel pour toutes les couches de la société, ni nécessaire dans toutes les situations de communication interindividuelle. Donc, d’une part, nous avons des contextes où les usagers respectent la bienséance et affectionne un langage propre en conformité avec la situation de communication donnée et, d’autre part, des contextes où les usagers sont moins scrupuleux en matière du choix de leur vocabulaire. Le citoyen marocain est, pour ainsi dire, double, parce que sa source d’apprentissage linguistique est également double.
Si, comme le soulignent les linguistes, l’enfant apprend à parler à partir de la langue environnante, on est conduit à constater que ce concept de langue environnante n’est pas soumis aux mêmes contraintes sociales, c’est-à-dire que les sources d’apprentissage de la langue et de l’enrichissement lexical de l’individu sont multiples et hétérogènes. Il s’ensuit que l’usager enregistre le lexique dans sa globalité et n’opère en fait de sélection limitative sur l’ensemble hétéroclite de son vocabulaire que sous le joug de contextes coercitifs. Cet enregistrement, comme le souligne Saussure, est passif, imposé par la communauté linguistique. Sous cet angle, en suivant les philosophes de langage3, on dira que la langue ne manque pas d’exercer une certaine tyrannie sur le locuteur, en ce sens que son acquisition s’accompagne de la transmission de la variété d’expériences propres à la culture concernée. Non seulement on transmet aux générations futures la langue en tant que telle mais également le fonds ancestral où s’est déposée toute la phylogenèse de la communauté, autrement dit toute la culture entendue comme ensemble de croyances, de pratiques, de fautes, de préjugés, etc.
L’aspect double du caractère du locuteur est souvent à l’origine d’un type particulier d’hypocrisie qu’on appellera, pour la clarté de l’exposé, hypocrisie sociale inconsciente et qui se distinguerait nettement de l’hypocrisie canonique, définie généralement sur la base d’une certaine intentionnalité comme l’attitude à afficher des vertus qu’on n’a pas. Tout le problème donc est de conduire les gens à prendre conscience du fait qu’ils sont linguistiquement dédoublés. Les pistes qui s’offrent à l’analyste sont celles de l’examen minutieux des différentes modalités de l’exercice du langage en situations concrètes de communication. Un tel effort débordant de loin les limites de la présente réflexion, on se bornera à distinguer à cet égard deux types de situations linguistiques, des situations effectives de communication spontanée et des situations d’interaction intellectuelle. Les premières s’appliquent aux différents échanges verbaux quotidiens et les secondes, aux instances particulières d’échange entre un récepteur et un produit d’art quelconque. L’essentiel pour notre part est de montrer que dans chacun de ces deux types de situation, l’usager adopte un comportement particulier qui correspond à un volet de son dédoublement linguistique. Bien sûr, on est conscient de l’existence de niveaux intermédiaires, car on conçoit ces deux pôles non comme les tracés francs de deux domaines opposés mais davantage comme les deux extrémités d’un même continuum.
Les situations concrètes où l’individu est terriblement gêné, irrité et indigné contre la grossièreté d’un propos se produisent lorsqu’il est dans une compagnie éthiquement régie par l’observance des règles sociales de bienséance. En effet, la majorité des Marocains supporteraient avec beaucoup de dépit des mots impudents en présence de leurs parents. Cette attitude ne saura s’expliquer que par la nature du rapport qui unit les enfants à leurs parents, rapport qui, tout bien considéré, relève du sacré dans la majorité des sociétés, abstraction faite des divergences culturelles et religieuses. Mais, seule une minorité peut encore en souffrir en présence des autres membres de la famille, frères, sœurs, cousins, oncles, etc. On nuancera bien sûr cette thèse, convaincu qu’on est que la pudeur entre frères, sœurs, cousins etc., varie sensiblement d’une famille à l’autre, d’une ville à l’autre et d’une région à l’autre. Ce qui est assez sûr, et plusieurs en conviendront d’ailleurs, c’est que presque personne ne se sentira réellement concerné s’il se trouve avec des amis ou tout simplement témoin parmi d’autres concitoyens d’une scène cynique. C’est que la société marocaine ne cesse d’évoluer sous l’influence des habitudes et des idées d’autres cieux et que le domaine d’extension des bonnes manières se voit réduire ses règles et son goût à des cercles de plus en plus restreints des institutions sociales. Si les liens de pudeur vont se relâchant entre frères, sœurs et parents, pourquoi s’étonne-t-on de la licence qui gangrène de proche en proche le respect entre amis, voisins et concitoyens ?
On l’aura compris, ce qui nous blesse, c’est moins les mots en soi qui nous sont imposés dans leurs contenus par la société que les contextes de communication eux-mêmes. Ces mêmes contextes sont également tributaires de l’état d’humeur où l’on est et du degré de maîtrise de soi. N’a-t-on pas souvent vu des gens en colère accabler leurs parents, leurs frères, leurs supérieurs, etc. de propos outrageants couronnés, comme pour se faire immanquablement craindre, de
blasphèmes. ?
La seconde situation est celle qui est créée par la magie et le pouvoir de l’art. L’art a l’avantage, puis-je dire, d’échapper à l’emprise de la réalité même si sa nature est de la refléter et sa mission, à en croire A. Camus4, de la corriger. En principe, l’art met inconsciemment le récepteur dans une prédisposition d’interaction positive, durant laquelle s’instaure entre lui et l’œuvre d’art un va-et-vient ininterrompu d’échanges et de dialogues, dans la mesure où regarder, lire ou écouter un produit artistique est bien un acte volontaire. S’il se sent exaspéré, compte tenu de la normativité haute du contexte où il se trouve, c’est qu’il en vient à prendre conscience de l’impudence des propos employés. Tout au moins peut-on dire dans ce cas que l’œuvre d’art concernée n’a pas manqué de réactiver cette partie passive de la conscience ou, si l’on veut, de la morale du récepteur, en l’amenant à raisonner, ne serait-ce que très vaguement, sur la réalité du malaise où sont mis les gens dans les nombreuses scènes de la vie quotidienne.
Les polémiques houleuses -mais en grande partie très déplacées parce que n’évoluant pas en profondeur- au sujet de l’admission ou du rejet d’une œuvre d’art dans un programme culturel quelconque, rappelle les scandales auxquels ont donné lieu certaines exposions de peinture au XIXe siècle. Cet exemple suffirait à notre propos : les tableaux d’Edouard Manet ont suscité des controverses vives sur les allusions érotiques déclenchées par le nudisme des personnages, mais au fond, chose qu’on a comprise tardivement mais qui n’a pas sauvé, de son vivant, le peintre du discrédit où l’avait précipité l’opinion publique hostile, les bourgeois qui se reconnurent dans les tableaux de Manet étaient en fait moins choqués par l’érotisme que par la mise à nu de leur propre dédoublement, c’est-à-dire de leur hypocrisie sociale ; le public s’étonnait, à la vue de Déjeuner sur l’herbe par exemple, que deux bourgeois, respectables sur l’apparence, puissent accepter de déjeuner, au mépris des valeurs de morale, avec une femme à poil.
Envenimer le scandale sous la houlette de personnes mal informées sur le sujet en agitant frénétiquement l’emblème de la pudeur n’avance pas les choses, car le résultat prévisible d’une telle attitude est d’interdire l’œuvre d’art et, probablement, de faire la guerre à son auteur, ce qui revient à balayer d’un revers de main le problème avant même d’être sérieusement posé. Tel me semble être le vœu de l’opinion défavorable. Mais laisser l’art remplir pleinement sa mission d’éclairer les esprits et de corriger les défauts selon le principe de liberté qui lui est intrinsèque ne pourra que cautionner cette vision qui conçoit la société comme un système autorégulable. Une telle position me paraît assez raisonnable pour cette raison au moins : la société, toutes classes confondues, ignore beaucoup de choses sur elle-même, et tant qu’on n’a pas encore élaboré une comportementale, discipline sociologique qui aura pour but d’étudier et de classer, sous des aspects positifs, les différents comportements de tous les groupes d’individus, rien ne saura ni se mesurer à l’art quant à donner des échantillons d’analyse ni le freiner dans son élan noble de renvoyer, comme un miroir nébuleux, aux gens quelques traits de leurs défauts en société.
Pour conclure, on notera que c’est surtout le métier de cinématographie qui est en butte aux vicissitudes du dédoublement linguistique du public. Il est rare en effet de trouver un film marocain qui emploie un lexique direct, littéral et limpide, susceptible de transposer dans une large mesure celui qui est usité dans la vie réelle des Marocains. Généralement, pour des raisons de convenance, de religion, etc., les Marocains recourent à l’emprunt de termes étrangers à charge d’exprimer leurs tabous. Par exemple, la majorité des expressions qui font partie du champ lexical de la notion de sexe sont remplacées par des mots français qui en atténuent la nudité. Autrement dit, on affectionne des tournures indirectes pour espérer rendre le sens des expressions d’origine. Le résultat n’est pas toujours atteint, car il va de soi que le spectateur marocain boude les parlers snob. On se souviendra que pour les Marocains, parler le français en dehors de quelques institutions, c’est afficher effrontément son snobisme et déclarer ouvertement son suivisme culturel. Aussi, peut-on apercevoir dans cet argument les raisons profondes qui poussaient nos ancêtres sous l’occupation à modifier et à plier les termes français les plus utiles aux pratiques quotidiennes de la vie aux schèmes phonétiques de la langue d’accueil de telle façon qu’ils perdent toute trace de leur identité d’origine.
Pour faire du cinéma au Maroc, le réalisateur a deux voies qui, malheureusement, mènent toutes deux à une impasse : attribuer aux personnages un langage qui n’est pas le langage général des gens ; dans ce cas le réalisateur court le risque inévitable d’être hué et déprécié, ou, au contraire, leur attribuer un langage qui se veut réaliste, le langage que les gens parlent et dont le lexique varie selon les situations de communication et les idéaux de chacun ; dans ce cas aussi, le réalisateur est inexorablement taxé de vulgarité et d’impudence.
Art et pudeur, comme un jeune ménage en période de crise, profiteront plus de l’union des deux familles (les deux camps) que de leur désunion.
* Université Cadi-Ayyad
Faculté Polydisciplinaire-Safi
Notes bibliographiques
1. Cours de linguistique générale, Lausanne, Payot, 1916, nouv. éd., 1972.
2. Voir Nyckees (V), La sémantique, Paris, Belin, 1998.
3. Voir Schaff (A), 1964, Langage et connaissance, Paris, Anthropos 1964, traduc. fr. 1969.
4. L’homme révolté, Paris, Gallimard, 1951.



















 Pourquoi Bank Al-Maghrib tarde-t-elle à baisser son taux directeur ?
Pourquoi Bank Al-Maghrib tarde-t-elle à baisser son taux directeur ?