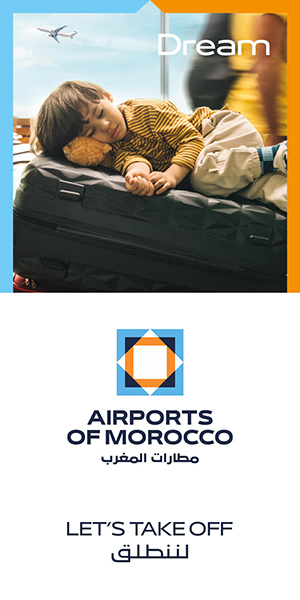L'assassinat de l'étudiante Sanae Hady, qui n'est un secret pour personne, continue, sur un rythme élevé, de défrayer la chronique. L'opinion publique ne cesse, à son tour, de nourrir des soupçons au tour d'une affaire de conflit multiforme. Le résultat est spectaculaire : le problème du harcèlement sexuel au Maroc se trouve encore une fois mis sur le devant de la scène. On en convient sans conteste, ce problème n'a pas encore débouché sur une polémique fructueuse propre à l'approfondir au lieu de l'effleurer à l'occasion et de l'enterrer aussitôt oublié l'évènement qui l'a déclenché. Cette fois-ci, comme on sait tous, c'est l'enseignant qui se voit pointé d'un index accusateur ; les journaux se sont saisis du fait pour consacrer au problème du harcèlement sexuel au sein des universités marocaines maints commentaires qui dénoncent l'acte infâme de l'enseignant criminel et stigmatisent à travers sa conduite, on le comprend bien, tous les universitaires du pays, dépeints par certains journaux comme naturellement portés à brandir impitoyablement l'arme de la note pour déjouer la réserve des étudiantes sous la menace de l'échec.
Si je prends part à ce débat, c'est parce que, d'une part, je suis enseignant et que, du coup, je me considère concerné par les commentaires qui foisonnent sur la malhonnêteté des enseignants et, d'autre part, parce que le concept de harcèlement sous la plume des commentateurs ne semble le plus souvent s'appliquer qu'aux hommes. Lever l'ambiguïté de ce comportement en explicitant sa nature selon le sexe, tel me paraît être le meilleur moyen d'enrichir le débat sur le sujet aussi bien que de le relancer sur la base de nouvelles considérations.
Chose curieuse par ailleurs, dans la signification de l'expression harcèlement sexuel, et plus précisément de son équivalent arabe “Ataharoch eljinsi”, il y a, comme diraient les sémanticiens, un type de sème génétiquement lié au sens du terme “homme” et qui est suffisamment appuyé par un certain symbolisme phonétique du lexème lui-même, en ce sens que l'articulation de l'expression ne manque pas d'évoquer prioritairement l'homme et très secondairement la femme.
Complexité
du phénomène
C'est un débat vain que de chercher l'origine de ce fléau dans le comportement, peut-on dire, tyrannique et narcissique de l'enseignant.
Diagnostiquer pertinemment le phénomène du harcèlement sexuel dans les universités marocaines exige, afin d'évoluer vers des solutions sérieuses du phénomène, de prendre en ligne de compte non seulement le pouvoir dont semble être investi l'enseignant mais également celui dont disposent les étudiantes et qu'elles mettent souvent à profit pour atteindre les buts escomptés. Ce pouvoir est celui qui constitue au fond leur raison d'être : la beauté. Il s'agit de mettre l'accent moins sur les conséquences fâcheuses du harcèlement que sur les raisons profondes qui y conduisent. C'est un débat vain que de chercher l'origine de ce fléau dans le comportement, peut-on dire, tyrannique et narcissique de l'enseignant et d'en attribuer les causes seulement à ses penchants pervers, ce qui revient à considérer le phénomène, malgré son ampleur et sa teinte sociale, comme un phénomène purement individuel, mais il convient plutôt de l'approcher dans toute sa complexité et sous ses différents aspects. Car, effectivement, un comportement donné, fût-il le moins récurrent dans ce qu'on peut appeler l'ensemble des comportements des hommes d'une société culturellement bien déterminée est nécessairement social, puisqu'il est, pour peu qu'on y regarde de près, étroitement lié aux circonstances, de quelque nature qu'elles soient, qui l'ont favorisé. Les scènes quotidiennes de l'ivrogne, du mendiant, du voleur, du voyou, etc., à titre d'exemple, sont loin d'être des cas isolés, détachés de tout ancrage sociopolitique. Si l'homme croit à son humanité et par conséquent à son amendement, rien ne doit donc s'opposer à sa volonté d'ériger une société saine où les défauts et les maladies de l'âme sont reconnus et pris en charge par la société humaine en vertu d'une décision politique qui émanerait d'une conscience universelle.
Qu'on se garde de penser qu'une telle volonté, pour se concrétiser, doit se transformer en une forme de despotisme ; la démarche recommandée s'appuie sur les vertus de l'effort continu et sur la perspective d'une vision globale qui questionne toutes les structures de la société, prises qu'elles sont supposées être dans leurs interrelations, ou pour mieux dire, dans leur interaction.
Une telle façon de voir autorise à revoir le phénomène du harcèlement sexuel en général sous des aspects nouveaux et prometteurs. Nouveaux, parce qu'on est appelé à en pénétrer les recoins qui demeurent souvent dérobés aux analystes et aux commentateurs ; prometteurs, parce que la saisie du harcèlement sexuel sur la dimension socioculturelle permet de mieux le comprendre et d'y apporter quelques remèdes.
Le harcèlement sexuel est
un concept qu'il fau préciser
en explicitant davantage
sa nature sociologique
Un pas géant, puis-je dire, est franchi si on considère le harcèlement au sein des universités comme le colloraire d'une relation compliquée qui s'instaure entre enseignants et étudiants et qui tire son origine des prédispositions psychologiques spécifiques à chaque sexe. Sous cet angle, si on en croit les sexologues, l'homme est aisément excitable ; souvent, il n'a besoin ni de caresses, ni de baisers pour avoir envie de s'accoupler ; le regard est déjà à ce sujet un stimulus sûr et infaillible. On comprend alors pourquoi dans toutes les sociétés modernes un homme soudainement séduit par une femme ne manque souvent pas, à son passage, de porter furtivement son regard sur ses charmes apparents ; se justifie, du même coup, le soin grandissant voire abusif que les femmes consacrent aux parties attirantes de leurs corps. La femme, au contraire, est à l'abri de toute excitation à distance ; seuls les attouchements ont de l'effet sur sa libido. En d'autres termes, les caresses sont pour la femme ce qu'est le regard pour l'homme. Ces différentes prédispositions relatives à notre vie sexuelle sont assorties de deux attitudes à la fois distinctes et complémentaires : une attitude virile, entreprenante, car excitable à distance et une attitude féminine, accueillante et inexcitable à distance. Ces deux attitudes définissent les conduites propres à l'homme et à la femme en matière du désir sexuel et des projets de relations, qui se résument, tout bien considéré, dans deux traits de caractère : un trait entreprenant, d'un côté, et un trait encourageant, de l'autre. Je remarquerai incidemment à cet égard que nos ancêtres étaient d'excellents sexologues : une tradition encore en usage dans certaines tribus du pays consistait à mal habiller les jeunes filles et à les encourager à négliger leur toilette. Ainsi les jeunes en quête de relations sexuelles en étaient-ils détournés tant par la vue que par l'odorat, deux sens fondamentaux dans l'éveil de l'envie chez l'homme.
Il s'ensuit que le harcèlement sexuel est un concept qu'il faut préciser en explicitant davantage sa nature sociologique selon que le sujet de cette conduite est un homme ou une femme. La nature psychologique complexe de la femme l'empêche d'exercer ostensiblement un harcèlement sexuel sur l'homme ; sa stratégie est pourtant simple : déguiser ce penchant sous le fatras inextricable de la séduction, autrement dit adopter un comportement d'expression physique qui harcèle l'homme à distance : des vêtements moulants, un maquillage idéalisant, une coiffure ingénieuse, le tout assorti d'un déhanchement soigneusement adapté à la posture adoptée, et je ne sais quoi encore, voilà quelques-uns des éléments de cette armure que peu d'hommes peuvent défier.
Le témoignage linguistique s'avérera lui aussi utile quant à cerner la nature du harcèlement sexuel à distance ; l'expression allumeuse en effet, très courante dans les sociétés occidentales, en plus de son sens lexical, véhicule un contenu socioculturel précis qui traduit clairement l'idée que l'opinion publique s'en forge. Il s'agit sinon de blâmer, du moins de reconnaître comme tel un comportement qui s'évertue à dissimuler ses desseins de séduction.
Le problème doit être reposé sur la foi d'une prise de conscience collective
Par ailleurs, la menace d'un harcèlement sexuel est d'autant plus imminente que les acteurs du jeu de la séduction passent ensemble une heure ou deux chaque semaine, dans une classe, un bureau, etc. Théoriquement, c'est dans les lieux plus ou moins clos, qui favorisent le voisinage et la familiarité, que le taux du harcèlement est assez élevé. Plus l'homme est excité et que sa concupiscence s'exacerbe, moins il se contrôlera, surtout en absence de témoins. Dans ce cas, dire incontestablement que cet individu harcèle telle étudiante ou telle employée est très vraisemblable, pourvu qu'on ne passe pas sous silence le fait qu'il peut lui aussi être harcelé, ne serait-ce qu'à distance, c'est-à-dire par le jeu compromettant du corps.
Une relation dialectique, pour ainsi dire, entre harcelant et harcelé, dans l'espace et le temps concernés (notons qu'il est difficile de saisir le harcèlement en dehors d'un ancrage spatio-temporel des individus co-présents), est maintenue vive et tend à se compliquer davantage par l'imbrication des évènements et des détails quotidiens pour autant que la durée de leur coprésence soit prolongée.
Ce bref petit éclairage nous arrête dans cette certitude : le problème doit être reposé sur la foi d'une prise de conscience collective des deux attitudes, projet qui aboutira, si l'effort est poursuivi, à l'élaboration d'une approche sociologique globale où le phénomène sera appréhendé non seulement en termes de cas isolés mais surtout en termes d'actes d'une comportementale (i.e. l'ensemble des comportements spécifiques à une culture donnée) socioculturelle bien déterminée.
Pour conclure et afin de prévenir un malentendu, je dirai que l'enseignement universitaire ne sera, en plus des obstacles qui entravent son essor aujourd'hui, que plus lacuneux si on décide un jour d'autoriser les étudiants à poursuivre en justice leurs enseignants pour harcèlement sexuel.
En effet, à voir ce type d'étudiantes extorquer de bonnes notes à leurs enseignants sous peine de poursuites judiciaires, certains étudiants ne manqueront, à leur tour, ni d'idées, ni d'audace pour les dépasser. Il s'ensuivra naturellement une rivalité où l'enseignement, qui pâtit de tant de mépris social, ne sera que plus bafoué et écrasé, à l'instar des grenouilles du bonhomme (La Fontaine), sous les pas imprudents de tendances concurrentielles.
Si je prends part à ce débat, c'est parce que, d'une part, je suis enseignant et que, du coup, je me considère concerné par les commentaires qui foisonnent sur la malhonnêteté des enseignants et, d'autre part, parce que le concept de harcèlement sous la plume des commentateurs ne semble le plus souvent s'appliquer qu'aux hommes. Lever l'ambiguïté de ce comportement en explicitant sa nature selon le sexe, tel me paraît être le meilleur moyen d'enrichir le débat sur le sujet aussi bien que de le relancer sur la base de nouvelles considérations.
Chose curieuse par ailleurs, dans la signification de l'expression harcèlement sexuel, et plus précisément de son équivalent arabe “Ataharoch eljinsi”, il y a, comme diraient les sémanticiens, un type de sème génétiquement lié au sens du terme “homme” et qui est suffisamment appuyé par un certain symbolisme phonétique du lexème lui-même, en ce sens que l'articulation de l'expression ne manque pas d'évoquer prioritairement l'homme et très secondairement la femme.
Complexité
du phénomène
C'est un débat vain que de chercher l'origine de ce fléau dans le comportement, peut-on dire, tyrannique et narcissique de l'enseignant.
Diagnostiquer pertinemment le phénomène du harcèlement sexuel dans les universités marocaines exige, afin d'évoluer vers des solutions sérieuses du phénomène, de prendre en ligne de compte non seulement le pouvoir dont semble être investi l'enseignant mais également celui dont disposent les étudiantes et qu'elles mettent souvent à profit pour atteindre les buts escomptés. Ce pouvoir est celui qui constitue au fond leur raison d'être : la beauté. Il s'agit de mettre l'accent moins sur les conséquences fâcheuses du harcèlement que sur les raisons profondes qui y conduisent. C'est un débat vain que de chercher l'origine de ce fléau dans le comportement, peut-on dire, tyrannique et narcissique de l'enseignant et d'en attribuer les causes seulement à ses penchants pervers, ce qui revient à considérer le phénomène, malgré son ampleur et sa teinte sociale, comme un phénomène purement individuel, mais il convient plutôt de l'approcher dans toute sa complexité et sous ses différents aspects. Car, effectivement, un comportement donné, fût-il le moins récurrent dans ce qu'on peut appeler l'ensemble des comportements des hommes d'une société culturellement bien déterminée est nécessairement social, puisqu'il est, pour peu qu'on y regarde de près, étroitement lié aux circonstances, de quelque nature qu'elles soient, qui l'ont favorisé. Les scènes quotidiennes de l'ivrogne, du mendiant, du voleur, du voyou, etc., à titre d'exemple, sont loin d'être des cas isolés, détachés de tout ancrage sociopolitique. Si l'homme croit à son humanité et par conséquent à son amendement, rien ne doit donc s'opposer à sa volonté d'ériger une société saine où les défauts et les maladies de l'âme sont reconnus et pris en charge par la société humaine en vertu d'une décision politique qui émanerait d'une conscience universelle.
Qu'on se garde de penser qu'une telle volonté, pour se concrétiser, doit se transformer en une forme de despotisme ; la démarche recommandée s'appuie sur les vertus de l'effort continu et sur la perspective d'une vision globale qui questionne toutes les structures de la société, prises qu'elles sont supposées être dans leurs interrelations, ou pour mieux dire, dans leur interaction.
Une telle façon de voir autorise à revoir le phénomène du harcèlement sexuel en général sous des aspects nouveaux et prometteurs. Nouveaux, parce qu'on est appelé à en pénétrer les recoins qui demeurent souvent dérobés aux analystes et aux commentateurs ; prometteurs, parce que la saisie du harcèlement sexuel sur la dimension socioculturelle permet de mieux le comprendre et d'y apporter quelques remèdes.
Le harcèlement sexuel est
un concept qu'il fau préciser
en explicitant davantage
sa nature sociologique
Un pas géant, puis-je dire, est franchi si on considère le harcèlement au sein des universités comme le colloraire d'une relation compliquée qui s'instaure entre enseignants et étudiants et qui tire son origine des prédispositions psychologiques spécifiques à chaque sexe. Sous cet angle, si on en croit les sexologues, l'homme est aisément excitable ; souvent, il n'a besoin ni de caresses, ni de baisers pour avoir envie de s'accoupler ; le regard est déjà à ce sujet un stimulus sûr et infaillible. On comprend alors pourquoi dans toutes les sociétés modernes un homme soudainement séduit par une femme ne manque souvent pas, à son passage, de porter furtivement son regard sur ses charmes apparents ; se justifie, du même coup, le soin grandissant voire abusif que les femmes consacrent aux parties attirantes de leurs corps. La femme, au contraire, est à l'abri de toute excitation à distance ; seuls les attouchements ont de l'effet sur sa libido. En d'autres termes, les caresses sont pour la femme ce qu'est le regard pour l'homme. Ces différentes prédispositions relatives à notre vie sexuelle sont assorties de deux attitudes à la fois distinctes et complémentaires : une attitude virile, entreprenante, car excitable à distance et une attitude féminine, accueillante et inexcitable à distance. Ces deux attitudes définissent les conduites propres à l'homme et à la femme en matière du désir sexuel et des projets de relations, qui se résument, tout bien considéré, dans deux traits de caractère : un trait entreprenant, d'un côté, et un trait encourageant, de l'autre. Je remarquerai incidemment à cet égard que nos ancêtres étaient d'excellents sexologues : une tradition encore en usage dans certaines tribus du pays consistait à mal habiller les jeunes filles et à les encourager à négliger leur toilette. Ainsi les jeunes en quête de relations sexuelles en étaient-ils détournés tant par la vue que par l'odorat, deux sens fondamentaux dans l'éveil de l'envie chez l'homme.
Il s'ensuit que le harcèlement sexuel est un concept qu'il faut préciser en explicitant davantage sa nature sociologique selon que le sujet de cette conduite est un homme ou une femme. La nature psychologique complexe de la femme l'empêche d'exercer ostensiblement un harcèlement sexuel sur l'homme ; sa stratégie est pourtant simple : déguiser ce penchant sous le fatras inextricable de la séduction, autrement dit adopter un comportement d'expression physique qui harcèle l'homme à distance : des vêtements moulants, un maquillage idéalisant, une coiffure ingénieuse, le tout assorti d'un déhanchement soigneusement adapté à la posture adoptée, et je ne sais quoi encore, voilà quelques-uns des éléments de cette armure que peu d'hommes peuvent défier.
Le témoignage linguistique s'avérera lui aussi utile quant à cerner la nature du harcèlement sexuel à distance ; l'expression allumeuse en effet, très courante dans les sociétés occidentales, en plus de son sens lexical, véhicule un contenu socioculturel précis qui traduit clairement l'idée que l'opinion publique s'en forge. Il s'agit sinon de blâmer, du moins de reconnaître comme tel un comportement qui s'évertue à dissimuler ses desseins de séduction.
Le problème doit être reposé sur la foi d'une prise de conscience collective
Par ailleurs, la menace d'un harcèlement sexuel est d'autant plus imminente que les acteurs du jeu de la séduction passent ensemble une heure ou deux chaque semaine, dans une classe, un bureau, etc. Théoriquement, c'est dans les lieux plus ou moins clos, qui favorisent le voisinage et la familiarité, que le taux du harcèlement est assez élevé. Plus l'homme est excité et que sa concupiscence s'exacerbe, moins il se contrôlera, surtout en absence de témoins. Dans ce cas, dire incontestablement que cet individu harcèle telle étudiante ou telle employée est très vraisemblable, pourvu qu'on ne passe pas sous silence le fait qu'il peut lui aussi être harcelé, ne serait-ce qu'à distance, c'est-à-dire par le jeu compromettant du corps.
Une relation dialectique, pour ainsi dire, entre harcelant et harcelé, dans l'espace et le temps concernés (notons qu'il est difficile de saisir le harcèlement en dehors d'un ancrage spatio-temporel des individus co-présents), est maintenue vive et tend à se compliquer davantage par l'imbrication des évènements et des détails quotidiens pour autant que la durée de leur coprésence soit prolongée.
Ce bref petit éclairage nous arrête dans cette certitude : le problème doit être reposé sur la foi d'une prise de conscience collective des deux attitudes, projet qui aboutira, si l'effort est poursuivi, à l'élaboration d'une approche sociologique globale où le phénomène sera appréhendé non seulement en termes de cas isolés mais surtout en termes d'actes d'une comportementale (i.e. l'ensemble des comportements spécifiques à une culture donnée) socioculturelle bien déterminée.
Pour conclure et afin de prévenir un malentendu, je dirai que l'enseignement universitaire ne sera, en plus des obstacles qui entravent son essor aujourd'hui, que plus lacuneux si on décide un jour d'autoriser les étudiants à poursuivre en justice leurs enseignants pour harcèlement sexuel.
En effet, à voir ce type d'étudiantes extorquer de bonnes notes à leurs enseignants sous peine de poursuites judiciaires, certains étudiants ne manqueront, à leur tour, ni d'idées, ni d'audace pour les dépasser. Il s'ensuivra naturellement une rivalité où l'enseignement, qui pâtit de tant de mépris social, ne sera que plus bafoué et écrasé, à l'instar des grenouilles du bonhomme (La Fontaine), sous les pas imprudents de tendances concurrentielles.



















 Pourquoi Bank Al-Maghrib tarde-t-elle à baisser son taux directeur ?
Pourquoi Bank Al-Maghrib tarde-t-elle à baisser son taux directeur ?