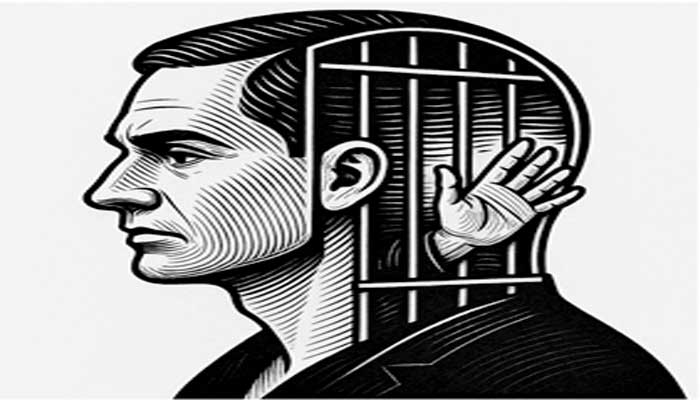
Chacun porte en lui une histoire. Elle ne commence pas toujours par « il était une fois » ; parfois, elle s’ouvre sur un cri, parfois sur un silence. Elle est faite de poussières d’enfance, de gestes répétés, de blessures refermées ou mal cicatrisées. Elle s’imprime dans la chair et dans la mémoire, au point que l’on finit par ne plus savoir si c’est nous qui habitons l’histoire… ou si c’est elle qui nous habite.
Les histoires qui nous façonnent
C’est cette histoire qui érige, pierre après pierre, la cathédrale invisible de nos croyances. Elle dicte ce que nous tenons pour vrai, ce que nous jugeons faux, ce qui mérite d’être aimé ou combattu. Elle agit comme un filtre : chaque mot que nous entendons, chaque visage que nous croisons, chaque événement que nous traversons passe à travers ce tamis invisible. Et ce qui en ressort ne ressemble pas à la réalité brute, mais à une réalité taillée, polie, parfois déformée par les mains patientes ou maladroites de notre passé.
Mais il y a une autre couche, plus subtile : l’histoire que nous offrons aux autres. Car nul ne se contente de vivre enfermé dans sa seule vérité ; nous construisons aussi une façade, une narration publique. Nous choisissons les chapitres à montrer, les zones d’ombre à laisser dans le hors-champ. Nous savons, consciemment ou non, que cette version exposée deviendra ce que l’on croira de nous, et, par ricochet, ce que l’on croira du monde que nous habitons.
Et alors, entre ces deux histoires, celle qui nous a faits et celle que nous montrons, se déploie un espace fragile : un théâtre silencieux où nous jouons, devant les autres et devant nous-mêmes, le rôle que nous pensons devoir tenir. Peut-être est-ce là, dans cet interstice, que se loge la vérité : non pas dans la pureté impossible d’un récit intact, mais dans le dialogue infini entre ce que nous croyons… et ce que nous voulons que l’on croie
Vérités multiples face au récit dominant
La vérité est subjective. Elle ne se présente jamais nue, détachée de celui qui la porte. Elle emprunte toujours la voix, les gestes, les blessures et les espérances de celui qui la raconte. Ce que nous appelons « vérité » n’est souvent qu’un reflet dans l’eau : limpide si l’on regarde d’un certain angle, déformé si l’on bouge d’un pas. Elle vit dans la perspective, se nourrit des expériences, se teinte des émotions. Ce n’est pas qu’elle mente ; c’est qu’elle ne sait pas exister sans un regard pour la façonner.
La vérité est partielle. Comme un tableau vu à travers une meurtrière, elle ne nous offre jamais tout son paysage. Elle laisse des zones floues, des angles morts, des silences que l’on comble avec ce que l’on croit savoir. Elle est morcelée, fragile, parfois volontairement amputée pour servir un propos, d’autres fois par simple ignorance. Chacun ne détient qu’un fragment, et c’est dans l’assemblage incertain de ces fragments que nous prétendons voir l’ensemble.
Et dans ce vaste champ d’histoires qui s’entrecroisent, une seule finit souvent par s’élever au-dessus des autres : l’histoire prédominante. Celle qui, par la force de sa répétition, par l’ampleur de sa diffusion, impose ses contours comme s’ils étaient les limites mêmes du réel. Peu importe qu’elle soit complète ou biaisée : à force de l’entendre, nous la prenons pour la vérité entière. Dans le silence des récits éteints ou étouffés, elle se dresse, seule, comme si aucune autre version n’avait jamais existé.
Repenser une croyance, c’est sortir du confort invisible
L’esprit humain suit la loi de dépense minimale. Comme l’eau qui cherche toujours la pente la plus douce, il emprunte les chemins déjà tracés, ceux qui demandent le moins d’énergie. Il aime les raccourcis, les automatismes, les sentiers battus de la pensée où il n’a plus à se battre pour avancer. Nos habitudes ne sont pas seulement dans nos gestes : elles sont dans la manière même dont nous pensons.
Repenser une croyance, généralement ancrée suite à un récit, c’est sortir de ce confort invisible. C’est remettre en question des murs que l’on croyait porteurs, démonter des structures intérieures construites parfois depuis l’enfance. Cet acte exige un effort intellectuel considérable, un mouvement intérieur qui dérange, qui fatigue, qui effraie. Car il ne s’agit pas seulement d’ajouter une nouvelle idée : il faut défaire l’ancienne, se confronter au vertige de ne plus savoir, accepter l’inconfort de l’incertitude.
C’est pour cela que le changement est difficile, et que celui des croyances l’est plus encore. On peut changer une habitude, déplacer un meuble, modifier un trajet quotidien. Mais changer une croyance, c’est toucher au noyau même de notre identité. C’est accepter de redevenir apprenti dans un domaine où l’on se croyait maître. Et l’être humain, par nature, préfère préserver ses repères, même imparfaits, que s’aventurer dans un espace mental où tout est à reconstruire.
La vigilance face aux récits. Ils ne sont jamais neutres
Faisons alors bien attention aux histoires que nous entendons. Elles ne sont jamais neutres. Elles glissent en nous comme une goutte d’encre dans un verre d’eau, se diffusant lentement jusqu’à colorer tout ce que nous voyons. Une histoire, même banale en apparence, porte toujours en elle une vision du monde, un parfum d’interprétation, parfois une injonction silencieuse. Et, à force d’être entendue, répétée, approuvée, elle finit par s’installer au fond de nous comme une évidence que l’on ne questionne plus.
Car ces histoires ne se contentent pas de nous divertir : elles façonnent nos croyances. Elles plantent des graines qui germeront en convictions, parfois sans que nous en soyons conscients. Et certaines de ces croyances, sous des apparences rassurantes, peuvent devenir des murs invisibles, des frontières que nous n’osons plus franchir. Elles limitent nos choix, brident nos élans, rétrécissent notre horizon.
Le danger, c’est que ces limites ne se manifestent pas toujours immédiatement. Elles se révèlent à moyen ou à long terme, lorsque nous réalisons que nos décisions, nos rêves, nos relations mêmes ont été guidés par une histoire que nous n’avons jamais choisie, mais simplement héritée. Alors, écouter une histoire, ce n’est jamais un acte innocent : c’est ouvrir la porte à une graine qui, un jour, pourrait dicter la forme de notre vie.
Ce que nous croyons «voir» est filtré par ce que nous avons entendu comme histoires
En conséquence, nous passerons, souvent sans le savoir, toute notre vie à confondre une part de vérité avec la réalité entière. Nous prendrons une lueur pour le soleil, une fenêtre pour l’horizon. Nous confondrons le reflet dans le miroir avec le visage qu’il prétend représenter. Ce que nous croyons « voir » ne sera jamais que la traduction de notre propre regard, filtrée par les histoires que nous avons entendues, par les croyances que nous avons adoptées ou héritées.
Et, sans que nous en ayons conscience, notre potentiel se rétrécira. Non pas parce qu’il aura réellement diminué, mais parce que nous aurons cessé de l’explorer. Nous marcherons dans un champ immense en nous interdisant d’approcher ses frontières, persuadés que le monde s’arrête là où s’arrête notre certitude. Cette limitation invisible façonnera nos choix, nos rêves, nos relations, nos défaites autant que nos victoires.
La plus grande prison n’est pas faite de murs, ni de barreaux, ni de portes verrouillées. Elle se construit dans l’ombre de notre esprit, brique après brique, par des vérités partielles que nous prenons pour absolues. Et le plus tragique, c’est que nous la défendons comme si elle nous protégeait. Nous nous croyons libres tout en gardant la clé de notre propre cellule dans notre poche.
Ainsi, notre liberté la plus précieuse - celle de penser autrement, d’oser désobéir à nos certitudes, d’élargir l’horizon - se trouve souvent limitée non par la main d’un tyran extérieur, mais par les murs que nous avons, nous-mêmes, élevés en nous. Et tant que nous ne questionnons pas les histoires qui nous ont façonnés, tant que nous ne cherchons pas à voir au-delà du prisme que nous avons accepté, nous continuerons à vivre en cercle fermé… convaincus, avec une sincérité désarmante, que ce cercle est l’univers entier.
Par Abderrazak Hamzaoui
Email : hamzaoui@hama-co.net
www.hama-co.net
Les histoires qui nous façonnent
C’est cette histoire qui érige, pierre après pierre, la cathédrale invisible de nos croyances. Elle dicte ce que nous tenons pour vrai, ce que nous jugeons faux, ce qui mérite d’être aimé ou combattu. Elle agit comme un filtre : chaque mot que nous entendons, chaque visage que nous croisons, chaque événement que nous traversons passe à travers ce tamis invisible. Et ce qui en ressort ne ressemble pas à la réalité brute, mais à une réalité taillée, polie, parfois déformée par les mains patientes ou maladroites de notre passé.
Mais il y a une autre couche, plus subtile : l’histoire que nous offrons aux autres. Car nul ne se contente de vivre enfermé dans sa seule vérité ; nous construisons aussi une façade, une narration publique. Nous choisissons les chapitres à montrer, les zones d’ombre à laisser dans le hors-champ. Nous savons, consciemment ou non, que cette version exposée deviendra ce que l’on croira de nous, et, par ricochet, ce que l’on croira du monde que nous habitons.
Et alors, entre ces deux histoires, celle qui nous a faits et celle que nous montrons, se déploie un espace fragile : un théâtre silencieux où nous jouons, devant les autres et devant nous-mêmes, le rôle que nous pensons devoir tenir. Peut-être est-ce là, dans cet interstice, que se loge la vérité : non pas dans la pureté impossible d’un récit intact, mais dans le dialogue infini entre ce que nous croyons… et ce que nous voulons que l’on croie
Vérités multiples face au récit dominant
La vérité est subjective. Elle ne se présente jamais nue, détachée de celui qui la porte. Elle emprunte toujours la voix, les gestes, les blessures et les espérances de celui qui la raconte. Ce que nous appelons « vérité » n’est souvent qu’un reflet dans l’eau : limpide si l’on regarde d’un certain angle, déformé si l’on bouge d’un pas. Elle vit dans la perspective, se nourrit des expériences, se teinte des émotions. Ce n’est pas qu’elle mente ; c’est qu’elle ne sait pas exister sans un regard pour la façonner.
La vérité est partielle. Comme un tableau vu à travers une meurtrière, elle ne nous offre jamais tout son paysage. Elle laisse des zones floues, des angles morts, des silences que l’on comble avec ce que l’on croit savoir. Elle est morcelée, fragile, parfois volontairement amputée pour servir un propos, d’autres fois par simple ignorance. Chacun ne détient qu’un fragment, et c’est dans l’assemblage incertain de ces fragments que nous prétendons voir l’ensemble.
Et dans ce vaste champ d’histoires qui s’entrecroisent, une seule finit souvent par s’élever au-dessus des autres : l’histoire prédominante. Celle qui, par la force de sa répétition, par l’ampleur de sa diffusion, impose ses contours comme s’ils étaient les limites mêmes du réel. Peu importe qu’elle soit complète ou biaisée : à force de l’entendre, nous la prenons pour la vérité entière. Dans le silence des récits éteints ou étouffés, elle se dresse, seule, comme si aucune autre version n’avait jamais existé.
Repenser une croyance, c’est sortir du confort invisible
L’esprit humain suit la loi de dépense minimale. Comme l’eau qui cherche toujours la pente la plus douce, il emprunte les chemins déjà tracés, ceux qui demandent le moins d’énergie. Il aime les raccourcis, les automatismes, les sentiers battus de la pensée où il n’a plus à se battre pour avancer. Nos habitudes ne sont pas seulement dans nos gestes : elles sont dans la manière même dont nous pensons.
Repenser une croyance, généralement ancrée suite à un récit, c’est sortir de ce confort invisible. C’est remettre en question des murs que l’on croyait porteurs, démonter des structures intérieures construites parfois depuis l’enfance. Cet acte exige un effort intellectuel considérable, un mouvement intérieur qui dérange, qui fatigue, qui effraie. Car il ne s’agit pas seulement d’ajouter une nouvelle idée : il faut défaire l’ancienne, se confronter au vertige de ne plus savoir, accepter l’inconfort de l’incertitude.
C’est pour cela que le changement est difficile, et que celui des croyances l’est plus encore. On peut changer une habitude, déplacer un meuble, modifier un trajet quotidien. Mais changer une croyance, c’est toucher au noyau même de notre identité. C’est accepter de redevenir apprenti dans un domaine où l’on se croyait maître. Et l’être humain, par nature, préfère préserver ses repères, même imparfaits, que s’aventurer dans un espace mental où tout est à reconstruire.
La vigilance face aux récits. Ils ne sont jamais neutres
Faisons alors bien attention aux histoires que nous entendons. Elles ne sont jamais neutres. Elles glissent en nous comme une goutte d’encre dans un verre d’eau, se diffusant lentement jusqu’à colorer tout ce que nous voyons. Une histoire, même banale en apparence, porte toujours en elle une vision du monde, un parfum d’interprétation, parfois une injonction silencieuse. Et, à force d’être entendue, répétée, approuvée, elle finit par s’installer au fond de nous comme une évidence que l’on ne questionne plus.
Car ces histoires ne se contentent pas de nous divertir : elles façonnent nos croyances. Elles plantent des graines qui germeront en convictions, parfois sans que nous en soyons conscients. Et certaines de ces croyances, sous des apparences rassurantes, peuvent devenir des murs invisibles, des frontières que nous n’osons plus franchir. Elles limitent nos choix, brident nos élans, rétrécissent notre horizon.
Le danger, c’est que ces limites ne se manifestent pas toujours immédiatement. Elles se révèlent à moyen ou à long terme, lorsque nous réalisons que nos décisions, nos rêves, nos relations mêmes ont été guidés par une histoire que nous n’avons jamais choisie, mais simplement héritée. Alors, écouter une histoire, ce n’est jamais un acte innocent : c’est ouvrir la porte à une graine qui, un jour, pourrait dicter la forme de notre vie.
Ce que nous croyons «voir» est filtré par ce que nous avons entendu comme histoires
En conséquence, nous passerons, souvent sans le savoir, toute notre vie à confondre une part de vérité avec la réalité entière. Nous prendrons une lueur pour le soleil, une fenêtre pour l’horizon. Nous confondrons le reflet dans le miroir avec le visage qu’il prétend représenter. Ce que nous croyons « voir » ne sera jamais que la traduction de notre propre regard, filtrée par les histoires que nous avons entendues, par les croyances que nous avons adoptées ou héritées.
Et, sans que nous en ayons conscience, notre potentiel se rétrécira. Non pas parce qu’il aura réellement diminué, mais parce que nous aurons cessé de l’explorer. Nous marcherons dans un champ immense en nous interdisant d’approcher ses frontières, persuadés que le monde s’arrête là où s’arrête notre certitude. Cette limitation invisible façonnera nos choix, nos rêves, nos relations, nos défaites autant que nos victoires.
La plus grande prison n’est pas faite de murs, ni de barreaux, ni de portes verrouillées. Elle se construit dans l’ombre de notre esprit, brique après brique, par des vérités partielles que nous prenons pour absolues. Et le plus tragique, c’est que nous la défendons comme si elle nous protégeait. Nous nous croyons libres tout en gardant la clé de notre propre cellule dans notre poche.
Ainsi, notre liberté la plus précieuse - celle de penser autrement, d’oser désobéir à nos certitudes, d’élargir l’horizon - se trouve souvent limitée non par la main d’un tyran extérieur, mais par les murs que nous avons, nous-mêmes, élevés en nous. Et tant que nous ne questionnons pas les histoires qui nous ont façonnés, tant que nous ne cherchons pas à voir au-delà du prisme que nous avons accepté, nous continuerons à vivre en cercle fermé… convaincus, avec une sincérité désarmante, que ce cercle est l’univers entier.
Par Abderrazak Hamzaoui
Email : hamzaoui@hama-co.net
www.hama-co.net










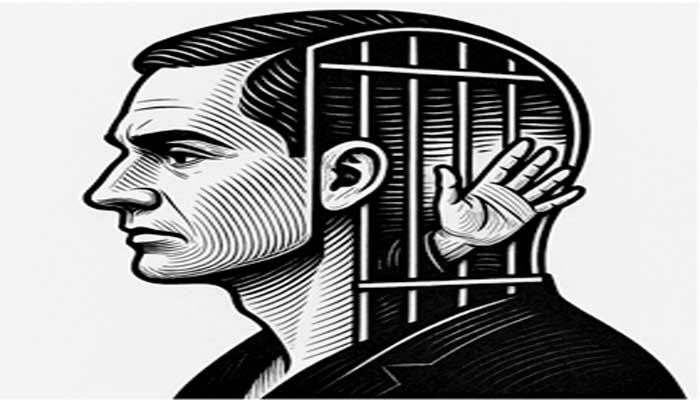








 Pourquoi Bank Al-Maghrib tarde-t-elle à baisser son taux directeur ?
Pourquoi Bank Al-Maghrib tarde-t-elle à baisser son taux directeur ?



