-
Barid Al-Maghrib émet un timbre-poste commémoratif célébrant le centenaire du notariat au Maroc
-
Le modèle marocain de pluralisme et de vivre-ensemble célébré à Washington à l’occasion de la Hanoukka
-
Parlement: Plaidoyer pour une stratégie sportive globale, équitable et inclusive
-
Mohamed Salem Cherkaoui : L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a financé des projets d'une valeur de huit millions de dollars en 2025
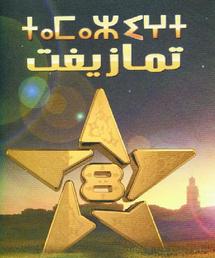
L’éminent professeur Mohamed Chafik aimait toujours citer l’exemple de ce syntagme qui illustre cette magnifique construction du paysage linguistique marocain : «la source de Aïn Aghbalou», trois vocables linguistiques différents qui renvoient au même référent la source qui veut dire Aïn en arabe et Aghbalou en amazigh ; leur énoncé dit la hiérarchie inversée des langues au Maroc.
Dans son livre de référence Les Berbères, Gabriel Camps écrit : «Les millénaires ont passé et malgré les vicissitudes d’une histoire particulièrement riche en conquêtes, invasions et tentatives d’assimilation, des populations du même groupe ethnique, les Berbères, subsistent… ». Cette continuité historique qui, se traduisant par une langue, une culture, des formes variées d’expression artistique était acculée du point de vue de sa représentation sociale et médiatique à la marginalité voire à l’underground. Il a fallu alors une prise de conscience politique qui a rencontré un engagement culturel permanent pour trouver une issue graduelle au droit à l’image de la langue amazighe.
Aujourd’hui c’est chose faite, le marché symbolique de la circulation des valeurs va connaître une nouvelle donne réhabilitant une part importante de notre capital culturel. Les discours nous apprend Bourdieu, ne sont pas seulement des signes destinés à être compris, déchiffrés, « ce sont aussi des signes de richesse destinés à être évalués, appréciés et des signes d’autorité destinés à être crus et obéis ». L’accès du signe amazigh au signal cathodique lui offre ainsi cette opportunité de se mettre en concurrence avec les autres formes linguistiques qui inondent le marché marocain. Sa cote va indéniablement connaître une réévaluation selon de nouveaux critères : désormais elle n’est plus langue du folklore ou du patrimoine. Elle est partie constitutive d’une nouvelle transaction, avec un nouveau statut. C’est une nouvelle chaîne, qui répond à une nécessité politique et culturelle, elle doit être aussi une nouvelle télévision, dans son fonctionnement et son discours. Certes, le chemin ne sera pas facile : la chaîne amazighe arrive au moment où ses sœurs aînées traversent un passage à vide catastrophique en termes de rendement et d’image : la TVM se cherche encore et 2M n’est plus que l’ombre d’elle-même et au moment où les autres chaînes thématiques sont des satellites bureaucratiques de la chaîne mère. Est-ce qu’on va assister une nouvelle fois à la mise à mort d’une excellente idée ? Ce serait impardonnable. M. Mamad, le premier patron dans l’histoire du PAM de la chaîne amazighe, se trouve devant une responsabilité historique. On sait qu’il ne part pas de rien. Il y a une grande tradition de production audiovisuelle amazighe. Il y a une pléthore de sociétés de production qui investissent ce champ encore en friche. Comment gérer tout cela ? En privilégiant une programmation de proximité, une mobilisation des potentialités locales et surtout un nouveau type de relation mettant en avant la transparence, le professionnalisme et des cahiers de charges publics. Le clientélisme, le clanisme ont écrasé toute velléité de création du côté de la chaîne mère. L’amazighité mérite une autre manière de faire la télévision ; c’est un héritage de trente siècles qui en est témoin.




















