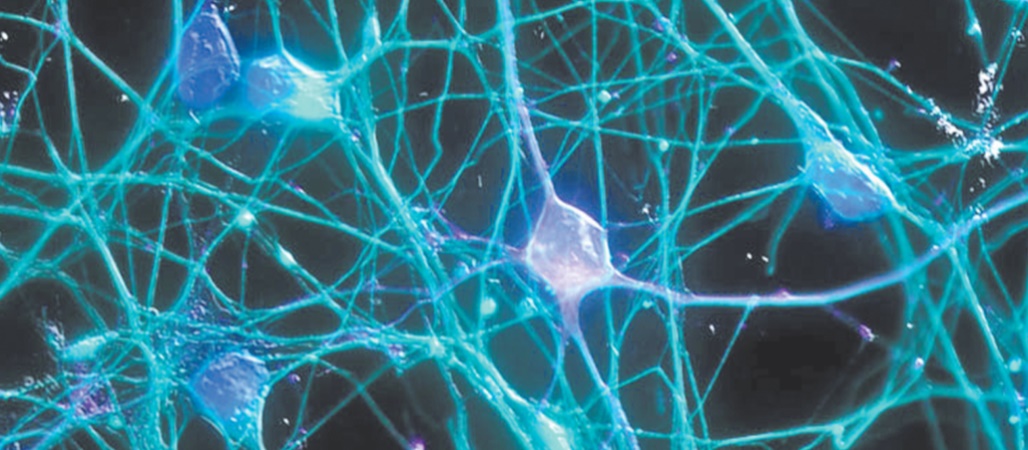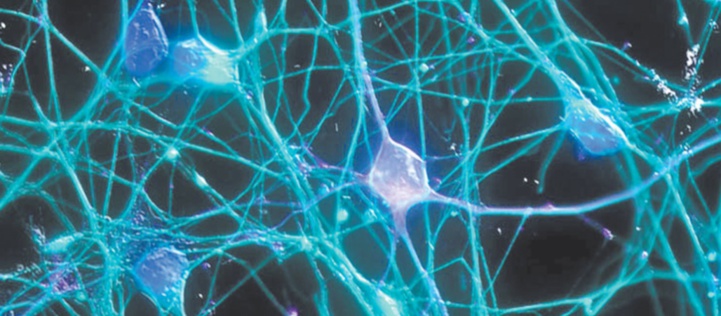Qu’est-ce que c’est ?
La sclérose en plaques (SEP) est un grain de sable dans le système nerveux. En termes plus savants, selon la littérature scientifique sur le sujet, c’est une maladie inflammatoire qui attaque le système nerveux central, en particulier le cerveau, les nerfs optiques et la moelle épinière. Concrètement, elle altère la transmission des influx nerveux et peut se manifester par des symptômes très variables, allant de l’engourdissement d’un membre, jusqu’aux troubles de la vision, en passant par des sensations de décharge électrique dans un membre ou dans le dos et des troubles des mouvements. Sans oublier les troubles invisibles comme la fatigue, qui n’est pas proportionnelle à l’évolution de la maladie ou à la sévérité du handicap. D’ailleurs, c’est un symptôme souvent non reconnu par l’entourage familial et professionnel. La SEP peut également à plus ou moins long terme, transformer ces troubles en un handicap irréversible. Aussi se caractérise-t-elle majoritairement par une aggravation lente.
Quelles sont les personnes
à risque ?
Bien qu’elle ne soit pas une maladie héréditaire, les personnes dont un proche parent est atteint de sclérose en plaques présentent un risque accru de l’être aussi. Les personnes ayant un problème de thyroïde de nature auto-immune, celles atteintes du diabète de type 1 ou d’une maladie inflammatoire de l’intestin sont légèrement plus à risque également. En outre, elle touche plus de femmes que d'hommes avec une proportion de 1.7 femme pour 1 homme.
Dans un entretien accordé au « Monde », le professeur d'immunologie Roland Liblau explique que si «la sclérose en plaques (SEP) est une maladie complexe, cela vient du fait qu'il existe un substrat génétique à la maladie, mais aussi des facteurs environnementaux». Parmi ces derniers, il y a celui selon lequel les peuples d’Asie, d’Afrique et les autochtones d’Amérique seraient moins touchés par la maladie, contrairement aux descendants des Nord-Européens qui ont une prédisposition à la sclérose en plaques. Ainsi, la maladie serait cinq fois plus fréquente dans les régions nordiques ou tempérées (comme l’Amérique du Nord et l’Europe) que sous les climats tropicaux et méridionaux. Jusqu’à présent, le monde scientifique en ignore les raisons. Même si, la vitamine D, produite lors de l’exposition au soleil, pourrait y jouer un rôle.
Le professeur Roland Liblau explique aussi que si les facteurs génétiques « sont accessibles à la compréhension expérimentale : il est possible de les tester et d'investiguer avec justesse». En ce qui concerne les facteurs environnementaux, en revanche, il avoue qu’« on a besoin de mener des études épidémiologiques, car ils sont encore plus nombreux : les infections virales, les bactéries, le tabac, le soleil, les polluants. Il s'agit de pistes et il est encore nécessaire de les tester un par un ». D’après lui, cela explique pourquoi cette maladie demeure énigmatique. D’ailleurs, la médecine ne dispose à ce jour d'aucun traitement curatif.
Des traitements limités
Au jour d’aujourd’hui, les traitements sont limités et ne sont pas en mesure de lutter contre la progression de la maladie. De plus, ceux qui existent ont des effets secondaires pénibles. Néanmoins, ils permettent de réduire les poussées et améliorent la qualité de vie des patients. Dès lors, le traitement de la SEP pourrait passer par une médecine dite de «troisième génération». Considérée comme une médecine de la personne bien plus que de la maladie, elle prône l’écoute et l’accompagnement.
Au Maroc, un jeune médecin résident en urologie au CHU Hassan II de Fès a puisé aussi bien dans les dernières technologies disponibles, que dans l’informatique, les sciences cognitives et les mathématiques, afin de créer l’application “Innov’SEP’’. « Grâce à Innov’SEP, les personnes atteintes de cette maladie renforceront leurs capacités et celle de leurs entourage au moment de prendre en charge cette affection, sur la base d'actions intégrées au projet de soins’’, a expliqué son concepteur (voir notre édition du 18 octobre 2018).
Enfin, il n’existe malheureusement aucun moyen de prévenir la sclérose en plaques, puisque sa cause est inconnue. Cela dit, selon une analyse d'études menées en Suède et aux Etats-Unis, publiée récemment sur le site de l'Académie américaine de neurologie, boire plusieurs tasses de café par jour réduirait le risque de sclérose en plaques. La Dr Ellen Mowry, une neurologue de la Faculté de médecine de l'Université Johns Hopkins à Baltimore (nord-est), principale auteure de cette analyse, précise que «la consommation de caféine a déjà été liée à une réduction du risque des maladies de Parkinson et d'Alzheimer et notre étude montre aussi des effets protecteurs potentiels contre la sclérose en plaques ».