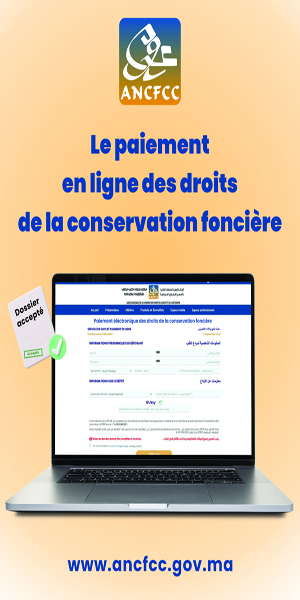-
Biennale de Venise : Pour la première fois, un pavillon marocain au cœur de l'Arsenale
-
Jack Lang contraint à la démission de l'Institut du monde arabe
-
L'UNESCO lance un appel à projets pour promouvoir le statut de l’artiste et la liberté artistique
-
Spectacle artistique à Tanger à l’occasion de la célébration du Nouvel An chinois
Miroir implacable d’une société, la nôtre, qui se refuse de reconnaître l’organe sexuel féminin. Une question de culture et d’éducation qui perdure depuis des générations. Des siècles. En tout cas pendant trop longtemps au point que la moitié de notre société grandit, vit et meurt dans le déni de son identité de femme.
Dès la petite enfance, on demande à la petite fille de croiser ses jambes. De ne jamais montrer ce qu’elle a entre les cuisses. Non, il n’y a rien. Juste un trou noir, qui fait peur, qui doit faire peur. Parce qu’il est la source de tous les problèmes. «Alors, je n’ai jamais su ce que c’était», soupirent en chœur les trois comédiennes, Nouria Benbrahim, Farida Bouazzaoui et Amal Ben Haddou tout en tentant de regarder par-delà le trou noir. «Bon juste à uriner», résument lapidaires les mères, sans cesse menacées de répudiation «si jamais l’honneur de leurs filles…»
D’entrée de scène, les comédiennes attaquent par une question inattendue. Presque incongrue et surtout dérangeante. Derrière elles, le décor est déjà planté. Des slips de toutes les couleurs et de différentes tailles sont suspendus sur un fil à linge. «Comment appelle t-on l’organe sexuel féminin en dialecte marocain? demande l’une d’entre elles. «Pardon ??? Je vous entends mal, à haute voix s’il vous plaît», réplique une autre.
Les noms de cet organe qu’elles ne sauraient voir défilent, scandés à haute et intelligibles voix. En darija, en arabe classique, en amazigh. Des termes souvent crus car la société marocaine n’est pas habituée à les entendre sinon en insulte, par un harceleur.
Les surnoms volent, de la fleur à la menthe. Un bol d’air. L’expression féminine est enfin libérée. On se réconcilie avec la langue, le corps, la femme. «Plus de 30 appellations méchantes ou belles désignent le sexe féminin. «Serrem» : bouche d’égouts, «Guanfoud» : hérisson, «Na3na3a» : menthe, «Al hem» : ennuis, «Ouririda» : fleur….», expliquait Naïma Zitane dans un entretien accordé en juin dernier à nos confrères du «Soir échos». Ici, l’excision culturelle des mots et de toutes les expressions liées à la sexualité féminine des mots est portée par un texte très fort que l’on doit à la Maroco-nippone Maha Sano que sert une dramaturgie et une mise en scène signée de Naima Zitane. Le rire est grinçant. Plus que jamais, l’ironie se fait la forme polie du désespoir. On passe du rire aux larmes. Les questions surgissent, et plus encore les remises en question.
L’adaptation de ces «Monologues du vagin» se fonde sur une réalité très marocaine et a été rendue possible grâce aux 7 mois de résidence au Théâtre Aquarium –effectués avec le soutien de l’Institut français de Rabat- et au cours desquels des témoignages de plus de 150 femmes ont été recueillis. Au final, cela a donné «Dialy», cette création où la femme marocaine se réapproprie enfin son intimité.
En mettant en scène l’organe sexuel féminin, la compagnie «Aquarium» ne fait pas que briser un tabou. Auteur, metteur en scène et comédiennes brisent d’abord un silence assourdissant en faisant le récit de la somme des humiliations subies par l’autre sexe : petite fille différente de son frère dont le sexe est célébré, menstruations qui signent la fin de l’innocence, viol, nuit des noces, hymen rompu, sang et puis la douleur qui continue encore et encore quand cette même petite fille devenue femme donne la vie depuis ce trou noir…
Il faut aller voir et revoir «Dialy» comme un acte de résistance. En ces temps d’incertitude pour les femmes de ce pays , «Dialy» respire la liberté, l’égalité, la tolérance. «Il est à moi. Il m’accompagne partout, y compris à la mosquée». C’est la dernière phrase de la pièce de théâtre. Un message à peine codé…













 Biennale de Venise : Pour la première fois, un pavillon marocain au cœur de l'Arsenale
Biennale de Venise : Pour la première fois, un pavillon marocain au cœur de l'Arsenale