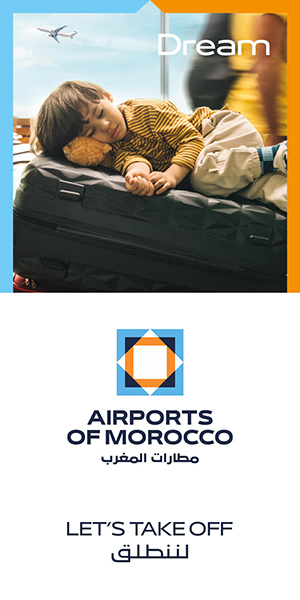Qu’est-ce que le monde a désormais à faire sous le ciel ?

Baudelaire, XXII Fusées (publication posthume) 1887 (la composition daterait des années 1855-1862)
Je me tais ou porte sa parole que je ne cherche pas à consacrer, elle lui revient bien de haut. Je ne me mets pas de son côté, ni en face, je n’implore pas l’émulation, je m’entretiens en biais et je surveille mes détours. Au temps de Baudelaire, la modernité était encore sous la crédulité de la peur, une agression à venir, un malaise pressenti, une vanité pour les uns et une déchéance pour ces autres à même de percevoir par leur unique sensibilité les éclats tristes que produisaient les belles exordes du progrès. Comment ne pas s’ahurir du volume du questionnement qu’est cette interrogation : « Qu’est-ce que le monde a désormais à faire sous le ciel ? » ? Il augurait ou il sollicitait les bons entendeurs ou s’agissait-il d’une interrogation sentencieuse ? Il aurait supposé un monde sans ciel ou un ciel sans monde, nulle flatterie, un naufrage ne s’attaque pas sans le vent du ciel ni l’eau houleuse du monde, et ne se tait sans le silence du ciel, ni l’embellie de l’eau du monde.Avait-il ouï le futur éternel sanglot de l’humanité ? Manifestement oui, la cité avait perdu son poète, le maudissait pour le silence de ses peines et lui, il poursuivait à composer sur la marge, même si courbé et sur le bord, sa parole distillait les obéissances de la course élancée. Il eut fallu beaucoup pour qu’il eût raison, et il eut raison. Ce mal prédit, non dans l’assertion, pervertit tous les aspects du monde, alors que ses conquérants recevaient nonchalamment et en toute jouissance les retournements heureux, la chute n’était pas préalable dans leurs esprits épris de tant de grandeur, et leurs regards obscurcis de tant d’éclats, ils n’avaient pas saisi toute la splendeur de la conjecture inférée abondamment, sous l’égide de la parole débattue et atrophiée du poète maudit. Qui de nos aïeux, qui de nous pourraient démentir cette volée éclairée ? Nous ne le pourrons pas, nous demanderons le repentir pour nos devanciers et pour nous et puis c’est trop tard, l’humanité en nous ne se conjure plus dans ces degrés, les strates de la repentance se sont agglutinées, ruminer ses erreurs ou juste les penser pour en sentir la culpabilité sommeille lourdement dans le repos de l’oubli ; l’humanité ne peut se reprocher ses torts ni se pardonner. Quand le feu du progrès avait terni les étendards de la sensibilité, l’homme ne se soucia plus de lui-même : il cessa de jouir dans le vif de l’émotion, de la mimique, de l’expression de l’autre ; du rire ébréché et édenté de ses vieillards ; du regard dans le regard ; du soupir échangé et partagé, du café ou thé fumant sous les paroles postillonnant de deux interlocuteurs libres de mains, se grattant le nez et se tapant des paumes. Le vivre-ensemble fut dissemblé, la cohorte sortant des usines ne se dénombrait pas, le calcul était vertigineux dans toute la cacophonie des bavardages confondus au rythme de pas. La cohorte fut automatisée, elle ne sort plus, les membres mécaniques se rangent aux extinctions des feux par les quelques délicates mains humaines encore essentielles. Bien vite, l’agitation moderne empoigna les fondements de la famille, les rôles dégradèrent les valeurs, la moralité s’attrista ne supportant que les fioritures, la communication palpita et mourut devant l’écran ou sur les claviers, les tutelles se convertirent et les garde-fous changèrent de décor ou disparurent. Puis et intimement, la vraie faillite, la vraie tourmente fut de pervertir la magie, l’unique magie : l’enfant, à qui et expressément, on déconstruisit son imaginaire, on en déconstruisit toute la construction en le triturant dans un espace exigu où le jeu, première charpente vers la belle connaissance, se tint en une console le consolant de son peu de monde, son monde désormais dépeuplé d’échange et d’imagination. Toute l’injustice se resserre en cet acte, alors encore Baudelaire avait posé la toute bonne question : Qu’est-ce que le monde a désormais à faire sous le ciel ?
Ce monde désensibilisé par la fièvre électronique : voix, image, imagerie, affection, amour, étreintes, embrassades ; fantasmes… perdit l’émotion du regard amoureux échangé au profit d’un profil électronique. Encore ténu dans cette posture de pinacle, l’homme délègue son souffle à la machine, et ne sachant plus quoi faire du temps gagné, il ignorait presque ce qu’il faisait sous le ciel, il ne voyait plus les ombrages des vallées qui s’estompaient, ni la disparition des abords bossués qui avalisaient les divergences : la conscience surdouée du monde. Il s’accommodait aux formes de l’esprit commun qui a pleinement englouti son regard, alors jusqu’ici télescopique. Le regard pencha, ne vit plus vers le ciel, ignora le ciel. Et l’homme ne pouvait plus s’arrêter de creuser dans le marbre, la roche, dans les montagnes, dans les brisants, dans les flots ; la roue de la création ne s’arrêtait plus, elle était bien partie et se mariait à tout terrain : vétuste, cahoteux, abrupt, accidenté, bucolique, haut ; le plat monde était créé, le plat monde fut créé.
Et Baudelaire de poursuivre en riant de son «ridicule – contingent- d’un prophète», prédisant lourdement la fin du monde ou la désensibilisation du monde, vit l’homme radieux dans son désir courtois (moderne), soûl de sa gloire mécanique, de son perchoir neuf, prudent de ne s’apercevoir des iniquités établies, lui fit dire et moquer de dire niaisement la drôle de question, s’interrogeant froidement : «Que m’importe où vont ces consciences ?». Ces consciences mourront, présumait Baudelaire, question railleuse mettant en berne les consciences du monde : chacune portait la vertu qui donnait au genre humain son humanité pour le moins humaine sans évoquer celle héroïque ou supérieure qui était toujours de mesure mythique, ou si est, ce fut juste par mesure de…ou fortuit.
L’irréparable
«Peut-on illuminer un ciel bourbeux et noir ?», L’irréparable, les fleurs du mal
L’irréparable et l’avenir évanouissant car le futur est déjà atteint. C’est un ciel qui se refermera sur nous, c’est une pâleur qui caresse de près les belles couleurs de l’arbre inoculé du venin moderne, l’arbre est en train de mourir avec ses fruits, quand le poison aura touché le cœur, le grain est définitivement infecté. Un monde plat comme ce cœur plat qui ne bat plus, un monde où l’espoir ne tient plus même en l’illusion. Baudelaire ne se trompait pas, il ne voyait pas le capricieux de son siècle, son regard qui avait dépassé son monde pour se noyer dans l’opacité du ciel, ne s’agitait plus dans les expressions libres et libertaires. La verticalité poétique s’était opacifiée, le rival n’était plus la panne de l’inspiration, mais l’atteinte à l’hospitalité envers le poète, envers son verbe. Cette nouvelle indigence de la réceptivité, ce refus inconscient de voir l’ombre chevrotant de la Lumière (La lumière du cœur), cette nouvelle aporie de l’en deçà et l’au-delà, le vu et le non-vu, le dit et le tout-dit, ces accrocs assénés partout à la chair du poète ont hoqueté l’assertion de ses vers, un hoquet important dit en interrogation :
Peut-on illuminer un ciel bourbeux et noir ?
Peut-on déchirer des ténèbres
Plus denses que la poix, sans matin et sans soir,
Sans astres, sans éclairs funèbres ?
Peut-on illuminer un ciel bourbeux et noir ?
L’irréparable, les fleurs du mal
L’attitude de Baudelaire n’est pas expectative, nous l’imaginons bien dans sa posture d’enserrement (mettre en serre), il ne lève pas les yeux, le voile est compact et lourd, il le transperce par anticipation et s’éteint à la cueillette des papiers d’où fusent des volées bien considérées de ce qui adviendra. Il opprime juste l’envie d’amender le fait en effilant son propos par le «peut-on», le pourrait-il ou l’aurait-il pu ? Le monde avait changé de garants, avait fait le serment composé de ses propres matérialités de n’en référer qu’à lui, lui uniquement : l’individualisme moderne au prix de l’individuation interne, c’est ainsi qu’en amenda une chose à une autre en renversant les modalités, c’est ainsi que Baudelaire soupçonnait les choses dans ce nouvel esprit aveugle porteur de l’erreur et du mal. Le moment de la standardisation s’esquissait, l’homme en série prenait forme dans la disparition progressive presque subite de l’homme qui se burinait en revenant discrètement (Ne pas prendre le souci de soi pour un geste égoïste) sur soi, l’homme heureux des temps simples qui se nourrissait aux grands récits, qui portait l’azur dans ses veines, qui stimulait la lumière hors de sa raison, qui sursautait à la seule vue d’une volée d’oiseaux… (Je me suis projetée dans l’esprit de notre temps, je ne pouvais pas subodorer ce glissement, mais la nôtre de réalité porte dans ses racines les temps de Baudelaire).
Ô nuit des nuits étendues de Baudelaire, que lui-a-t-il fallu de désolation pour exprimer le noir en double emploi : le sujet et l’objet ? Le noir qui fait le noir et du noir, il se nourrit. Du peu de lumière sous-jacente dans ses lettres n’en pouvait se réfléchir aucune émission visible, lequel noir n’a point d’autre ressort que les ténèbres : Peut-on déchirer des ténèbres
Plus denses que la poix, sans matin et sans soir …?
Toute la strophe est une interrogation ameutée et déchaînée par la mutation du «ciel bourbeux et noir» en «ténèbres», Baudelaire crie, Baudelaire braille en interrogation correcte ou fausse, il déchire le silence totale et objectif envers la subjectivité créatrice, il triture l’abondance de ses vers à l’épreuve de la non-réponse, son interrogation s’exigeait fulminante contre l’allégeance nouvelle (La modernité) qui tannait uniformément le parchemin des nouveaux visages hébétés et effacés.
Avec toutes les espérances qui caressaient l’enthousiasme réel de l’homme, l’homme qui se réjouissait de sa nouvelle enfance, de sa renaissance ; il ne savait pas s’il devait courir ou ralentir, s’arrêter par station et goûter à ses exploits, sa tête rupinait, il ne s’arrêta pas, il ne s’arrêtait pas, sa conscience s’amenuisait, sa mémoire commençait à abstraire les régences, les révolutions, les lumières et les idées plurielles. Ce passé importun et muet n’importune que la plume des poètes (penseurs et auteurs aussi, n’en déplaise), Baudelaire le sait, ne se laisse pas rebuter par la vitesse des faits, quoi que les anciens fissent, leur projet était louable en théorie et en lecture, toute la délicatesse de Baudelaire était de porter par ses interrogations en coupable les nouveaux et les suivants, parce que ses interrogations sont dans l’atemporalité du présent éternel : «peut-on». Toute génération se trouvera poser les mêmes questions, devra formuler le même questionnement.
Quand les anciens avaient pris la tutelle du monde en prêchant (La nouvelle religion) la supériorité de la Raison, les grandes vertus se déplacèrent, zigzaguèrent, l’homme était au centre et se donnait la peine de parachever (L’utilisation de ce mot se lie avec parfaire dans la même ligne) la création, il se croyait fin et ingénieux pour penser parfaire le monde. Toutefois sa création fut faillible, il s’était égaré par sa seule Raison dans le brouillard étanche du «ciel bourbeux et noir» que dépeignait Baudelaire. Dans cette confusion, une boussole, une seule, la grande absente du projet humaniste : la conscience (sa voix incessible) aurait pu apaiser son délire rationnel. C’était le piège de la Raison où l’homme s’est empressé d’y tomber de tout son être.
Le «peut-on illuminer un ciel bourbeux et noir ?» n’avertit pas du danger mais sonne le glas des temps simples, du vivre-ensemble, du zéphyr (Dans l’allure légère du vent, l’esprit véloce) de l’esprit, de toute esthétique appelant à la réceptivité, à l’acuité des sens, à la connaissance et la reconnaissance du/ au monde.
Le goût de l’infini
Peut-on renverser la vapeur ? A mon tour, je pose la question à la longueur de Baudelaire. Peut-on trouver une sorte de reviviscence, de réveil dans ce bruit continu de la machine, dans ses roues aux moyeux solides qui tournent dans l’excès de la déroute humaine ? Un questionnement qui s’achemine long et à tonalité morose. Mais Baudelaire revient avec son regard de batracien (Dans le sens d’émergence et d’immersion) pour palper les infinités du visible, il va plus en dessous de la réalité qu’il appelle «lourdes ténèbres de l’existence commune et journalière» (Le goût de l’infini, Les fleurs du mal). Il la [la réalité] dissout par cette fragilité ou cette sensibilité qu’il définit de «condition anormale» qui n’est autre que le spirituel, qui n’est autre qu’«une véritable grâce» poursuit-il. Baudelaire veut se défaire de sa peau sociale, cette « peau de chagrin» qui lui ouvre les yeux qu’extérieurement, il se met en phase de son intériorité, il entre au pays inconnu, au pays de l’enfance, à l’«Heimat», à la spontanéité première, au premier stade de la vie pas encore corrompu. Il explore, observe et découvre la fugitive spiritualité qui se manifeste courtement d’elle-même dans des moments de relâchement (sommeil ou autre) : « l’homme gratifié de cette béatitude, malheureusement rare et passagère, se sent à la fois plus artiste et plus juste, plus noble, pour tout dire en un mot» (Le goût de l’infini, ibid). Cette voie si fragile qui s’ouvre par moment est-elle accessible ? Baudelaire s’interroge sur la source de cette manifestation heureuse, cette brèche qui s’ouvre et se referme inconditionnellement, «cet état exceptionnel de l’esprit et des sens» : «est-il le résultat d’une bonne hygiène et d’un régime de sage ?» il ne peut l’être, répond-il, car cela ne peut être qu’«extérieur à l’homme», autrement dit le chemin vers la spiritualité s’annoncerait commode et pratique. Il poursuit : «dirons-nous qu’elle est la récompense de la prière assidue et des ardeurs spirituelles ?», la prière assidue ou l’exercice continu pour rattraper cette infinité, pour piéger le réel en nous unissant avec notre intériorité. Les ardeurs spirituelles ou la tension incorporelle qui déchire le voile et s’élève, se libère des autres tensions parasitaires (du quotidien) pour l’équilibre parfait de nos forces intérieures, qui seront en mesure de déployer notre imagination dans ses poussées les plus prospectées. Honneur au poète, à Baudelaire qui, dans son attitude expérientielle nous exhorte à de pareille quête, non pour corriger le réel, mais pour l’accepter en le percevant vivable et soutenable, dans la mesure où nous serons en paix avec nous-mêmes. Allons encore plus loin et posons-nous la question, Baudelaire dans son spleen qui jalonne presque toutes ses œuvres, s’il n’est pas apparent, il est souvent en filigrane, est-il parvenu à pallier ce réel qui l’étouffait, qui l’épuisait ? Dans son texte «Le goût de l’infini» faisant partie « des paradis artificiels», ou ce qu’il appelle dans le même texte «le faux idéal», il explicite cette aptitude spirituelle par, je cite : «les drogues […] celles dont l’emploi est le plus commode et le plus sous la main, sont le haschisch et l’opium». Il poursuit en soulignant l’effet néfaste d’un usage prolongé, il ne fait certes pas l’apologie de ces drogues, mais en fait la sage utilisation à laquelle il lui attribue deux termes instruits : « médicale et poétique ». Ceci dit, nous ne pouvons pas nous fourvoyer en croyant que le prodige que fut Baudelaire est le résultat d’une accoutumance à ces drogues, le mystère baudelairien ne s’explique pas si facilement.
D’un autre côté et depuis le début, en allant piocher dans les différents textes de Baudelaire, différences d’œuvres (trois œuvres : Baudelaire l’intime dans «Les fusées», «Les fleurs du mal» et enfin «Les paradis artificiels»), et en définissant l’interrogation insurrectionnelle, je pense que cette insurrection est poétique, c’est Baudelaire qui s’insurge, qui quitte la marge alors étant maudit, c’est sa parole presque céleste née de la haute sensibilité.
Il nous donne l’impression qu’il a vécu plusieurs vies, a été traversé par des corps et des noms de choses et de personnes, de paysages vus et surtout imaginés, des pays ou de son pays le «Cocagne»... Il ne taisait pas le réel à l’ombre de son imagination, il l’observait et s’interrogeait en nous interrogeant nous-même, et nous savons que tout esprit qui s’interroge est imprégné de pensée vive et saine pour ne pas dire sereine. Baudelaire était un être impliqué dans une imagination puissante mais lucide et prévoyante, il ne se méprenait pas, il voyait le monde comme il se fallait prêt à mourir pour le progrès, de sa brèche fine et haute, il était l’oracle de son siècle et du nôtre.
* Auteure du recueil de poèmes «Sans maître», éditions Hugues Facorat
Je me tais ou porte sa parole que je ne cherche pas à consacrer, elle lui revient bien de haut. Je ne me mets pas de son côté, ni en face, je n’implore pas l’émulation, je m’entretiens en biais et je surveille mes détours. Au temps de Baudelaire, la modernité était encore sous la crédulité de la peur, une agression à venir, un malaise pressenti, une vanité pour les uns et une déchéance pour ces autres à même de percevoir par leur unique sensibilité les éclats tristes que produisaient les belles exordes du progrès. Comment ne pas s’ahurir du volume du questionnement qu’est cette interrogation : « Qu’est-ce que le monde a désormais à faire sous le ciel ? » ? Il augurait ou il sollicitait les bons entendeurs ou s’agissait-il d’une interrogation sentencieuse ? Il aurait supposé un monde sans ciel ou un ciel sans monde, nulle flatterie, un naufrage ne s’attaque pas sans le vent du ciel ni l’eau houleuse du monde, et ne se tait sans le silence du ciel, ni l’embellie de l’eau du monde.Avait-il ouï le futur éternel sanglot de l’humanité ? Manifestement oui, la cité avait perdu son poète, le maudissait pour le silence de ses peines et lui, il poursuivait à composer sur la marge, même si courbé et sur le bord, sa parole distillait les obéissances de la course élancée. Il eut fallu beaucoup pour qu’il eût raison, et il eut raison. Ce mal prédit, non dans l’assertion, pervertit tous les aspects du monde, alors que ses conquérants recevaient nonchalamment et en toute jouissance les retournements heureux, la chute n’était pas préalable dans leurs esprits épris de tant de grandeur, et leurs regards obscurcis de tant d’éclats, ils n’avaient pas saisi toute la splendeur de la conjecture inférée abondamment, sous l’égide de la parole débattue et atrophiée du poète maudit. Qui de nos aïeux, qui de nous pourraient démentir cette volée éclairée ? Nous ne le pourrons pas, nous demanderons le repentir pour nos devanciers et pour nous et puis c’est trop tard, l’humanité en nous ne se conjure plus dans ces degrés, les strates de la repentance se sont agglutinées, ruminer ses erreurs ou juste les penser pour en sentir la culpabilité sommeille lourdement dans le repos de l’oubli ; l’humanité ne peut se reprocher ses torts ni se pardonner. Quand le feu du progrès avait terni les étendards de la sensibilité, l’homme ne se soucia plus de lui-même : il cessa de jouir dans le vif de l’émotion, de la mimique, de l’expression de l’autre ; du rire ébréché et édenté de ses vieillards ; du regard dans le regard ; du soupir échangé et partagé, du café ou thé fumant sous les paroles postillonnant de deux interlocuteurs libres de mains, se grattant le nez et se tapant des paumes. Le vivre-ensemble fut dissemblé, la cohorte sortant des usines ne se dénombrait pas, le calcul était vertigineux dans toute la cacophonie des bavardages confondus au rythme de pas. La cohorte fut automatisée, elle ne sort plus, les membres mécaniques se rangent aux extinctions des feux par les quelques délicates mains humaines encore essentielles. Bien vite, l’agitation moderne empoigna les fondements de la famille, les rôles dégradèrent les valeurs, la moralité s’attrista ne supportant que les fioritures, la communication palpita et mourut devant l’écran ou sur les claviers, les tutelles se convertirent et les garde-fous changèrent de décor ou disparurent. Puis et intimement, la vraie faillite, la vraie tourmente fut de pervertir la magie, l’unique magie : l’enfant, à qui et expressément, on déconstruisit son imaginaire, on en déconstruisit toute la construction en le triturant dans un espace exigu où le jeu, première charpente vers la belle connaissance, se tint en une console le consolant de son peu de monde, son monde désormais dépeuplé d’échange et d’imagination. Toute l’injustice se resserre en cet acte, alors encore Baudelaire avait posé la toute bonne question : Qu’est-ce que le monde a désormais à faire sous le ciel ?
Ce monde désensibilisé par la fièvre électronique : voix, image, imagerie, affection, amour, étreintes, embrassades ; fantasmes… perdit l’émotion du regard amoureux échangé au profit d’un profil électronique. Encore ténu dans cette posture de pinacle, l’homme délègue son souffle à la machine, et ne sachant plus quoi faire du temps gagné, il ignorait presque ce qu’il faisait sous le ciel, il ne voyait plus les ombrages des vallées qui s’estompaient, ni la disparition des abords bossués qui avalisaient les divergences : la conscience surdouée du monde. Il s’accommodait aux formes de l’esprit commun qui a pleinement englouti son regard, alors jusqu’ici télescopique. Le regard pencha, ne vit plus vers le ciel, ignora le ciel. Et l’homme ne pouvait plus s’arrêter de creuser dans le marbre, la roche, dans les montagnes, dans les brisants, dans les flots ; la roue de la création ne s’arrêtait plus, elle était bien partie et se mariait à tout terrain : vétuste, cahoteux, abrupt, accidenté, bucolique, haut ; le plat monde était créé, le plat monde fut créé.
Et Baudelaire de poursuivre en riant de son «ridicule – contingent- d’un prophète», prédisant lourdement la fin du monde ou la désensibilisation du monde, vit l’homme radieux dans son désir courtois (moderne), soûl de sa gloire mécanique, de son perchoir neuf, prudent de ne s’apercevoir des iniquités établies, lui fit dire et moquer de dire niaisement la drôle de question, s’interrogeant froidement : «Que m’importe où vont ces consciences ?». Ces consciences mourront, présumait Baudelaire, question railleuse mettant en berne les consciences du monde : chacune portait la vertu qui donnait au genre humain son humanité pour le moins humaine sans évoquer celle héroïque ou supérieure qui était toujours de mesure mythique, ou si est, ce fut juste par mesure de…ou fortuit.
L’irréparable
«Peut-on illuminer un ciel bourbeux et noir ?», L’irréparable, les fleurs du mal
L’irréparable et l’avenir évanouissant car le futur est déjà atteint. C’est un ciel qui se refermera sur nous, c’est une pâleur qui caresse de près les belles couleurs de l’arbre inoculé du venin moderne, l’arbre est en train de mourir avec ses fruits, quand le poison aura touché le cœur, le grain est définitivement infecté. Un monde plat comme ce cœur plat qui ne bat plus, un monde où l’espoir ne tient plus même en l’illusion. Baudelaire ne se trompait pas, il ne voyait pas le capricieux de son siècle, son regard qui avait dépassé son monde pour se noyer dans l’opacité du ciel, ne s’agitait plus dans les expressions libres et libertaires. La verticalité poétique s’était opacifiée, le rival n’était plus la panne de l’inspiration, mais l’atteinte à l’hospitalité envers le poète, envers son verbe. Cette nouvelle indigence de la réceptivité, ce refus inconscient de voir l’ombre chevrotant de la Lumière (La lumière du cœur), cette nouvelle aporie de l’en deçà et l’au-delà, le vu et le non-vu, le dit et le tout-dit, ces accrocs assénés partout à la chair du poète ont hoqueté l’assertion de ses vers, un hoquet important dit en interrogation :
Peut-on illuminer un ciel bourbeux et noir ?
Peut-on déchirer des ténèbres
Plus denses que la poix, sans matin et sans soir,
Sans astres, sans éclairs funèbres ?
Peut-on illuminer un ciel bourbeux et noir ?
L’irréparable, les fleurs du mal
L’attitude de Baudelaire n’est pas expectative, nous l’imaginons bien dans sa posture d’enserrement (mettre en serre), il ne lève pas les yeux, le voile est compact et lourd, il le transperce par anticipation et s’éteint à la cueillette des papiers d’où fusent des volées bien considérées de ce qui adviendra. Il opprime juste l’envie d’amender le fait en effilant son propos par le «peut-on», le pourrait-il ou l’aurait-il pu ? Le monde avait changé de garants, avait fait le serment composé de ses propres matérialités de n’en référer qu’à lui, lui uniquement : l’individualisme moderne au prix de l’individuation interne, c’est ainsi qu’en amenda une chose à une autre en renversant les modalités, c’est ainsi que Baudelaire soupçonnait les choses dans ce nouvel esprit aveugle porteur de l’erreur et du mal. Le moment de la standardisation s’esquissait, l’homme en série prenait forme dans la disparition progressive presque subite de l’homme qui se burinait en revenant discrètement (Ne pas prendre le souci de soi pour un geste égoïste) sur soi, l’homme heureux des temps simples qui se nourrissait aux grands récits, qui portait l’azur dans ses veines, qui stimulait la lumière hors de sa raison, qui sursautait à la seule vue d’une volée d’oiseaux… (Je me suis projetée dans l’esprit de notre temps, je ne pouvais pas subodorer ce glissement, mais la nôtre de réalité porte dans ses racines les temps de Baudelaire).
Ô nuit des nuits étendues de Baudelaire, que lui-a-t-il fallu de désolation pour exprimer le noir en double emploi : le sujet et l’objet ? Le noir qui fait le noir et du noir, il se nourrit. Du peu de lumière sous-jacente dans ses lettres n’en pouvait se réfléchir aucune émission visible, lequel noir n’a point d’autre ressort que les ténèbres : Peut-on déchirer des ténèbres
Plus denses que la poix, sans matin et sans soir …?
Toute la strophe est une interrogation ameutée et déchaînée par la mutation du «ciel bourbeux et noir» en «ténèbres», Baudelaire crie, Baudelaire braille en interrogation correcte ou fausse, il déchire le silence totale et objectif envers la subjectivité créatrice, il triture l’abondance de ses vers à l’épreuve de la non-réponse, son interrogation s’exigeait fulminante contre l’allégeance nouvelle (La modernité) qui tannait uniformément le parchemin des nouveaux visages hébétés et effacés.
Avec toutes les espérances qui caressaient l’enthousiasme réel de l’homme, l’homme qui se réjouissait de sa nouvelle enfance, de sa renaissance ; il ne savait pas s’il devait courir ou ralentir, s’arrêter par station et goûter à ses exploits, sa tête rupinait, il ne s’arrêta pas, il ne s’arrêtait pas, sa conscience s’amenuisait, sa mémoire commençait à abstraire les régences, les révolutions, les lumières et les idées plurielles. Ce passé importun et muet n’importune que la plume des poètes (penseurs et auteurs aussi, n’en déplaise), Baudelaire le sait, ne se laisse pas rebuter par la vitesse des faits, quoi que les anciens fissent, leur projet était louable en théorie et en lecture, toute la délicatesse de Baudelaire était de porter par ses interrogations en coupable les nouveaux et les suivants, parce que ses interrogations sont dans l’atemporalité du présent éternel : «peut-on». Toute génération se trouvera poser les mêmes questions, devra formuler le même questionnement.
Quand les anciens avaient pris la tutelle du monde en prêchant (La nouvelle religion) la supériorité de la Raison, les grandes vertus se déplacèrent, zigzaguèrent, l’homme était au centre et se donnait la peine de parachever (L’utilisation de ce mot se lie avec parfaire dans la même ligne) la création, il se croyait fin et ingénieux pour penser parfaire le monde. Toutefois sa création fut faillible, il s’était égaré par sa seule Raison dans le brouillard étanche du «ciel bourbeux et noir» que dépeignait Baudelaire. Dans cette confusion, une boussole, une seule, la grande absente du projet humaniste : la conscience (sa voix incessible) aurait pu apaiser son délire rationnel. C’était le piège de la Raison où l’homme s’est empressé d’y tomber de tout son être.
Le «peut-on illuminer un ciel bourbeux et noir ?» n’avertit pas du danger mais sonne le glas des temps simples, du vivre-ensemble, du zéphyr (Dans l’allure légère du vent, l’esprit véloce) de l’esprit, de toute esthétique appelant à la réceptivité, à l’acuité des sens, à la connaissance et la reconnaissance du/ au monde.
Le goût de l’infini
Peut-on renverser la vapeur ? A mon tour, je pose la question à la longueur de Baudelaire. Peut-on trouver une sorte de reviviscence, de réveil dans ce bruit continu de la machine, dans ses roues aux moyeux solides qui tournent dans l’excès de la déroute humaine ? Un questionnement qui s’achemine long et à tonalité morose. Mais Baudelaire revient avec son regard de batracien (Dans le sens d’émergence et d’immersion) pour palper les infinités du visible, il va plus en dessous de la réalité qu’il appelle «lourdes ténèbres de l’existence commune et journalière» (Le goût de l’infini, Les fleurs du mal). Il la [la réalité] dissout par cette fragilité ou cette sensibilité qu’il définit de «condition anormale» qui n’est autre que le spirituel, qui n’est autre qu’«une véritable grâce» poursuit-il. Baudelaire veut se défaire de sa peau sociale, cette « peau de chagrin» qui lui ouvre les yeux qu’extérieurement, il se met en phase de son intériorité, il entre au pays inconnu, au pays de l’enfance, à l’«Heimat», à la spontanéité première, au premier stade de la vie pas encore corrompu. Il explore, observe et découvre la fugitive spiritualité qui se manifeste courtement d’elle-même dans des moments de relâchement (sommeil ou autre) : « l’homme gratifié de cette béatitude, malheureusement rare et passagère, se sent à la fois plus artiste et plus juste, plus noble, pour tout dire en un mot» (Le goût de l’infini, ibid). Cette voie si fragile qui s’ouvre par moment est-elle accessible ? Baudelaire s’interroge sur la source de cette manifestation heureuse, cette brèche qui s’ouvre et se referme inconditionnellement, «cet état exceptionnel de l’esprit et des sens» : «est-il le résultat d’une bonne hygiène et d’un régime de sage ?» il ne peut l’être, répond-il, car cela ne peut être qu’«extérieur à l’homme», autrement dit le chemin vers la spiritualité s’annoncerait commode et pratique. Il poursuit : «dirons-nous qu’elle est la récompense de la prière assidue et des ardeurs spirituelles ?», la prière assidue ou l’exercice continu pour rattraper cette infinité, pour piéger le réel en nous unissant avec notre intériorité. Les ardeurs spirituelles ou la tension incorporelle qui déchire le voile et s’élève, se libère des autres tensions parasitaires (du quotidien) pour l’équilibre parfait de nos forces intérieures, qui seront en mesure de déployer notre imagination dans ses poussées les plus prospectées. Honneur au poète, à Baudelaire qui, dans son attitude expérientielle nous exhorte à de pareille quête, non pour corriger le réel, mais pour l’accepter en le percevant vivable et soutenable, dans la mesure où nous serons en paix avec nous-mêmes. Allons encore plus loin et posons-nous la question, Baudelaire dans son spleen qui jalonne presque toutes ses œuvres, s’il n’est pas apparent, il est souvent en filigrane, est-il parvenu à pallier ce réel qui l’étouffait, qui l’épuisait ? Dans son texte «Le goût de l’infini» faisant partie « des paradis artificiels», ou ce qu’il appelle dans le même texte «le faux idéal», il explicite cette aptitude spirituelle par, je cite : «les drogues […] celles dont l’emploi est le plus commode et le plus sous la main, sont le haschisch et l’opium». Il poursuit en soulignant l’effet néfaste d’un usage prolongé, il ne fait certes pas l’apologie de ces drogues, mais en fait la sage utilisation à laquelle il lui attribue deux termes instruits : « médicale et poétique ». Ceci dit, nous ne pouvons pas nous fourvoyer en croyant que le prodige que fut Baudelaire est le résultat d’une accoutumance à ces drogues, le mystère baudelairien ne s’explique pas si facilement.
D’un autre côté et depuis le début, en allant piocher dans les différents textes de Baudelaire, différences d’œuvres (trois œuvres : Baudelaire l’intime dans «Les fusées», «Les fleurs du mal» et enfin «Les paradis artificiels»), et en définissant l’interrogation insurrectionnelle, je pense que cette insurrection est poétique, c’est Baudelaire qui s’insurge, qui quitte la marge alors étant maudit, c’est sa parole presque céleste née de la haute sensibilité.
Il nous donne l’impression qu’il a vécu plusieurs vies, a été traversé par des corps et des noms de choses et de personnes, de paysages vus et surtout imaginés, des pays ou de son pays le «Cocagne»... Il ne taisait pas le réel à l’ombre de son imagination, il l’observait et s’interrogeait en nous interrogeant nous-même, et nous savons que tout esprit qui s’interroge est imprégné de pensée vive et saine pour ne pas dire sereine. Baudelaire était un être impliqué dans une imagination puissante mais lucide et prévoyante, il ne se méprenait pas, il voyait le monde comme il se fallait prêt à mourir pour le progrès, de sa brèche fine et haute, il était l’oracle de son siècle et du nôtre.
* Auteure du recueil de poèmes «Sans maître», éditions Hugues Facorat
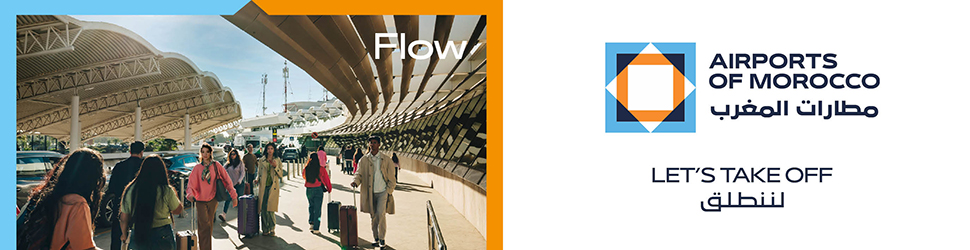



















 Pourquoi Bank Al-Maghrib tarde-t-elle à baisser son taux directeur ?
Pourquoi Bank Al-Maghrib tarde-t-elle à baisser son taux directeur ?