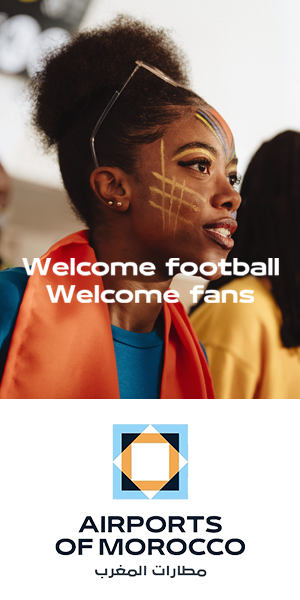Il y a des passages où l’on se croit dans une prose poétique, d’autres où des questions philosophiques sont traitées avec subtilité, d’autres encore où la narration poursuit son cours comme cet écoulement continu de l’eau dans un fleuve. Dans ce roman, les ponts entre les gens sont savamment coupés. On migre d’un genre à l’autre sans s’en rendre compte. Le voyage ne demande que le penchant à être transporté et la moindre fausse sensibilité risquerait de gâcher le plaisir.
« Rafif Alfossoul » ne s’est pas contenté d’intégrer presque tous les genres de l’écriture, il les dépasse pour interpeller d’autres aspects de l’art. La musique est présente par le rythme, mais aussi par les extraits de certaines chansons d’Edith Piaf. Et comme dans le cinéma iranien, le personnage principal se découvre au fil des pages. On ne le connaît pas au début, son comportement se montre incompréhensible voire absurde. Cependant, plus le texte progresse, plus se justifie toute conduite et s’éclaire petit à petit l’entreprise pour laquelle il a choisi de retourner au Maroc.
Après des années de longue absence sur les terres françaises, Almoïz Ben Nouali quitte son lieu de résidence pour retrouver les traces de son enfance. Il avait un vague projet de retour et se trouve pousser par une force indéfinissable. Il dit dans un passage : « Je suis venu comme ça, sans envie préalable. Je ne sais pas comment je suis venu ni pourquoi je l’ai fait, pourtant je suis venu ». Et d’ajouter dans un autre: « Je sens que le présent est une attaque torrentielle destructrice ».
Ce volcan qui jaillit en son intérieur et le pousse à traverser les mers dépasse cet état de tristesse causé par le désir persistant de revivre un souvenir pour épouser d’autres dimensions quand il découvre la nouvelle Oujda, une ville qui a changé de visage et dont les habitants se sont scindés en deux groupes : ceux qui ont choisi de prendre le train de l’arrivisme, ne regardant que devant eux pour ne pas voir les leurs sombrer dans la misère et ceux qui sont restés sur place, acceptant de voir la mort s’approcher en rampant, sans pourvoir échapper à leur destin. Le narrateur, après s’être assuré qu’El Ghalia, son ancien amour, a été charriée par le mascaret du carriérisme et que son nouveau mari (parce qu’il était son ex) lui balise le chemin pour arriver au sommet, entreprend d’organiser une marche de protestation, non pour se venger d’un amour fané mais plutôt rendre la dignité aux habitants de sa ville qui s’ensevelissent dans le déshonneur.
Il demande aux contestataires de se raser le crâne et de marcher pieds nus, mais il est surpris le jour venu de ne trouver qu’une poignée de personnes, des connaissances qui se sont déplacées par complaisance. Ceux pour qui la dissidence est menée, « au lieu de participer, sont restés au bord de la route à contempler étrangement le spectacle en poussant parfois des éclats de rire et d’autres fois en criant sans raison comme s’ils étaient dans un festival ». Désespéré, Almoïz prend le chemin du retour vers son pays d’accueil quand un attentat dont le kamikaze est un proche le fait revenir sur sa décision.
« Les palpitations des saisons » n’est pas une petite affaire privée comme le croyaient certains pseudo-critiques, c’est un roman à portée universelle. C’est la critique de toute une génération d’intellectuels qui, tout s’enfermant dans leur tour d’ivoire, ont laissé le terrain vide pour les opportunistes. Leur isolement a secrété leur propre mort et quand ceux qui ont survécu, se sont rendu compte de leur erreur, ils se précipitent pour commettre des bêtises comme des fous « qui défilent dans la rue le crâne rasé et les pieds nus».
Mohammed Almaâzouz, docteur en anthropologie et esthétique, l dramaturge et essayiste a montré qu’il est capable d’aborder avec brio l’écriture romanesque. Il nous a donné l’occasion de rejuger l’histoire, de crier non, ne serait-ce que le temps de lecture, à la marginalisation, l’exclusion, la misère et à l’absence de démocratie.
Cet écrivain a bien compris, comme l’a dit Gilles Deleuze, que « Ecrire, c’est se lancer dans une affaire universelle ».













 Tanger célèbre la diversité culturelle africaine
Tanger célèbre la diversité culturelle africaine