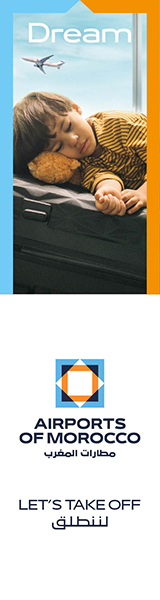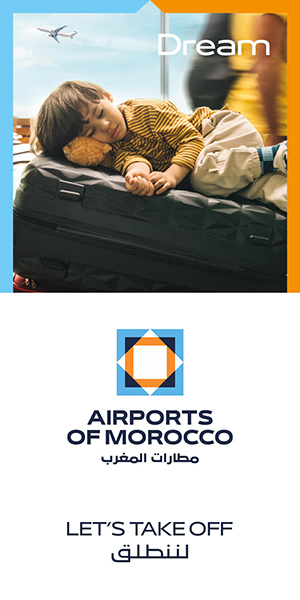-
Situation au Moyen Orient : Mise en place d’une cellule de crise et des numéros de téléphone au profit des Marocains résidant dans les pays concernés
-
Réforme à l’insu des premiers concernés
-
Confirmation d’un partenariat dynamique et privilégié entre Rabat et Helsinki
-
Sahara marocain : la Finlande appuie l’autonomie sous souveraineté marocaine comme solution des plus réalisables
Chaque crise, prise isolément, pouvait encore relever de l’aléa. Leur accumulation, en revanche, dessine une méthode. Ou plutôt une absence de méthode. Inflation persistante, tensions sociales récurrentes, dysfonctionnements dans des secteurs vitaux comme la santé, l’éducation ou l’emploi, autant de signaux faibles devenus forts, auxquels le gouvernement a répondu tardivement, souvent de manière partielle, parfois par une communication déconnectée de la réalité vécue par les citoyens. L’impression dominante n’a jamais été celle d’un Etat stratège aux commandes, mais celle d’un exécutif constamment rattrapé par le réel.
La gestion de la crise du pouvoir d’achat illustre à elle seule cette dérive. Face à la hausse continue des prix et à l’érosion des revenus, la réaction gouvernementale s’est révélée lente, fragmentée et largement défensive. Les mesures annoncées, souvent techniques, ont peiné à produire des effets tangibles sur la vie quotidienne des ménages. Pire encore, le décalage entre le discours officiel, volontiers rassurant, et le ressenti populaire a nourri un malaise social profond. Là où l’on attendait une stratégie globale, articulant régulation des marchés, protection ciblée des plus vulnérables et soutien aux classes moyennes, l’exécutif s’est contenté d’ajustements successifs, donnant le sentiment de colmater plutôt que de construire.
Ce schéma s’est répété dans le champ social, où la conflictualité n’a cessé de monter, faute de dialogue structuré et sincère. Les crises sectorielles, notamment dans les services publics, ont été abordées comme des urgences isolées, jamais comme les symptômes d’un malaise plus large. Le dialogue social, pourtant présenté comme une priorité, s’est souvent réduit à des échanges tardifs, déclenchés sous la contrainte de la rue ou de la pression syndicale. Cette gouvernance par le retard a laissé des cicatrices durables, érodant la crédibilité de la parole publique et renforçant l’idée que les décisions ne sont prises qu’une fois le rapport de force devenu défavorable.
La communication gouvernementale, loin d’atténuer ces tensions, a parfois contribué à les exacerber. Annonces prématurées, messages contradictoires, éléments de langage technocratiques mal reçus, tout concourt à renforcer le sentiment d’un pouvoir déconnecté des réalités sociales. Là où la crise appelle clarté, pédagogie et humilité, la communication a souvent oscillé entre autosatisfaction et minimisation, alimentant un fossé déjà profond entre gouvernants et gouvernés. La parole publique, à force d’être démentie par les faits, a perdu de sa force et de sa crédibilité.
Ce manque d’anticipation apparaît également dans la gestion des réformes structurelles. L’année a été jalonnée de chantiers lancés sans préparation suffisante, de réformes annoncées sans accompagnement réel, et de dispositifs mal compris faute d’explication claire. Dans des secteurs aussi sensibles que la santé ou l’éducation, l’absence d’anticipation des résistances, des contraintes humaines et des réalités territoriales a transformé des projets nécessaires en sources d’inquiétude et de confusion. La crise n’est alors plus seulement conjoncturelle, elle devient institutionnelle.
Derrière ces dysfonctionnements se dessine une culture politique préoccupante, celle d’un exécutif qui privilégie la gestion immédiate au détriment de la vision, l’annonce au détriment de la préparation, la communication au détriment de la concertation. Cette culture de l’improvisation n’est pas neutre. Elle affaiblit l’Etat, fragilise les politiques publiques et expose les citoyens aux contrecoups d’un pilotage incertain. Elle traduit aussi une conception appauvrie de l’action gouvernementale, réduite à une succession de réactions plutôt qu’à l’élaboration d’un projet collectif.
Pour une force politique comme l’USFP, attachée à l’idée d’un Etat stratège, social et démocratique, ce constat ne peut être banalisé. Gouverner, ce n’est pas attendre que la crise éclate pour y répondre dans l’urgence. Gouverner, c’est anticiper, planifier, écouter et assumer des choix clairs, même lorsqu’ils sont difficiles. L’année écoulée aura montré que cette exigence a fait défaut, transformant des défis gérables en crises durables.
En définitive, ce que révèle cette succession de ratés, ce n’est pas seulement une série d’erreurs techniques, mais une faillite méthodologique. L’exécutif n’a pas manqué d’occasions, il a manqué de cap. Et dans un pays engagé dans de profondes transformations économiques et sociales, cette absence de boussole constitue en soi un risque majeur.
L’histoire politique retiendra sans doute cette année comme celle où les crises ont parlé plus fort que le gouvernement, et où l’improvisation a pris le pas sur la responsabilité.