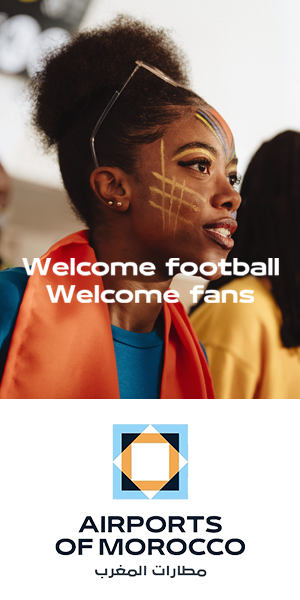-
Le Festival ComediaBlanca embrase l’Olympia : Gad El Maleh en invité de marque
-
A Paris, accord trouvé pour sauvegarder l'appartement du poète Prévert menacé par le Moulin Rouge
-
L’IMA à Paris s’associe à la fête footballistique de la CAN
-
Importance de la digitalisation dans la préservation du patrimoine culturel
Mais ceci est une autre question, qui sera soulevée, nous l’espérons, ultérieurement.
En tous cas, la manifestation de Casablanca remet les pendules, relativement, à l’heure, par la projection du court métrage “Notre amie l’école” réalisé en 1956, par Larbi Benchakroun, d’une durée de 11 minutes, en noir et blanc. Il raconte comment le petit Mahmoud, rebuté ou intimidé dès la rentrée par la classe, fait l’école buissonnière et est ramené, pour son plus grand bien, dans le droit chemin. Le film était produit par le CCM et le ministère de la Santé. Il rappelle un autre film, très réussi, tourné en 1951, également sous l’égide du CCM, par Roger Leenhardt, « La fugue de Mahmoud », dont le héros, un écolier s’appelait également Mahmoud.
Le devoir de mémoire
Le programme de la soirée comportait, en outre, la projection de deux autres films. Un second court métrage, “Pour une bouchée de pain”, d’une durée de 20 minutes, commandité par le ministère du Commerce et de l’Industrie et le ministère de l’Agriculture et réalisé par Larbi Bennani en 1959, qui raconte une journée d’un chômeur débrouillard. Le texte de Saddiki donne un ton humoristique savoureux au film qui, en passant, vante les qualités nutritives et gastronomiques de la sardine. Le troisième film, un moyen métrage “Brahim ou le collier de beignets” réalisé en 1957 par Jean Fléchet, était commandité par le tout nouveau ministère de l’Information pour représenter le Maroc au Festival de Berlin de 1957, ce qu’il fit, d’après la presse de l’époque, d’une façon honorable. Le film d’une durée de 45 minutes, décrit le parcours initiatique et la prise de conscience d’un jeune Marocain à l’aube de l’indépendance. Il rapporte, avec réalisme, mais empathie, l’ambiance des premiers jours de l’indépendance et décrit, à la fois, les difficultés de la période comme le chômage, la volonté de changement, et l’immense foi en l’avenir des Marocains. Climat bien rendu par le titre en arabe, “Bidaya wa amal”, c'est-à-dire « Commencement et espoir».
Les deux derniers films constituaient aussi un hommage au grand artiste récemment décédé, Tayeb Saddiki, qui avait activement participé, outre comme acteur, à leur élaboration. C’était également un moment de remémoration émouvant de quelques grandes icônes de la scène et du cinéma marocains, comme Hassan Skalli, Fatima Regragui et Hammadi Ammor.
Les caravanes
cinématographiques, moyen d’information et d’éducation
Ces trois films nous interpellent à plus d’un titre. D’abord, par leurs qualités intrinsèques et comme documents historiques, puis comme des échantillons représentatifs de la production post-coloniale au Maroc, et surtout par le rappel d’une période lumineuse et exceptionnelle de l’histoire de notre cinéma.
Ces films ont plus d’un point commun entre eux et avec les courts métrages qui seront produits durant les deux décennies qui vont suivre l’indépendance.
La première remarque que l’on peut faire sur cette foisonnante production de presque une centaine de films, fait unique en son genre dans un pays nouvellement indépendant, entre la fin de l’année 1956, date du premier film réalisé par un Marocain, en l’occurrence “Notre amie l’école” de Larbi Benchakroun et 1975, est son caractère éminemment didactique et éducatif. La plupart des films de l’époque sont traversés par le souci de véhiculer et d’inculquer les valeurs citoyennes. Sachant que l’analphabétisme touchait une grandes partie de la population, l’usage abondant, souvent exclusif de la voix off et du commentaire servait admirablement cet objectif, en transmettant les messages d’une façon claire et sans équivoque, dépassant toutes les ambiguïtés et les différences des dialectes régionaux et leurs variantes. Les gens de mon âge, surtout ceux qui habitaient les villages et les campagnes, se rappellent sans doute comment l’annonce de l’arrivée des caravanes cinématographiques se répandait, par les chaudes nuits d’été, comme une traînée de poudre, et constituait un événement festif qui drainait un immense public sur des kilomètres à la ronde. Les caravanes étaient alimentées essentiellement par ces productions et par des actualités du trimestre ou du semestre, tournées par les mêmes équipes. Ces manifestations en plein air qui avaient lieu régulièrement dans tout le Royaume répondaient à une grande soif d’information de la population. En l’absence de salle de cinéma et avant l’avènement de la télévision, une très large frange de cette population n’avait que ce moyen de contact visuel avec le reste du Maroc et les événements qui s’y déroulaient. C’est dire l’importance de ces films dans la transmission du sentiment d’appartenance à un pays, à une nation.
La volonté de mettre le cinéma au service des grandes causes du développement du pays est telle que d’aucuns pourraient, s’ils ne prennent pas la peine de replacer ces films dans leur contexte, les taxer de naïfs ou d’outils de propagande.
La trempe des pionniers
C’est qu’ils étaient le fait de la première génération de cinéastes frais émoulus des écoles de cinéma d’Europe et principalement de l’Institut des hautes études cinématographiques (IDHEC) en France, partis se former avec une haute idée de la mission du cinéma comme outil de conscientisation, d’émancipation et de libération et la conviction d’être investis de cette mission. Ces premières promotions allaient être reçues, à leur retour, à bras ouverts par une institution, le Centre cinématographique marocain, qui avait les mêmes objectifs et un besoin crucial de personnel pour remplacer, égaler, et pourquoi pas dépasser les Français qui avaient été très actifs et avaient fait du bon travail, autant dans les documentaires que dans les actualités. D’autant plus qu’une infrastructure adéquate, les studios de Souissi à Rabat et ceux de Aïn Chok à Casablanca étaient prêts à les recevoir. Ainsi, des jeunes de différentes spécialités s’attelèrent-ils à la tâche avec abnégation et enthousiasme.
Etant fonctionnaires, ils exécutèrent essentiellement des commandes, avec un professionnalisme remarquable. Ce fut pour une bonne vingtaine d’entre eux un apprentissage fructueux que d’être confrontés au travail ingrat et dans des conditions difficiles, par monts et par vaux, sur le terrain et avec les populations des zones les plus reculées et les plus pauvres du pays. Les films traitaient des sujets les plus divers, mais qui avaient un lien direct et étroit avec les enjeux et les préoccupations du moment comme l’éducation, la reconstruction, les aléas climatiques, l’exode rural et l’émigration, l’opposition ville-campagne, la santé, l’industrialisation, les transformations économiques et sociales, les arts modernes et traditionnels, l’urbanisation, la solidarité, les mythes et légendes, l’histoire, etc. Beaucoup d’entre ces jeunes comme Larbi Benchakroun, Aziz Ramdani, Mohamed Tazi ou Larbi Bennani réaliseront une dizaine de films ou plus.
L’engagement solidaire
et la création personnelle
Un des premiers constats que l’on peut faire à la lecture des génériques, et c’est la deuxième remarque, est le caractère collectif de ces productions. Les mêmes noms se retrouvent mais à chaque fois dans des postes différents, comme dans un orchestre dont les membres polyvalents joueraient de tous les instruments à tour de rôle, qui au montage ou à la production, qui à la réalisation ou à l’image…C’est dire qu’il régnait dans cette sympathique fourmilière un fort esprit d’équipe, de solidarité et d’émulation et que l’on y apprenait beaucoup les unes des autres.
La troisième remarque, c’est que malgré les contraintes que l’on peut aisément imaginer, ces cinéastes- fonctionnaires ont réalisé des films de bonne facture dénotant un savoir faire qui n’a cessé de s’affermir. Beaucoup d’entre eux ont fait preuve d’une part, d’un grand engagement social, dans la ligne de ce qu’on appelait « cinéma engagé » à l’instar de Abdallah Bayahya qui traite, dans “Sentiers perdus” (1971) de la difficulté de s’instruire quand on est pauvre, de Majid Rechiche qui décrit l’impuissance des petites gens à faire valoir leurs droits (Al Borak, 1973) et Souheil Ben Barka qui s’attaque à l’exploitation des enfants (Malika, la fille du teinturier, 1973.) D’autre part, ils ont fait montre de créativité et d’opiniâtreté, en faisant valoir leur talent d’artiste et en réalisant des œuvres originales et d’une valeur certaine. Malgré le caractère «utilitaire» des productions commandées, les réalisateurs les imprégnaient de leurs styles et de leurs visions personnelles et la poésie et la sensibilité étaient souvent présentes, à travers des récits et des personnages attachants. La voix off restait prédominante car elle s’avérait, en plus de la beauté et de la poésie des textes, un moyen de mettre en valeur l’image et de lui donner une grande force expressive. Celles des films de cette époque étaient aussi belles que puissantes, grâce au soin que mettaient les opérateurs dans les prises de vue, le meilleur exemple de ces réussites demeure, à notre avis, “Tarfaya ou la marche d’un poète”, (1966), coréalisé par Mohamed Abderrahmane Tazi et Ahmed Bouanani, “Six et Douze” (1968). Ainsi de «docu-fictions» ou de « documentaires poétiques», comme “Keilaz, ma commune, de Larbi Benchekroun (1969), Le logis des hommes”, de Larbi Bennani (1964), “Retour aux sources”, de Abdelaziz Ramdani, en 1963…
Ces films, véritables œuvres personnelles, ont fait le bonheur des cinéphiles et animé d’intenses discussions dans les ciné-clubs. La présentation que fait Mohamed Afifi de son film “Retour à Agadir” (1967) est le meilleur exemple des aspirations artistiques de nos cinéastes : «Cette œuvre n’est pas un documentaire, encore moins un film touristique. Si je devais le «raconter», je dirais qu’il s’agit de la brève course d’une mémoire présentée sous l’apparence d’une statue en plusieurs mouvements. Si cela paraissait insuffisamment clair, j’ajouterais que les strophes qui composent “Retour à Agadir” constituent un ouvrage fermé ». Citons encore parmi les films qui ont eu le plus de succès : “Sin Agafaye” de Latif Lahlou (1967), “Forêt” de Majid Rechiche (1969), “Si Moh pas de chance”, de Moumen Smihi (1970)… Certaines de ces œuvres comme Nuits andalouses, de Larbi Bennani (1963) et “Mémoire 14” du poète-cinéaste Ahmed Bouanani ont été appréciés dans des manifestations internationales, ce dernier ayant reçu le grand prix du court métrage au Festival de Carthage en 1971.
Quelle leçon devons –nous tirer de cette manifestation et de ce rappel ? Sans doute beaucoup. Mais pour notre part, tout en félicitant les organisateurs et malgré les mauvaises conditions de projection, inhérentes aux débuts laborieux, nous avons regretté que les jeunes du quartier Bernoussi où se trouve le complexe bien nommé Hassan Skalli, n’aient pas profité du spectacle et du débat qui a suivi.
Car l’histoire du cinéma, et le visionnage de bons films représentatifs, sont la voie royale à l’éduction au cinéma, et à l’éducation et à la culture en général ainsi qu’à la formation de la personnalité et d’une identité assumée.
Puissent les conditions s’améliorer pour optimiser les activités futures de l’association et puisse cet exemple être suivi par d’autres parties.














 Le Festival ComediaBlanca embrase l’Olympia : Gad El Maleh en invité de marque
Le Festival ComediaBlanca embrase l’Olympia : Gad El Maleh en invité de marque