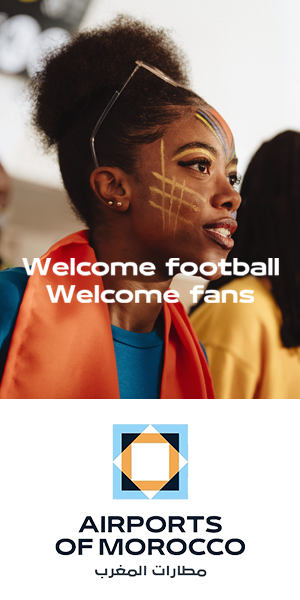Le fil rouge qui relie ces trois auteurs a trait à leur façon de décrire les différentes masculinités
-
Le Festival ComediaBlanca embrase l’Olympia : Gad El Maleh en invité de marque
-
A Paris, accord trouvé pour sauvegarder l'appartement du poète Prévert menacé par le Moulin Rouge
-
L’IMA à Paris s’associe à la fête footballistique de la CAN
-
Importance de la digitalisation dans la préservation du patrimoine culturel
Le fil rouge qui relie ces trois auteures a trait à leur façon de décrire les différentes masculinités. Leur plume trace les contours de ces corps et de ces âmes d’hommes, tiraillés entre leurs aspirations hégémoniques et leur fragilité. Dans « Désirs voilés », la narratrice épouse un Français, plus âgé qu’elle, et découvre l’indépendance. Elle prend ses distances avec une mère « qui n’a pas choisi sa vie » et avec des traditions ressenties dès le plus jeune âge comme aliénantes. Toutefois, le départ pour la France sera loin d’être aussi prometteur qu’il en avait l’air : « Ce que le professeur d’histoire avait oublié de me dire, c’est que de l’autre côté de la Méditerranée, dans l’autre monde, celui de mes rêves... les petites filles arabes deviennent des bougnoules, des beurettes, des ratons, des melons, des merguez, des Maghrébines... Un tout autre statut auquel je ne m’attendais pas ». Lounja sera vue avant tout comme un corps sexualisé, orientalisé, racialisé. Le récit rend compte de cette agression physique des hommes. Ces derniers la voient uniquement comme une «Arabe» et non comme «un être humain». Après avoir été agressée par deux collègues, Lounja vit une sorte de métamorphose radicale de son être, une perte de l’innocence aussi violente que celle qui anime le personnage du roman «La Blanche» (La Cheminante, 2013) de Maï-Do Hamisultane (que j’ai eu l’occasion de voir également à Paris et de féliciter pour l’obtention d’un des prix littéraires 2016 du Sofitel). Désormais, Lounja rendra aux hommes leur violence, en se comportant comme eux, en les utilisant comme de simples objets de désir, en leur infligeant des meurtrissures symboliques analogues aux siennes : « Je n’avais plus aucune peur, aucune angoisse. Je voulais simplement les remercier du cadeau qu’ils venaient de me faire. Leur prouver que j’avais autant de pouvoir qu’eux. Leur prouver que je pouvais moi aussi totalement les dominer, les réduire à ma merci... Faire d’eux ce que je voulais, dès l’instant où j’en avais envie... ». La carapace durcit de plus en plus, brisant le patriarcat et la domination masculine avec une violence que l’on ne voit que très rarement exprimée de cette façon-là dans les textes littéraires. Toutefois, loin de se limiter à un règlement de compte avec les masculinités, cette odyssée dans le corps des hommes est aussi une rédemption et peut-être une ultime tentative de trouver l’amour.
«Dans ces bras-là» de Camille Laurens raconte également, sous un autre angle, le rapport d’une femme à différentes masculinités : «Ce serait un livre sur tous les hommes d’une femme, du premier au dernier – père, grand-père, fils, frère, ami, amant, mari, patron, collègue, dans l’ordre ou le désordre de leur apparition dans sa vie, dans ce mouvement mystérieux de présence et d’oubli qui les fait changer à ses yeux, s’en aller, revenir, demeurer, revenir». Camille Laurens prévient qu’elle ne sera pas la femme du livre. Même quand on dit «Sans contrefaçon», quoiqu’en disent les apparences, c’est une femme qui est cachée derrière. Pas un homme. Une autre femme. Une femme parlant avec émotion des hommes qu’elle a connus et qui s’exprime à travers leurs yeux. L’héroïne nous parle des souffles masculins sur la peau, de leurs voix, de la contingence des rencontres. Elle nous parle de ces hommes qui ont souffert mais que l’on peut rendre heureux. Elle en rencontre un. Elle ne veut pas se marier avec lui. Elle préfère qu’il «l’épouse», que son corps «épouse» le sien lors de ces étreintes voluptueuses. Faire que l’homme de sa vie ne soit pas l’homme de sa mort. Car il est si bon d’être aimée, notamment par quelqu’un qui pose ses yeux sur l’écriture de l’autre : «C’est toujours agréable, pour une femme, de lire un écrivain qui l’aime, en lisant, elle a le sentiment qu’il pense à elle. Elle le désire, elle aimerait le rencontrer; quand elle le lit, elle a terriblement envie de lui, il devient son propre personnage». Peut-être passera-t-elle à l’acte et écrira-t-elle ce qu’elle vit réellement dans la littérature, par-delà le papier et l’encre. Les femmes ont ce pouvoir.
Lorsque je m’assois pour écouter la conférence de Marie Nimier, je viens de dire au revoir à Lounja Charif et je regarde la dédicace de Camille Laurens. Peu à peu, je deviens attentif à cette voix. C’est Zineb qui m’a parlé de la beauté des romans de Marie Nimier. Je veux la connaître. Son dernier roman, « La plage » (Gallimard, 2016), est très beau. Il raconte l’histoire d’une femme, appelée l’inconnue, qui voyage seule en bus. On ne sait ni d’où elle vient ni où elle est va. Elle souffre d’un torticolis. Une fois arrivée dans une île sans nom, elle se rend sur une plage déserte et prend un bain en se déshabillant entièrement. On ne saura jamais pourquoi. Ensuite, elle s’approche d’une grotte. Les souvenirs reviennent. C’est là qu’elle a aimé très fort un homme nommé Le voyageur. Aujourd’hui, il ne reste plus que des souvenirs. Sa vie semble vide, anonyme. La seule personne qui lui apporte une certaine affection est son père. Le reste est vide, comme cette plage non entretenue. Il n’y a rien d’attrayant pour les touristes. L’inconnue sort de l’eau, s’approche de la grotte. Celle-ci a un petit goût de Madeleine sucrée. Une émotion sublime la traverse : « L’instant où elle comprend qu’elle existe, seule, face au paysage. L’instant où elle comprend que le paysage est plus fort qu’elle». Elle aimerait ne plus faire qu’un avec le décor, se fonde en lui. C’est à ce moment qu’elle découvre d’autres personnes dans la grotte. Un homme et une jeune fille avec un piercing. On passe de la Madeleine au voyeurisme, comme chez Proust. L’homme est un colosse. Elle est fascinée par ses muscles, sa corpulence. La nuit, elle l’observe à son insu. Ils partagent une intimité virtuelle. Lorsqu’il découvre sa présence le lendemain matin, il est furieux. L’homme voulait être seul avec sa fille. Puis peu à peu, ils sympathisent, s’apprivoisent. Le désir de l’inconnue pour le colosse se fait de plus en plus violent, malgré la présence déroutante de cette adolescente qui tue des crabes et aime attirer l’attention. En atterrissant à Rabat, après avoir refermé les pages du roman, j’ai repensé aux paroles de Marie Nimier évoquant la couleur des mots et les combinaisons originales de ces coloris scripturaux. Ce soir-là, au moment où j’ai posé le pied sur le sol marocain pour rejoindre mon aimée après ce long périple parisien, le coucher de soleil sur les murs de l’aéroport a eu un parfum d’éternité.
* CRESC/ EGE Rabat
(Cercle de Littérature Contemporaine)















 Le Festival ComediaBlanca embrase l’Olympia : Gad El Maleh en invité de marque
Le Festival ComediaBlanca embrase l’Olympia : Gad El Maleh en invité de marque