
Il y a des artistes qui chantent et d’autres qui habitent la chanson. Mamoun Salaje appartient à cette seconde espèce, rare et exigeante, celle qui ne triche jamais avec l’émotion. Ce jeudi 9 octobre, au «Diwane» de Casablanca, l’artiste marocain rend hommage à Jacques Brel, disparu le même jour en 1978. Une date symbolique, un geste de fidélité, mais surtout un acte d’amour.
Chanteur, comédien, humoriste et animateur, Mamoun Salaje n’a jamais su se limiter à un seul rôle. La scène, pour lui, est un espace vital. Dès l’adolescence, il chante dans les colonies de vacances, avant même de comprendre que la musique sera sa maison. Ce n’est qu’après des études de tourisme et de littérature qu’il s’y consacre pleinement. Entre un piano-bar et une salle de classe, il forge sa voix et son regard. L’art, chez lui, n’est pas un choix mais une évidence.
Et puis, un jour, un ami lui fait écouter Jacques Brel. Nous sommes à la fin des années 70. Brel vient de mourir. Mamoun découvre un homme qui parle de lui, de ses doutes, de ses révoltes, de ses rêves. «Brel m’a offert des réponses», confie-t-il. «A quinze ans, je me posais mille questions. Ses chansons m’ont ouvert les yeux». Cette rencontre sera fondatrice. Des années plus tard, il lui consacrera son mémoire de fin d’études, Le départ chez Jacques Brel, réflexion sur l’élan, le mouvement, cette fuite en avant que le chanteur belge érigeait en philosophie.
De Brel, Mamoun retient la sincérité absolue. Il ne le copie pas : il le prolonge. Sur scène, il ne joue pas à être Brel, il l’incarne, dans le sens le plus profond du terme. Le corps, le regard, la gestuelle, tout participe de cette communion entre le texte et l’homme. «On dit que je l’imite, mais je l’interprète», insiste-t-il. «On ne peut pas chanter Brel sans y mettre son âme». Cette intensité, il l’a apprise auprès du maître Tayeb Seddiki dont il fut l’élève. De lui, il garde le goût de la théâtralité juste, celle qui ne s’affiche pas mais se vit.
Brel, pour Mamoun, n’est pas un modèle lointain mais un compagnon de route, presque un père. «C’est mon père spirituel», dit-il simplement. Comme Brel, il a quitté l’usine — en l’occurrence la Régie des tabacs — pour suivre son instinct d’artiste. Comme Brel, il a choisi la précarité plutôt que le renoncement. Et comme lui, il a fait de la scène son port d’attache et sa raison d’être.
Cet engagement n’a jamais été sans heurts. «Dans une administration, l’artiste reste incompris», affirme-t-il. «Je ne sais pas tricher». Il dit cela avec calme, sans aigreur. Chez lui, la franchise n’est pas provocation, mais fidélité à soi. Héritée de son père, officier de police intègre, cette droiture innerve toute sa trajectoire. On comprend alors pourquoi Mamoun parle de chanson «à texte» avec autant de ferveur : pour lui, chaque mot est un acte.
Lorsqu’il chante Brel à Bruxelles, au théâtre Léopold Senghor, c’est comme s’il revenait aux sources. Le public belge l’accueille avec chaleur, la RTBF et Radio Al Manar couvrent l’événement. Une maladresse dans l’invitation prive la soirée de la présence de la veuve et de la fille de Brel, mais l’émotion n’en est que plus pure. «Je chante pour lui, pour eux, pour ceux qui ne le connaissent pas encore», dit Mamoun. Avant chaque concert, il s’isole quelques instants, par respect pour ce qu’il s’apprête à invoquer : une œuvre, une âme, un souffle.
Ce souffle, on le retrouve aussi dans son travail d’animateur radio. Dans son émission Les dinosaures ne sont pas tous morts, il redonne vie aux grandes voix du passé. Nostalgique assumé, il se revendique des années 70 : la décennie des idéaux, de la musique sincère, des poètes qui croyaient encore au verbe. Sa nostalgie n’est pas une fuite ; elle est résistance à une époque qu’il juge trop bruyante et trop vide.
Lorsqu’on évoque les musiques modernes, Mamoun ne mâche pas ses mots. Il regrette que la vulgarité se confonde désormais avec la liberté, que la provocation supplante la poésie. Il dénonce aussi la dérive d’une chanson populaire marocaine devenue, selon lui, caricaturale et sans âme. Ce regard sévère est celui d’un homme qui croit encore que l’art doit élever.
Et pourtant, derrière la rigueur du discours, il y a la tendresse du chanteur, celle d’un homme qui continue à croire au pouvoir d’une chanson pour bouleverser une vie. Le 9 octobre, quand il montera sur la scène du «Diwane», il ne sera pas seul : Jacques Brel sera là, dans chaque note, chaque silence, chaque souffle.
Mamoun Salaje ne cherche pas à ressusciter le grand Jacques. Il le prolonge dans la langue, dans la passion, dans la fidélité à une idée : chanter, c’est vivre debout. Et tant qu’il y aura des voix comme la sienne pour le rappeler, Brel ne mourra jamais vraiment.
Mehdi Ouassat
Chanteur, comédien, humoriste et animateur, Mamoun Salaje n’a jamais su se limiter à un seul rôle. La scène, pour lui, est un espace vital. Dès l’adolescence, il chante dans les colonies de vacances, avant même de comprendre que la musique sera sa maison. Ce n’est qu’après des études de tourisme et de littérature qu’il s’y consacre pleinement. Entre un piano-bar et une salle de classe, il forge sa voix et son regard. L’art, chez lui, n’est pas un choix mais une évidence.
Et puis, un jour, un ami lui fait écouter Jacques Brel. Nous sommes à la fin des années 70. Brel vient de mourir. Mamoun découvre un homme qui parle de lui, de ses doutes, de ses révoltes, de ses rêves. «Brel m’a offert des réponses», confie-t-il. «A quinze ans, je me posais mille questions. Ses chansons m’ont ouvert les yeux». Cette rencontre sera fondatrice. Des années plus tard, il lui consacrera son mémoire de fin d’études, Le départ chez Jacques Brel, réflexion sur l’élan, le mouvement, cette fuite en avant que le chanteur belge érigeait en philosophie.
De Brel, Mamoun retient la sincérité absolue. Il ne le copie pas : il le prolonge. Sur scène, il ne joue pas à être Brel, il l’incarne, dans le sens le plus profond du terme. Le corps, le regard, la gestuelle, tout participe de cette communion entre le texte et l’homme. «On dit que je l’imite, mais je l’interprète», insiste-t-il. «On ne peut pas chanter Brel sans y mettre son âme». Cette intensité, il l’a apprise auprès du maître Tayeb Seddiki dont il fut l’élève. De lui, il garde le goût de la théâtralité juste, celle qui ne s’affiche pas mais se vit.
Brel, pour Mamoun, n’est pas un modèle lointain mais un compagnon de route, presque un père. «C’est mon père spirituel», dit-il simplement. Comme Brel, il a quitté l’usine — en l’occurrence la Régie des tabacs — pour suivre son instinct d’artiste. Comme Brel, il a choisi la précarité plutôt que le renoncement. Et comme lui, il a fait de la scène son port d’attache et sa raison d’être.
Cet engagement n’a jamais été sans heurts. «Dans une administration, l’artiste reste incompris», affirme-t-il. «Je ne sais pas tricher». Il dit cela avec calme, sans aigreur. Chez lui, la franchise n’est pas provocation, mais fidélité à soi. Héritée de son père, officier de police intègre, cette droiture innerve toute sa trajectoire. On comprend alors pourquoi Mamoun parle de chanson «à texte» avec autant de ferveur : pour lui, chaque mot est un acte.
Lorsqu’il chante Brel à Bruxelles, au théâtre Léopold Senghor, c’est comme s’il revenait aux sources. Le public belge l’accueille avec chaleur, la RTBF et Radio Al Manar couvrent l’événement. Une maladresse dans l’invitation prive la soirée de la présence de la veuve et de la fille de Brel, mais l’émotion n’en est que plus pure. «Je chante pour lui, pour eux, pour ceux qui ne le connaissent pas encore», dit Mamoun. Avant chaque concert, il s’isole quelques instants, par respect pour ce qu’il s’apprête à invoquer : une œuvre, une âme, un souffle.
Ce souffle, on le retrouve aussi dans son travail d’animateur radio. Dans son émission Les dinosaures ne sont pas tous morts, il redonne vie aux grandes voix du passé. Nostalgique assumé, il se revendique des années 70 : la décennie des idéaux, de la musique sincère, des poètes qui croyaient encore au verbe. Sa nostalgie n’est pas une fuite ; elle est résistance à une époque qu’il juge trop bruyante et trop vide.
Lorsqu’on évoque les musiques modernes, Mamoun ne mâche pas ses mots. Il regrette que la vulgarité se confonde désormais avec la liberté, que la provocation supplante la poésie. Il dénonce aussi la dérive d’une chanson populaire marocaine devenue, selon lui, caricaturale et sans âme. Ce regard sévère est celui d’un homme qui croit encore que l’art doit élever.
Et pourtant, derrière la rigueur du discours, il y a la tendresse du chanteur, celle d’un homme qui continue à croire au pouvoir d’une chanson pour bouleverser une vie. Le 9 octobre, quand il montera sur la scène du «Diwane», il ne sera pas seul : Jacques Brel sera là, dans chaque note, chaque silence, chaque souffle.
Mamoun Salaje ne cherche pas à ressusciter le grand Jacques. Il le prolonge dans la langue, dans la passion, dans la fidélité à une idée : chanter, c’est vivre debout. Et tant qu’il y aura des voix comme la sienne pour le rappeler, Brel ne mourra jamais vraiment.
Mehdi Ouassat
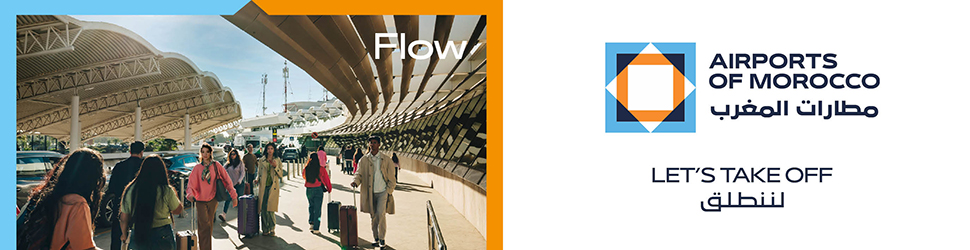
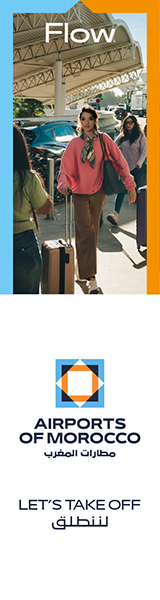













 Jazzablanca dévoile les premiers artistes de sa 19ème édition
Jazzablanca dévoile les premiers artistes de sa 19ème édition



