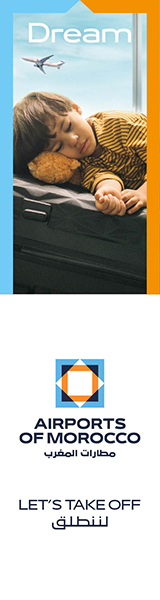-
Situation au Moyen Orient : Mise en place d’une cellule de crise et des numéros de téléphone au profit des Marocains résidant dans les pays concernés
-
Réforme à l’insu des premiers concernés
-
Confirmation d’un partenariat dynamique et privilégié entre Rabat et Helsinki
-
Sahara marocain : la Finlande appuie l’autonomie sous souveraineté marocaine comme solution des plus réalisables
Ce bilan ne se réduit pas à un simple inventaire d’échecs conjoncturels. Il révèle une logique de gouvernance, une conception du pouvoir et une relation problématique à la démocratie, au social et à l’Etat. C’est cette logique qu’il faut interroger, sans complaisance, pour comprendre comment le gouvernement Akhannouch n’a pas su produire de réponses durables aux défis fondamentaux du pays.
1- La dette démocratique, ou le lent effacement du Parlement
La première dette est sans doute la plus structurante, parce qu’elle irrigue toutes les autres et en conditionne la portée. Elle concerne le cœur même du fonctionnement démocratique : la place du Parlement et, au-delà, la conception du pouvoir qui a guidé l’action de l’exécutif tout au long du mandat. Car ces quatre premières années du quinquennat auront été marquées par un paradoxe lourd de sens : jamais les institutions n’ont autant fonctionné formellement, et jamais le débat démocratique n’a semblé aussi appauvri dans sa substance.
Le Parlement, censé être le lieu par excellence de la délibération nationale, a progressivement été relégué à un rôle secondaire. Les grandes orientations ont été décidées ailleurs, souvent en amont, parfois dans l’opacité, puis présentées aux représentants de la nation comme des choix déjà verrouillés. Les séances plénières, retransmises et médiatisées, ont donné l’illusion d’un débat vivant, mais derrière les échanges ritualisés, la marge réelle d’amendement et d’influence s’est considérablement réduite. Trop souvent, la majorité s’est contentée d’aligner ses voix, non pour défendre une vision argumentée, mais pour sécuriser des textes élaborés hors de toute confrontation démocratique sérieuse.
Les projets de loi structurants ont été adoptés dans des délais resserrés, parfois à marche forcée, au détriment de l’examen approfondi. Les commissions parlementaires, pourtant conçues comme des espaces de travail technique et politique, ont vu leur rôle vidé de sa substance. Les auditions se sont raréfiées, les contributions de l’opposition ont été marginalisées et les amendements substantiels rejetés sans véritable justification. Cette méthode n’est pas neutre. Elle traduit une conception verticale du pouvoir, où le Parlement n’est plus un partenaire institutionnel, mais un simple rouage administratif chargé de valider des décisions déjà prises.
Le contrôle de l’action gouvernementale, autre pilier essentiel de la démocratie parlementaire, a lui aussi subi un affaiblissement préoccupant. Les questions orales et écrites, pourtant garanties par la Constitution, ont souvent donné lieu à des réponses évasives, répétitives, voire déconnectées des préoccupations réelles des citoyens. Les commissions d’enquête, instrument fondamental de transparence, ont été soit évitées, soit neutralisées par des jeux de procédure. A mesure que le mandat avançait, une forme de lassitude démocratique s’est installée, nourrissant le sentiment que le contrôle parlementaire relevait davantage de la mise en scène que de l’exercice effectif du pouvoir de reddition des comptes.
A cette marginalisation politique s’ajoute un élément particulièrement préoccupant : la persistance de zones d’ombre autour des finances publiques. La question des comptes non certifiés, régulièrement soulevée par les institutions de contrôle et relayée par des voix responsables, n’a jamais reçu de réponse politique claire, assumée et transparente. Au lieu d’ouvrir un débat sérieux sur la gouvernance budgétaire, l’exécutif a choisi l’évitement, préférant noyer la question dans un flot de chiffres globaux et de déclarations rassurantes. Or, dans une démocratie mature, la gestion de l’argent public ne peut se satisfaire d’approximations ou de silences prolongés. Elle exige clarté, pédagogie et responsabilité.
Ce flou budgétaire n’est pas un simple problème technique. Il fragilise le principe fondamental de reddition des comptes, sans lequel aucune confiance durable ne peut s’installer entre gouvernants et gouvernés. Lorsque les citoyens ne savent plus comment sont utilisés les fonds publics, lorsque les représentants de la nation ne disposent pas de tous les outils pour exercer leur mission de contrôle, c’est l’ensemble de l’édifice démocratique qui se fissure.
Car une démocratie ne s’érode pas uniquement par des atteintes frontales ou spectaculaires aux libertés. Elle s’use aussi par des mécanismes plus discrets : la banalisation de l’opacité, l’affaiblissement progressif des contre-pouvoirs, la réduction du débat à un exercice formel sans portée réelle. Cette érosion silencieuse est d’autant plus dangereuse qu’elle s’installe dans la durée, normalise l’exception et transforme l’urgence en méthode permanente de gouvernement.
En laissant le Parlement s’effacer, en vidant le contrôle démocratique de sa substance, ce gouvernement a contracté une dette lourde, dont les effets dépasseront largement son propre quinquennat. Car restaurer la centralité du Parlement, réhabiliter le débat contradictoire et reconstruire la confiance institutionnelle exigera bien plus qu’un simple changement de majorité. Cela nécessitera une rupture nette avec cette culture de gouvernance fermée et un retour assumé à l’esprit de la Constitution : celui d’un pouvoir partagé, contrôlé et au service de l’intérêt général.
2 - La dette sociale, ou l’illusion statistique de la protection
Présentée comme l’acte fondateur d’un nouvel Etat social, la généralisation de la protection sociale devait marquer un tournant historique dans la relation entre le citoyen et le pouvoir public. Elle promettait de mettre fin à l’injustice la plus archaïque : celle qui veut que l’accès aux soins, à la dignité et à la sécurité sociale dépende du statut professionnel, du lieu de naissance ou de la fortune personnelle. Or, au terme des quatre premières années de ce quinquennat, ce projet apparaît moins comme une conquête sociale que comme une construction fragile, portée davantage par la communication politique que par une ingénierie publique sérieuse.
Dans les discours officiels, les chiffres s’empilent avec une précision presque militaire : tant de millions de personnes couvertes, tant de foyers intégrés, tant de cartes distribuées. Mais derrière cette inflation statistique se cache une réalité autrement plus rude. Etre « affilié » n’est pas être protégé. Des milliers de citoyens, notamment dans le monde rural, dans les quartiers périphériques des grandes villes et parmi les travailleurs de l’informel, découvrent chaque jour l’écart abyssal entre leur inscription sur une base de données et leur capacité réelle à se soigner. Les files d’attente interminables, la pénurie de spécialistes, l’absence de médicaments, l’éloignement géographique des structures hospitalières transforment le droit proclamé en parcours d’obstacles.
Le gouvernement a ainsi confondu extension administrative et couverture sociale réelle. Il a privilégié la logique du chiffre à celle du service, du fichier à celle de l’hôpital, de la carte d’adhésion à celle du médecin. Cette approche technocratique, déconnectée des réalités humaines, a produit une protection sociale de papier : formellement universelle, mais matériellement inaccessible pour une part importante de la population. Le paradoxe est cruel : jamais le Maroc n’a compté autant d’assurés sur le papier, et jamais autant de citoyens n’ont ressenti une telle insécurité face à la maladie.
A cette fragilité structurelle s’ajoutent des dysfonctionnements administratifs profonds. Des milliers de dossiers sont bloqués, des droits suspendus sans explication, des familles radiées ou mal classées. La complexité des procédures, l’opacité des critères et la lenteur des traitements ont transformé ce qui devait être un filet de sécurité en une épreuve bureaucratique. Pour les plus vulnérables, ceux qui ne maîtrisent ni les codes ni les outils numériques, la protection sociale est devenue une forteresse inaccessible, gardée par des algorithmes et des guichets saturés.
Mais la défaillance la plus grave est ailleurs : dans l’abandon progressif du pilier fondamental de toute politique de protection sociale digne de ce nom, à savoir le service public de santé. On ne bâtit pas un Etat social sur des hôpitaux délabrés, des urgences saturées et des personnels épuisés. On ne garantit pas le droit aux soins lorsque le citoyen est contraint de parcourir des dizaines de kilomètres pour trouver un médecin, ou de payer de sa poche des analyses et des médicaments faute de disponibilité dans le public. En négligeant l’investissement massif et continu dans l’infrastructure sanitaire, le gouvernement a vidé la protection sociale de sa substance.
Ce que l’exécutif a offert, ce n’est pas une sécurité, mais une illusion de sécurité. Une promesse sans moyens, un droit sans effectivité, un slogan sans incarnation. La conséquence est une dette sociale profonde, invisible dans les tableaux Excel, mais bien réelle dans les foyers marocains : celle de l’angoisse face à la maladie, du renoncement aux soins, de la dignité blessée.
3- La dette économique, ou la croissance sans partage
A écouter les discours officiels, l’économie marocaine aurait traversé les quatre premières années du quinquennat avec résilience, sang-froid et maîtrise. A lire les communiqués gouvernementaux, les agrégats macroéconomiques raconteraient l’histoire d’un pays en marche, d’une machine productive relancée, d’une croissance certes modeste mais «maîtrisée». Pourtant, pour des millions de Marocains, cette croissance n’a jamais pris la forme d’un mieux-être. Elle est restée un chiffre abstrait, éloigné du panier de la ménagère, du bulletin de salaire et de la recherche quotidienne d’un emploi digne.
Car une économie ne se juge pas seulement à son taux de croissance, mais à sa capacité à transformer cette croissance en opportunités réelles. Or, ces quatre dernières années auront été celles d’une expansion sans inclusion. Lorsque la production a augmenté, elle l’a fait dans des secteurs à faible intensité d’emplois, souvent concentrés, peu redistributifs, laissant à l’écart une grande partie de la population active. Le chômage, notamment celui des jeunes et des diplômés, est resté structurellement élevé, révélant l’incapacité du modèle économique en place à absorber les forces vives du pays.
Les inégalités, loin de reculer, se sont enracinées. Les écarts entre les territoires, entre les catégories sociales, entre ceux qui ont accès aux opportunités et ceux qui en sont durablement exclus se sont creusés. Dans les villes, les classes moyennes ont vu leur pouvoir d’achat s’éroder sous l’effet de l’inflation et de la précarisation du travail. Dans les campagnes et les périphéries urbaines, la vulnérabilité est devenue une condition quasi permanente. La croissance, quand elle existe, n’arrose pas le champ social : elle irrigue quelques îlots, laissant le reste du pays en friche.
Dans ce paysage incertain, les petites et moyennes entreprises, pourtant reconnues comme l’épine dorsale de toute économie moderne, ont été les grandes oubliées de ce gouvernement. L’accès au crédit reste un parcours semé d’obstacles, les garanties exigées sont dissuasives, et les dispositifs publics, souvent mal calibrés, peinent à atteindre ceux qui en ont le plus besoin. A cela s’ajoute un environnement réglementaire complexe, changeant, parfois opaque, qui décourage l’initiative et bride l’investissement. Beaucoup d’entrepreneurs survivent plus qu’ils ne développent leurs activités, enfermés dans une économie de la précarité.
En réalité, ce gouvernement a piloté l’économie sans boussole sociale. Les politiques publiques ont privilégié l’équilibre des tableaux macroéconomiques au détriment de la dynamique humaine. On a géré la croissance comme une fin en soi, non comme un moyen de transformer la société. Le résultat est une accumulation dangereuse : une dette de confiance entre l’Etat et les citoyens, entre les institutions économiques et les classes moyennes et populaires, entre les promesses de prospérité et la réalité des fins de mois difficiles.
4- La dette financière, ou l’endettement comme mode de gouvernance
Sous le gouvernement Akhannouch, l’endettement public n’a pas été un simple instrument de régulation conjoncturelle, utilisé pour amortir les chocs ou financer des investissements stratégiques. Il est devenu un mode de gouvernance à part entière, une béquille permanente destinée à compenser l’absence de choix politiques clairs et de réformes structurelles courageuses. La dette, qui aurait dû être un levier au service de la transformation productive, s’est muée en substitut à la politique économique.
Les chiffres sont implacables. Année après année, le recours à l’emprunt s’est installé dans la routine budgétaire de l’Etat. On n’emprunte plus pour construire l’avenir, mais pour payer le présent : salaires, subventions, dépenses de fonctionnement. Autrement dit, on hypothèque demain pour financer aujourd’hui. Cette dérive est d’autant plus préoccupante qu’elle enferme le pays dans une spirale où chaque exercice budgétaire commence avec le poids des intérêts de la dette, réduisant mécaniquement les marges de manœuvre pour l’investissement productif, l’éducation, la santé ou la recherche.
La question n’est pas seulement économique, elle est profondément politique. Une dette structurelle est une dette qui traduit un déséquilibre durable entre les ambitions affichées et les ressources réellement mobilisées. Au lieu de s’attaquer à ce déséquilibre par une réforme fiscale ambitieuse, par la lutte effective contre l’évasion et la rente, par une meilleure efficacité de la dépense publique, le gouvernement a choisi la facilité de l’endettement. C’est le choix du court terme, du report, de la fuite en avant.
Cette trajectoire soulève aussi une interrogation morale majeure : celle de la justice entre les générations. Les jeunes Marocains d’aujourd’hui et de demain hériteront d’un fardeau qu’ils n’ont pas contracté. Ils devront rembourser une dette dont ils ne verront pas nécessairement les bénéfices sous forme d’infrastructures durables, d’emplois qualifiés ou de services publics de qualité. Ce transfert silencieux de charges est l’une des formes les plus insidieuses de l’injustice sociale, car il se déroule sans débat, sans vote explicite, sans consentement éclairé.
Or, précisément, ce débat n’a jamais eu lieu. La stratégie d’endettement de l’Etat n’a pas été soumise à une discussion nationale digne de ce nom. Le Parlement, pourtant dépositaire de la souveraineté budgétaire, a été cantonné à l’enregistrement de lois de Finances de plus en plus complexes, sans vision lisible à moyen et long termes. Les citoyens, eux, n’ont jamais été associés à ce choix fondamental : combien emprunter, pour quoi faire, et au nom de quel projet de société ?
Ainsi s’est constituée, au fil des années, une dette financière qui est aussi une dette démocratique : celle d’un Etat qui lègue aux générations futures une ardoise dont elles n’ont jamais discuté le contenu.

Jamais, depuis des décennies, l’écart entre les promesses faites à la jeunesse et la réalité de sa condition n’a été aussi abyssal. Le chômage massif, persistant et structurel des jeunes n’est pas un simple indicateur économique : c’est le symptôme d’une rupture profonde entre l’Etat et une génération entière. Derrière les taux et les statistiques se cachent des existences suspendues, des projets de vie différés et des compétences gaspillées. Des milliers de diplômés, après des années d’efforts et de sacrifices, se retrouvent enfermés dans l’attente, ballotés entre stages précaires, emplois informels et découragement.
Cette situation n’est pas une fatalité démographique, mais le résultat direct de choix politiques. Le modèle économique mis en œuvre par le gouvernement Akhannouch n’a pas été conçu pour absorber la masse croissante de jeunes arrivant chaque année sur le marché du travail. Faute d’une stratégie industrielle ambitieuse, d’une politique d’innovation structurée et d’un véritable soutien à l’entrepreneuriat productif, l’économie marocaine est restée incapable de transformer le potentiel de sa jeunesse en richesse nationale. Le pays forme, mais n’intègre pas ; il éduque, mais n’emploie pas.
Les politiques publiques de l’emploi, quant à elles, ont donné l’illusion de l’action sans en produire les résultats. Multipliant les programmes, les labels et les dispositifs temporaires, le gouvernement a substitué la gestion administrative du chômage à sa résolution réelle. Ces mesures, souvent mal ciblées, mal évaluées et faiblement coordonnées, n’ont pas changé la trajectoire globale du marché du travail. Elles ont surtout entretenu l’idée que la jeunesse devait s’adapter à un système défaillant, plutôt que l’inverse.
Or, une génération ne peut pas vivre indéfiniment sous le régime de l’attente. L’absence de perspectives professionnelles durables fragilise le lien social, nourrit l’exode, la défiance, parfois la colère. Une jeunesse qui ne trouve pas sa place dans l’économie finit par douter de sa place dans la nation. C’est là que naît la dette générationnelle : quand un pays consomme l’énergie, l’intelligence et l’espérance de ses jeunes sans leur offrir en retour un avenir à la hauteur de leurs efforts.
Ce que la jeunesse marocaine réclame n’est pas une succession de contrats précaires ni des aides ponctuelles, mais une vision claire de son rôle dans le projet national. Elle veut être actrice du développement, pas simple variable d’ajustement. Elle attend un Etat qui investisse dans les secteurs d’avenir, qui valorise les compétences et qui crée un environnement propice à l’initiative et à la créativité.
En laissant s’installer le chômage de masse des jeunes comme une normalité, les quatre premières années du gouvernement Akhannouch ont hypothéqué bien plus que des trajectoires individuelles : elles ont compromis une part de l’avenir collectif. Car une société qui met sa jeunesse en attente est une société qui, en réalité, renonce à elle-même.
6 - La dette humaine, ou l’échec face à la pauvreté
Il devait s’agir de la grande promesse morale du quinquennat : arracher un million de familles à la pauvreté et réconcilier l’Etat avec les plus fragiles. Cette promesse, répétée à l’envi dans les discours officiels, résonne aujourd’hui comme un engagement non tenu, presque comme une parole trahie. Car loin de reculer, la précarité s’est installée dans le quotidien de larges franges de la population, nourrie par une inflation galopante, par la raréfaction des emplois stables et par l’érosion continue des services publics.
Pour des millions de Marocains, la pauvreté n’est pas une abstraction statistique, mais une réalité concrète : celle du panier alimentaire qui se réduit, des factures d’eau et d’électricité qui pèsent de plus en plus lourd, des soins médicaux reportés faute de moyens, de la scolarité des enfants compromise par le manque de ressources. Cette dégradation silencieuse des conditions de vie est d’autant plus insupportable qu’elle contraste violemment avec le récit officiel d’un pays en progrès.
Le drame est que la politique sociale menée par ce gouvernement s’est trop souvent contentée de gérer la pauvreté au lieu de la combattre. Les aides, lorsqu’elles existent, sont fragmentées, insuffisantes, parfois mal ciblées. Elles atténuent ponctuellement la détresse sans jamais s’attaquer aux causes profondes : l’absence d’emplois décents, la faiblesse des salaires, l’inégalité d’accès à l’éducation et à la santé, en plus de la marginalisation territoriale. On distribue des filets de survie là où il faudrait bâtir des tremplins vers l’autonomie.

C’est cela, la dette humaine : une accumulation de frustrations, de renoncements et de blessures sociales que ne compensent ni les annonces ni les slogans. Elle touche au cœur même de la dignité, car elle rappelle à ceux qui peinent que leur sort n’a pas été une priorité politique. Un pays qui accepte que tant de ses citoyens vivent dans l’insécurité matérielle et morale ne compromet pas seulement sa cohésion sociale ; il érode les fondements mêmes du pacte démocratique.
7 - La dette réformatrice, ou l’immobilisme stratégique
Depuis des années, le diagnostic est connu, partagé, documenté. Le système de retraites est sous tension, la fiscalité est inéquitable, l’investissement est entravé par des rigidités structurelles et l’éducation peine à remplir sa mission d’ascenseur social. Ces chantiers ne sont pas des surprises surgies en cours de route; ils étaient identifiés, hiérarchisés et débattus bien avant le début du quinquennat. Ce qui a manqué, ce n’est pas la connaissance des problèmes, mais la volonté politique d’y faire face.
La réforme des retraites, par exemple, a été sans cesse repoussée, traitée par petites touches techniques, alors qu’elle exigeait une refonte globale et un dialogue social courageux. Chaque année de retard creuse le déséquilibre financier des régimes et rend les ajustements futurs plus brutaux. La même logique de procrastination a prévalu en matière fiscale : au lieu de bâtir un système plus juste, plus progressif et plus efficace, on a multiplié les ajustements marginaux, laissant intactes les rentes, les niches et les inégalités de contribution.
Dans le domaine de l’investissement, les annonces n’ont pas manqué, mais la lisibilité et la cohérence ont fait défaut. Les règles changent, les procédures s’alourdissent, les incitations se contredisent, décourageant les acteurs économiques et freinant l’initiative productive. Quant à l’éducation, censée être le socle de toute stratégie de développement, elle a été ballottée entre réformes inachevées et projets sans continuité, au détriment de la qualité de l’enseignement et de l’égalité des chances.
Ce blocage n’est pas seulement administratif ; il est profondément politique. Il traduit une incapacité à assumer le coût immédiat des réformes pour en récolter les bénéfices à long terme. Plutôt que d’affronter les résistances, d’expliquer les choix et de construire des compromis sociaux durables, le gouvernement a préféré gérer le présent, préserver des équilibres fragiles et repousser les décisions difficiles.
Mais l’immobilisme a un prix, et ce prix est élevé. Chaque réforme différée devient plus complexe, plus douloureuse, plus conflictuelle. Chaque problème laissé en suspens s’aggrave, rétrécissant les marges de manœuvre des gouvernements futurs. En choisissant la facilité du statu quo, le mandat du gouvernement actuel a accumulé une dette réformatrice qui pèsera lourdement sur le pays.
Une nation ne progresse pas en évitant les choix, mais en les affrontant. Le courage politique ne consiste pas à préserver l’équilibre d’un instant, mais à construire celui de demain. En renonçant à cette exigence, le gouvernement en place a sacrifié l’intérêt général sur l’autel de la courte vue.
8 - La dette stratégique, ou le renoncement au Nouveau modèle de développement
Le Nouveau modèle de développement devait être bien plus qu’un document de référence : il se voulait une boussole historique, un contrat entre l’Etat et la société, une projection collective vers le Maroc de demain. Fruit d’une réflexion nationale large, mobilisant experts, institutions et forces vives, il portait l’ambition de rompre avec les logiques d’essoufflement et de reproduction des inégalités. Pourtant, au fil du mandat du gouvernement Akhannouch, cette feuille de route s’est progressivement vidée de sa substance, réduite à un slogan commode plutôt qu’à un guide réel de l’action publique.
Le problème n’a pas été l’absence de diagnostic, mais l’absence de traduction politique. Les principes du Nouveau modèle de développement – justice sociale, équité territoriale, montée en valeur de l’économie, réforme de l’Etat – auraient dû irriguer chaque politique publique, chaque loi de Finances, chaque arbitrage gouvernemental. Or, ils ont été traités comme un supplément d’âme, évoqués dans les discours, mais rarement incarnés dans les décisions. Les stratégies sectorielles ont continué à avancer en ordre dispersé, sans cohérence globale, sans hiérarchisation claire des priorités.
Cette dissonance entre la vision affichée et l’action réelle révèle une abdication stratégique. Gouverner, ce n’est pas seulement gérer les urgences, c’est inscrire l’action de l’Etat dans une trajectoire lisible. Or, en l’absence d’un cap fermement assumé, les politiques publiques se sont fragmentées, parfois contredites, souvent diluées. Les réformes se sont accumulées sans s’additionner, les programmes se sont juxtaposés sans produire de dynamique d’ensemble.
Le coût de ce renoncement est immense. Sans vision partagée, les acteurs économiques hésitent, les administrations tâtonnent et les citoyens doutent. Le pays avance, mais sans direction claire, comme un navire privé de gouvernail. Cette errance stratégique affaiblit la capacité du Maroc à mobiliser ses ressources, à attirer l’investissement et à engager sa jeunesse dans un projet collectif.
Le Nouveau modèle de développement aurait pu être le socle d’un nouveau pacte social et économique. En le reléguant au rang de vitrine, le gouvernement a manqué l’occasion de donner au pays un horizon crédible. Et une nation sans horizon est une nation qui s’expose à l’usure, au découragement et à la dispersion de ses forces.
9 - La dette institutionnelle, ou la confiance érodée
La solidité d’un Etat ne se mesure pas seulement à la force de ses lois, mais à la crédibilité de ses institutions. Or, durant le mandat Akhannouch, un phénomène aussi discret que préoccupant s’est installé: l’érosion progressive de la transparence et l’affaiblissement des mécanismes de contrôle. Ce recul n’a pas toujours pris la forme de décisions spectaculaires, mais il s’est traduit par une accumulation de pratiques, de silences et de contournements qui, mis bout à bout, ont fragilisé le socle de la confiance publique.
Les institutions chargées de veiller à la bonne gouvernance, à la régularité des finances publiques et à la probité de l’action administrative ont vu leur rôle se restreindre, parfois marginalisé, parfois neutralisé par l’absence de suites politiques à leurs rapports. Publier des audits sans en tirer de conséquences, dénoncer des dysfonctionnements sans en corriger les causes, c’est installer une culture de l’impunité. Et cette culture est mortifère pour la démocratie, car elle alimente l’idée que les règles existent pour être contournées, et non pour être respectées.
La transparence, pilier fondamental de toute gouvernance moderne, a elle aussi reculé. L’accès à l’information, pourtant consacré par la loi, est souvent resté théorique. Les données essentielles, notamment en matière budgétaire, d’investissements publics ou de gestion des grands projets, demeurent difficiles d’accès, fragmentées ou présentées de manière peu intelligible pour le citoyen. Ce brouillard informationnel empêche un débat public éclairé et réduit la capacité de la société civile, des médias et du Parlement à exercer leur rôle de vigie.
Cette opacité nourrit un climat de suspicion généralisée. Lorsque les citoyens ne comprennent plus comment les décisions sont prises, comment l’argent public est utilisé et comment les responsabilités sont établies, la défiance s’installe. Et une démocratie fondée sur la défiance est une démocratie fragilisée, car le consentement à l’impôt, à la loi et à l’effort collectif repose avant tout sur la conviction que l’Etat agit avec équité et intégrité.
La dette institutionnelle est insidieuse précisément parce qu’elle ne se voit pas immédiatement dans les statistiques économiques. Elle se manifeste dans les conversations, dans les réseaux sociaux, dans le scepticisme croissant face aux annonces officielles. Elle s’accumule chaque fois qu’une question reste sans réponse, qu’un scandale s’éteint sans clarification et qu’une institution de contrôle est ignorée.
Réparer cette dette exigera bien plus qu’un changement de ton. Il faudra restaurer l’autorité morale des institutions, garantir leur indépendance réelle et rétablir la transparence comme norme, non comme exception. Car sans confiance, l’Etat perd sa légitimité, et sans légitimité, aucune politique publique ne peut durablement produire de résultats.
10 - La dette morale, ou l’effritement de la promesse démocratique
Au-delà des chiffres, des budgets et des indicateurs, il existe une dette plus grave encore, parce qu’elle touche à l’âme même du pacte démocratique : la dette morale. Elle ne s’inscrit dans aucun tableau de bord, mais elle se lit dans le rétrécissement des libertés, dans la disqualification progressive de la parole critique et dans la fermeture des espaces de débat public. A l’ère du gouvernement Akhannouch, la dérive n’a pas été brutale ni spectaculaire, mais lente, diffuse, presque insidieuse. Et c’est précisément ce qui la rend dangereuse.
La démocratie ne meurt pas toujours sous les coups d’un gouvernement autoritaire proclamé. Elle s’érode souvent dans le silence, lorsque l’opposition est marginalisée, lorsque les voix dissidentes sont soupçonnées plutôt qu’écoutées et lorsque le pluralisme devient une formalité plutôt qu’une réalité vivante. Le débat public s’est appauvri, réduit à des joutes stériles ou à des communications verrouillées, pendant que les décisions majeures se prenaient loin du regard des citoyens.
Ces quatre premières années du quinquennat ont ainsi donné à voir un exécutif qui a appris à durer sans convaincre, à décider sans dialoguer et à gouverner sans véritablement écouter. La logique de la communication a progressivement remplacé celle de la délibération. La légitimité du nombre a été invoquée pour écarter la légitimité de l’argument. Or une démocratie ne se résume pas à des majorités arithmétiques : elle vit du respect de la contradiction, de la reconnaissance de l’autre et de la confrontation des idées.
Cette érosion de l’esprit démocratique laisse des traces profondes. Elle nourrit le cynisme, le désengagement, parfois la colère. Elle éloigne les citoyens de la chose publique et affaiblit le sentiment d’appartenance à une communauté politique partagée. Quand les promesses démocratiques – participation, transparence, responsabilité – sont trahies, c’est la confiance collective qui se délite.
Et pourtant, l’histoire politique l’enseigne avec constance : les promesses trahies finissent toujours par revenir, sous la forme de revendications, de mobilisations ou de crises de légitimité. On peut contenir les voix, on ne peut pas étouffer indéfiniment les aspirations. Un pouvoir peut différer la reddition des comptes, il ne peut l’abolir.
A l’heure où ce quinquennat touche à sa fin, l’addition est lourde, non seulement pour l’économie et le social, mais pour la démocratie elle-même. Reste désormais une question décisive : qui aura le courage de regarder cette réalité en face, de rompre avec la culture du monologue et d’ouvrir, enfin, un nouveau chapitre fondé sur la justice sociale, la démocratie vivante et la confiance retrouvée entre l’Etat et ses citoyens ?