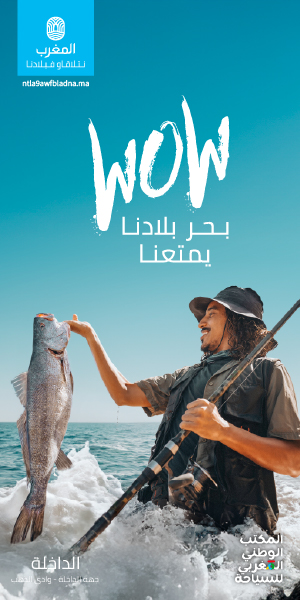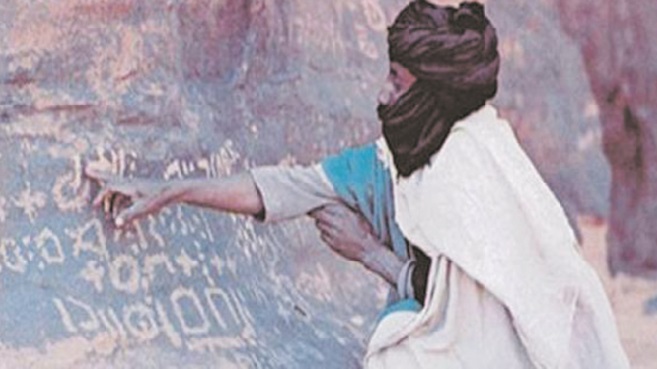
-
L’intelligence artificielle et la démocratie participative au cœur du nouveau numéro de la REIEJP
-
Pr Mohamed Knidiri : Le FNAP est l’affirmation de notre identité, de notre culture et de la force de leur profondeur historique
-
1ère édition des Rencontres méditerranéennes de Tanger
-
Sous les étoiles de la Tanger Fashion week : Luke Evans, Chopard, Vivienne Westwood, une nuit étincelante pour la Fondation Lalla Asmaa
Les chercheurs et universitaires participant au forum, organisé par l’Association Bouizakarne pour le développement et la culture sous le slogan: "La culture amazighe et hassanie au service de l'identité nationale", ont débattu de ce concept lors d'un colloque scientifique intitulé "Toponymie dans le sud du Maroc: un champ de communication entre l'amazigh et la hassanie".
Pour ce faire, ils ont abordé le concept de "toponymie", une discipline linguistique qui étudie les toponymes (noms propres désignant un lieu), à travers des axes comprenant notamment l’échange entre ces deux composantes culturelles.
Dans ce contexte, le professeur-chercheur à la Faculté des lettres et sciences humaines et spécialiste des études linguistiques espagnoles, Ahmed Saber, a défini la "topologie" comme "un lieu de rencontre entre la langue hassanie et celle amazighe", en présentant deux livres qu'il a traduits de l'espagnol vers l'arabe, à savoir "Etudes sahraouies" par Julio Caro Barruja et les "Puits du Sahara" de Gomis Pourinho.
M. Saber a mis l’accent sur le contenu et les manifestations de l'"acculturation" qui s'est produite sur les langues amazighe et hassanie et leur impact sur la vie quotidienne dans cette région, citant les noms de puits qui, au fil du temps, sont devenus des noms de villes et de centres urbains.
De son côté, le chercheur en culture amazighe, Houcine Ait Bahoucine a présenté un nouveau concept qu'il a appelé "la toponymie migratoire" en étudiant "Mjat" (noms de régions au Maroc) comme modèle pour ce nouveau concept.
Il a expliqué que des "Mjat" existent dans le Sahara, en particulier sur la côte de Sakia El Hamra, dans le Moyen Atlas et à la périphérie de Meknès ainsi qu’à El Haouz de Marrakech, en particulier Chichaoua, notant que certains habitants de ces régions parlent l'arabe, tandis que d’autres parlent l'amazigh. Aux yeux de ce chercheur, il s’agit du couronnement et de la concrétisation du vivre-ensemble que le Maroc connaît depuis des siècles.
Ce forum a été organisé en partenariat avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports - secteur de la culture, l'Université Ibn Zohr et la Direction régionale de la culture de la région de Guelmim-Oued Noun et la Commission régionale des droits de l’Homme.




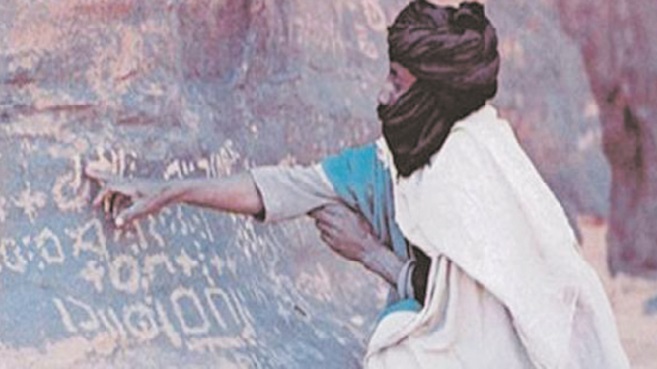








 L’intelligence artificielle et la démocratie participative au cœur du nouveau numéro de la REIEJP
L’intelligence artificielle et la démocratie participative au cœur du nouveau numéro de la REIEJP