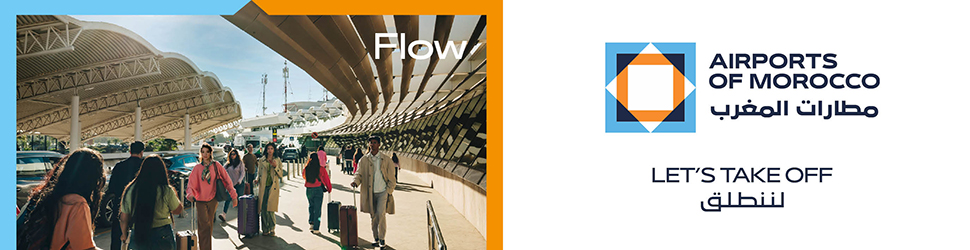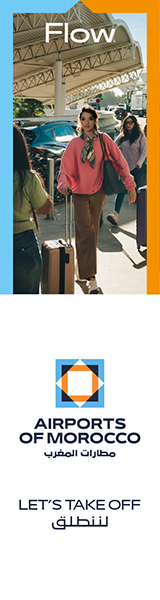Même quand on pense avoir été servi, la précarité est là pour tout gâcher

Les plus éduqués ne sont pas épargnés: malgré leurs diplômes, nombreux sont ceux qui enchaînent les emplois précaires, sans aucun lien avec leur formation. Certains sont condamnés à travailler sans contrat, sans protection sociale et pour des salaires dérisoires – bien en dessous du SMIG. Cafés, ateliers et petites entreprises profitent d’une main-d’œuvre bon marché, souvent exploitée.
Diplômés mais déclassés, actifs mais invisibles, des milliers de jeunes Marocains jonglent donc avec des petits boulots, sans jamais décrocher le poste à la hauteur de leurs compétences. Rencontre avec quatre d’entre eux.
Sara, diplômée sans avenir: "Mon diplôme ne m’a jamais ouvert de portes"
A 26 ans, Sara garde encore en elle les éclats d’un rêve d’étudiante. Lorsqu’elle parle de ses années à l’école de commerce, son regard s’éclaire un instant, comme pour conjurer la fatigue qui creuse ses traits. Diplômée depuis plus de quatre ans en commerce et gestion, elle imaginait alors un avenir fait de bureaux vitrés, de réunions stratégiques, de responsabilités et d’évolution. Mais à sa sortie de l’école, aucune entreprise ne lui a tendu la main. Et très vite, l’urgence de survivre a étouffé l’attente d’un avenir prometteur. «Je ne pensais pas que ce serait si difficile. On m’avait dit que le marché avait besoin de cadres en gestion. Mais les seules réponses que je reçois, ce sont des silences ou des stages non payés», témoigne-t-elle.
Sara a fini par accepter ce qu’elle appelle aujourd’hui un “job de survie”. Elle vend des produits cosmétiques et médicaux dans le cadre d’un système de vente pyramidale. Pas de bureau. Pas de salaire fixe. Pas de reconnaissance. Son quotidien se résume à une succession de coups de fil, de rendez-vous dans des cafés, de justifications à des clients sceptiques ou pressants. Elle doit répéter inlassablement les mêmes arguments: l'efficacité du produit, ses bienfaits, la qualité garantie. "Mais tout repose sur ta voix. Ta capacité à persuader. A séduire parfois", confie-t-elle avec une moue d’amertume.
Elle travaille sans horaire défini. "En fait, je travaille tout le temps. Je dors avec mon téléphone à côté de moi, j'envoie des messages à minuit, je réponds à des appels au réveil", raconte-t-elle. Et malgré toute cette énergie déployée, la fin du mois ne lui réserve souvent que de maigres revenus, vite engloutis dans les frais quotidiens: le café où elle installe ses rendez-vous, les cartes téléphoniques pour relancer les clients, les taxis quand les bus sont rares, les sandwiches avalés entre deux visites.
Mais ce n’est pas seulement la fatigue qui l’épuise. C’est aussi cette forme d'humiliation qu’elle ressent parfois, quand des clients hommes confondent discours commercial et flirt, ou glissent des sous-entendus lourds à peine voilés. "Certains pensent que parce que je leur parle gentiment, je suis disponible. Je dois sourire, mais toujours me méfier. C’est épuisant."
Sans contrat, sans couverture sociale, Sara n’a aucun filet. Si elle tombe malade, si elle se lasse, si elle échoue, il n’y a rien. «Parfois, je me demande à quoi m’a servi mon diplôme. A part me donner de faux espoirs». Elle marque une pause, regarde ses mains posées sur la table, puis murmure: «Je n’ose même plus rêver d’un bureau. Je rêve juste d’un salaire fixe, d’un week-end, d’un peu de respect». Pourtant et malgré tout, elle continue. Parce qu’il faut bien tenir. Parce qu’il n’y a pas d’alternative. Parce qu’au fond, elle n’a pas renoncé. Pas encore.
Samira, styliste sans croquis: "J’ai l’impression de vivre la vie de quelqu’un d’autre"
Samira, fait également partie de cette jeunesse instruite mais déclassée, sacrifiée sur l’autel d’un marché du travail qui n’a pas su lui faire une place. A 22 ans, elle a déjà rangé ses rêves dans un tiroir qu’elle n’ouvre plus. Diplômée en stylisme et modélisme, elle pensait que ses journées seraient rythmées par les tissus, les croquis et les défilés. «Quand j’ai choisi cette filière, je me voyais créer des vêtements, faire vibrer des idées sur du tissu, raconter des histoires à travers la mode. Aujourd’hui, je ne fais que courir après des tableaux Excel».
Installée dans les bureaux exigus d’une entreprise textile, Samira ne touche jamais une aiguille. Elle fait partie de la direction, mais pas pour apporter sa sensibilité artistique. Elle s’occupe de tout ce que les autres refusent de faire: achats, suivi des fournisseurs, gestion du transit, règlement des factures, préparation des devis, logistique des déplacements, accueil des clients étrangers. Même les réservations d’hôtel ou l’achat des cadeaux de fin d’année pour les partenaires lui incombent. Une fonction fourre-tout qu’elle assume par nécessité, pas par choix.
«On m’a embauchée parce que j’étais jeune, dynamique et flexible. Je comprends maintenant que ça voulait dire: corvéable à merci», dit-elle, le regard vide. Elle commence sa journée à 7h30, finit rarement avant 18h, avec à peine une heure de pause. Et pourtant, malgré cette implication totale, aucun congé payé, aucun jour férié garanti. «Quand je tombe malade, je reste chez moi, sans salaire, sans certificat, sans rien. Et si je rate un jour, on me le reproche comme une trahison».
Samira dit percevoir un "bon salaire", mais ce confort apparent cache une précarité sourde. Aucun contrat en bonne et due forme, aucune couverture sociale. «Je gagne de quoi payer mes factures, mais si j’ai un accident, si j’ai besoin d’une opération, c’est fini. Tout repose sur moi, et je ne suis même pas sûre que mon poste existera dans six mois. »
Elle confie qu’elle se sent souvent «illégitime dans sa propre vie». «Je suis styliste, mais je n’ai plus touché à un dessin depuis un an. J’ai l’impression de vivre la vie de quelqu’un d’autre, une sorte de remplaçante temporaire dans un monde qui ne me reconnaît pas».
Cependant, elle continue de se lever chaque matin, ponctuelle, polie, efficace. Elle endure, comme beaucoup d’autres, ce décalage entre ce pour quoi elle a étudié et ce qu’on attend d’elle aujourd’hui. «Ce n’est pas que je manque de courage. C’est que je ne sais plus si ça vaut encore la peine de rêver». Puis elle conclut dans un souffle: «Peut-être qu’un jour, je reprendrai mes crayons. Mais pour l’instant, je suis fatiguée».
Saïd, 33 ans, un ouvrier funambule : «Je travaille, mais je n'existe nulle part».
La précarité de l’emploi ne touche pas que les femmes. Said en sait quelque chose. A 33 ans, il connaît le monde du travail mieux que quiconque — mais de l’intérieur, dans ses recoins les plus sombres. Depuis dix ans, il saute d’un emploi à l’autre, comme un funambule qui ne toucherait jamais vraiment le sol. Vendeur dans une boutique de prêt-à-porter, gérant d’un cybercafé, chauffeur occasionnel pour une société de livraison, puis récemment voiturier dans un restaurant de luxe. Chaque nouveau poste est une tentative pour respirer un peu mieux. Mais l'air est toujours aussi lourd.
«J’ai fait tellement de choses que je ne sais plus dire quel est mon métier. J’ai juste appris à m’adapter, à me taire et à encaisser».
Son service commence avant l'ouverture et s'étire bien après la fermeture, sans heure fixe, sans contrat signé et sans assurance. «Si je tombe ou si on me renverse, personne ne viendra me chercher». Sa voix est calme, presque résignée. Il ne parle pas avec colère, mais avec une lucidité tranchante. «Tous les jobs que j’ai faits, c’est la même histoire : longues journées, pas de pause, chefs qui crient, clients qui te méprisent, et à la fin, un billet froissé glissé dans la poche».
Il se sent prisonnier d’un système où le travail ne garantit plus ni statut, ni avenir. «J’ai l’impression de courir sans fin, comme si j’étais en punition permanente». Et chaque changement d’emploi n’apporte qu’un nouveau décor à une pièce dont il connaît déjà le scénario : précarité, instabilité, invisibilité.
Ce qui le blesse le plus, ce n’est pas tant la fatigue, ni même l’absence de congés ou de droits sociaux. C’est ce sentiment diffus de n’appartenir à rien. «Tu travailles, tu obéis, tu fais tout bien… mais tu n’existes dans aucun fichier. Ni pour la CNSS, ni pour une banque, ni pour une assurance. Tu vis au jour le jour, sans traces. Comme si tu étais de passage, même dans ta propre vie».
Saïd ne rêve plus vraiment d’un grand avenir. Il voudrait simplement un emploi qui lui permette d’exister officiellement. «Juste un contrat, un vrai, avec des droits. Un jour de repos sans avoir à supplier. Un mois payé à temps. Ce ne sont pas des rêves, c’est le minimum».
Et pourtant, chaque matin, il retourne au travail, les épaules droites, le sourire prêt à être dégainé pour les clients pressés. Parce qu’il n’a pas le choix. Parce qu’il faut manger. Parce qu’il espère, encore, qu’un jour, quelqu’un regardera au-delà de son badge effacé.
Soufiane, 47 ans, ouvrier de l’ombre: «A mon âge, je survis plus que je ne vis»
Le visage buriné par les années de labeur, les mains rugueuses d’avoir tout porté sauf la reconnaissance, Soufiane, 47 ans, parle d’une voix posée, comme s’il avait appris à faire taire l’amertume. Il n’a jamais décroché de diplôme. Très jeune, il a rejoint le monde du travail, convaincu que l’effort suffirait à ouvrir les portes d’une vie décente. «Je croyais qu’en travaillant dur, on finissait par s’en sortir… mais j’ai compris que ce n’est pas toujours vrai».
Depuis plus de deux décennies, Soufiane multiplie les expériences, les horaires, les employeurs. Il a été manutentionnaire, agent de sécurité, aide-maçon, puis chauffeur dans une entreprise de transport du personnel. Mais dans chaque métier, il retrouve le même décor: des journées interminables, des ordres secs, des salaires versés en retard — parfois en morceaux, parfois pas du tout —, et surtout, aucune garantie pour demain.
Dans sa dernière expérience, il devait conduire chaque jour des ouvriers et cadres de différentes entreprises à travers la ville et les zones industrielles voisines. Une mission essentielle, mais peu considérée. Ce qu’il a découvert alors, c’est une nouvelle forme de précarité: celle des contrats temporaires en cascade. « Tous les six mois, on me faisait signer un nouveau contrat. Jamais renouvelable. Et entre deux contrats, il fallait patienter. Pas de salaire, pas d’assurance, juste l’attente».
Ces périodes creuses, sans revenu, sont les plus dures. « Tu continues à te lever tôt, tu continues à espérer un appel, tu n’as pas le droit de tomber malade. Parce que tu sais que personne ne te couvrira. Et tu dois quand même payer le loyer, nourrir les enfants».
A son âge, il devrait être un travailleur expérimenté, respecté, stabilisé. Mais Soufiane a l’impression d’avoir tourné en rond toute sa vie. «J’ai bossé depuis que j’ai 16 ans, mais je n’ai rien de concret. Pas d’épargne, pas de sécurité sociale, pas de retraite en vue. Même les papiers de mes contrats, je ne les ai pas tous».
Les chefs, il les décrit comme souvent capricieux, autoritaires, changeants. Les horaires? "De 5h du matin à 8h du soir, sans heures supplémentaires payées." Les salaires? "Médiocres et versés à moitié, ou en retard, ou jamais." Et au volant de son minibus, les embouteillages deviennent chaque jour plus étouffants. «J’ai le sentiment d’étouffer, au propre comme au figuré».
Soufiane n’est pas amer, mais fatigué. Il n’attend plus de miracle. Il espère juste que ses enfants ne connaîtront pas la même errance professionnelle. «Je veux qu’ils étudient, qu’ils aient une carte de couverture médicale, une vraie fiche de paie, un compte bancaire avec un salaire fixe».
Et lui? Il continue de se battre, silencieusement. Parce que dans cette économie où la stabilité est un luxe, Soufiane, comme tant d'autres, travaille non pas pour vivre… mais pour survivre.
Une génération à la dérive
Pour Mohammed Chaoui, spécialiste des politiques publiques, les récits croisés de Sara, Samira, Saïd et Soufiane dévoilent un tableau saisissant d’une réalité trop souvent tue: celle d’un marché du travail marocain miné par l’informel, les abus structurels et une précarité devenue norme. «Qu’ils soient jeunes diplômés, autodidactes ou travailleurs de longue date, ces femmes et ces hommes incarnent une génération confrontée à l’impasse d’un système qui promet sans jamais tenir parole», note-t-il. Et de poursuivre : « A travers leurs parcours cabossés, c’est toute une jeunesse — et même au-delà — qui semble condamnée à vivre à la marge. Une jeunesse instruite mais sous-employée, qualifiée mais ignorée, sacrifiée sur l’autel de la flexibilité à outrance. Les droits élémentaires — couverture sociale, congés payés, salaire stable — deviennent des privilèges rares. Les statuts flottent entre emploi dissimulé et contrats jetables, les frontières entre formel et informel s’effacent au rythme de la précarisation générale».
Et pourtant, ils tiennent, ajoute notre interlocuteur. «Non pas parce qu’ils y croient encore aveuglément, mais parce que l’espoir demeure leur seul moteur. L’espoir que leurs efforts finiront par payer. L’espoir qu’un changement — politique, économique, humain — viendra redonner sens au mot «travail». L’espoir que demain, enfin, sera un peu plus juste», souligne-t-il. Et de conclure: «Ils sont les visages de cette génération désenchantée mais lucide, épuisée mais debout. Une génération qui, malgré l’indifférence des institutions, malgré l’hostilité d’un marché du travail déshumanisé, continue d’exiger une chose simple et essentielle : vivre dignement de son travail».
Hassan Bentaleb
lire également: Dr Soumaya Belkasseh : Le secteur de l’intérim s’est développé rapidement, sans l'encadrement qui doit aller avec. Cela a entraîné une forme de précarité organisée