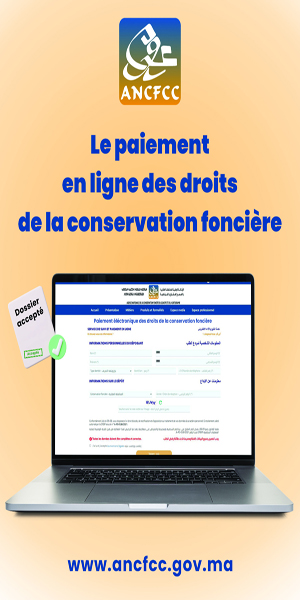-
Le rôle de l’arabe dans la traduction scientifique au cœur d'un colloque international à Rabat
-
Ramadan sur Al Aoula : Une programmation riche et variée
-
Biennale de Venise : Pour la première fois, un pavillon marocain au cœur de l'Arsenale
-
Jack Lang contraint à la démission de l'Institut du monde arabe
Comme plusieurs membres de sa famille, Chopin, le musicien romantique par excellence, ne jouissait pas d'une bonne santé. Il toussait beaucoup, souffrait d'infections pulmonaires, de fièvre et, vers la fin de sa vie, de maux de tête. Il souffrait aussi de dépression.
Selon des scientifiques polonais, sa mort pourrait être attribuée non pas à la tuberculose, comme on le croyait généralement, mais à une fibrose kystique ou mucoviscidose, une maladie génétique qui touche les poumons. Cette probabilité n'a pu être vérifiée, le gouvernement polonais ayant refusé que l'on effectue un test ADN sur le coeur de l'artiste, conservé à Varsovie.
Il fut en outre régulièrement en proie à des hallucinations. Deux médecins espagnols, Manuel Vazquez Caruncho et Francisco Brañas Fernandez, des services de radiologie et de neurologie de l'hôpital de Lugo (Espagne), ont voulu essayer de comprendre d'où elles pouvaient venir. Ils ont épluché pour ce faire les livres de témoins, au premier rang desquels George Sand, longtemps sa compagne. Le résultat de leurs recherches est publié mardi dans Medical Humanities, un des titres du groupe British medical journal (BMJ).
Une biographie du musicien (Bernard Gavoty, 1985) raconte un incident survenu lors d'un concert privé à Manchester, en août 1848. Alors même qu'il interprétait sa sonate en si mineur, il quitta précipitamment le piano, juste après le scherzo. "Je vis émerger du piano ces créatures maudites apparues déjà par une nuit lugubre dans un monastère" de Majorque, raconte-t-il dans une lettre à la fille de George Sand.
A Majorque, lors d'un voyage effectué dix ans plus tôt, George Sand raconte que le cloître du monastère "était pour lui plein de terreurs et de fantômes". Une autre fois, toujours à Majorque, Chopin, alors qu'il pleuvait fort, ne distinguait plus le rêve de la réalité et se voyait "noyé dans un lac", "persuadé qu'il était mort lui-même", selon la romancière. Il y eut d'autres hallucinations dans d'autres circonstances, des fantômes qui l'appelaient ou l'étreignaient, la mort qui frappait à sa porte...
Les chercheurs ont relevé des constantes : Chopin se souvenait bien de ses hallucinations, qui arrivaient le plus souvent le soir et coïncidaient parfois avec des infections aiguës et de la fièvre. Visuelles, elles étaient complexes et l'image de la mort revenait souvent.
Ils ont estimé au bout du compte que Chopin souffrait probablement d'une épilepsie, focalisée sur le lobe temporal. Ce type d'épilepsie produit des hallucinations visuelles complexes, ordinairement brèves, fragmentaires et toujours du même ordre, avec parfois des pâleurs et des angoisses, "exactement comme celles dont il dit avoir souffert".












 Le rôle de l’arabe dans la traduction scientifique au cœur d'un colloque international à Rabat
Le rôle de l’arabe dans la traduction scientifique au cœur d'un colloque international à Rabat