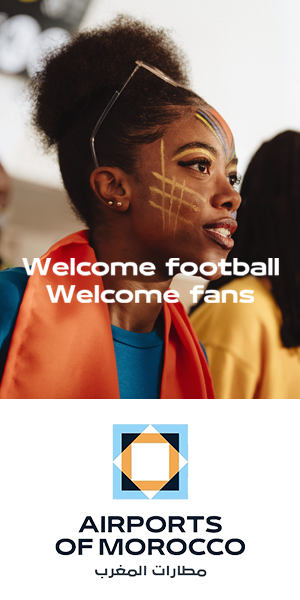-
Le Festival ComediaBlanca embrase l’Olympia : Gad El Maleh en invité de marque
-
A Paris, accord trouvé pour sauvegarder l'appartement du poète Prévert menacé par le Moulin Rouge
-
L’IMA à Paris s’associe à la fête footballistique de la CAN
-
Importance de la digitalisation dans la préservation du patrimoine culturel
Les différences culturelles coexistent en effet dans un rapport de « hiérarchie et de dissymétrie ». Khatibi illustre sa réflexion en partant de l’exemple du Maroc, notamment quant à « sa composition linguistique ». Il y a, d’une part, l’arabe, le berbère, le français et l’espagnol. D’autre part, l’arabe se trouve dans une situation diglossique, à savoir « deux généalogies »: la mémoire écrite et le « récit vocal fondateur ».
Cet aller-retour, ce flux-reflux, met l’écrivain dans un mouvement incessant entre ces langues et cultures. C’est une mise en forme de l’émigré qui met en cause l’identité elle-même de l’écrivain. Pour ou contre ? Identité individuelle ou plurielle ? Entre le fait de se réfugier dans un autre idiome et le fait de résister à diverses pressions (culturelle, linguistique, identitaire, social, etc.), l’écrivain continue de vivre dans un monde identitaire confus en tant qu’« étranger professionnel », selon l’heureuse formule de Khatibi. Mais la question fondamentale qui se pose et s’impose est : comment recueillir cet « étranger professionnel » ? « Comment recevoir l’étranger sans lois d’hospitalité dans sa propre langue d’amour ? Et de toute manière un « étranger est toujours étranger pour l’autre, mais entre eux il y a le tout autre ; le troisième terme, la relation qui les maintient dans leur singularité qui est, d’une manière ou d’une autre, intraduisible » (Ibid, p. 204).
Plusieurs référentiels interagissent dans les textes, notamment ceux de littérature maghrébine d’expression française : linguistique, culturelle, religieuse, sociale, philosophique, etc. Pour gérer ces interférences, l’hypothèse de l’interculturalité s’offre, parfois, comme une fenêtre sur d’autres imaginaires, qui pourraient constituer, cependant, en même temps une menace de l’acte même d’écrire : il y a d’une part la culture de Soi, d’autre part celle de l’Autre, preuve d’un amour bilingue et biculturel. Parfaite situation, bien paradoxale, d’étrangeté mais obligatoire. La tâche de l’écrivain est de réintégrer cette identité collective naissante et de l’homogénéiser sans l’affaiblir, dans un contexte d’écriture marquée par des différences et des forces (culture dominante versus culture dominée). D’où le recours, parfois, au néologisme pour combler le manque expressif ontologique.
Cette situation linguistique labyrinthique et iconographique a pour résultat la naissance des textes hybrides « C’est quoi donc l’interculturalité, comme le mentionne Khatibi, si ce n’est une figure d’étrangeté, de métissage, d’émigration de signes ?
L’interculturel, c’est alors une chance pour produire des différences. Mais comment se redécouvrir devant l’abîme de son identité ? Comment partager un secret avec l’étranger sans pouvoir, sans désirer le rencontrer au plus lointain de lui-même, comme une limite, un trait qui transforme mon identité en devenir ? » (Ibid., p. 13). Dans de telles situations de conflits symboliques, la revendication de Soi se réalise par le repoussement et l’admission de l’Autre pour gérer la différence, en permettant, « l’union dans la séparation, (…) une coexistence dans la différence, (…) un cosmopolitisme dans le particularisme (…) s’accepter et accepter l’Autre dans la mesure où il se reconnait étranger à soi-même et à l’Autre » (M. Lanonde, Autour du roman beur, immigration et identité, 1993, p.41). La vertu de l’interculturel est de faire hiérarchiser toutes ces valeurs et de les inscrire dans un dialogue incessant pour alléger la gravité des différences et de diverses pathologies. L’objectif d’une telle démarche khatibienne est de rechercher du sens commun éclatant des cultures diverses, favoriser le dialogue et le partage des codes sociaux, acquérir une flexibilité cognitive, affective et comportementale, et surtout gérer les conflits faisant état de la confrontation des cultures différentes.
* Enseignant chercheur (FLSH- Béni Mellal)















 Le Festival ComediaBlanca embrase l’Olympia : Gad El Maleh en invité de marque
Le Festival ComediaBlanca embrase l’Olympia : Gad El Maleh en invité de marque