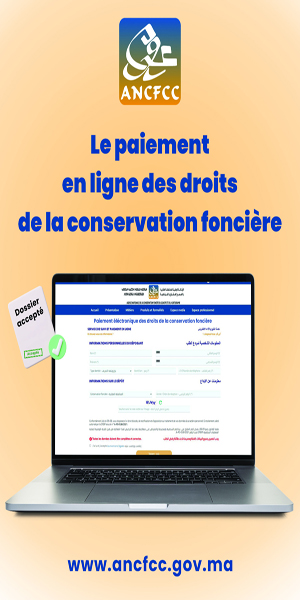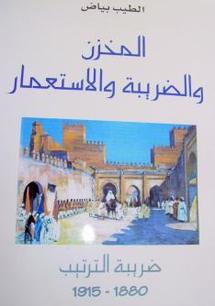
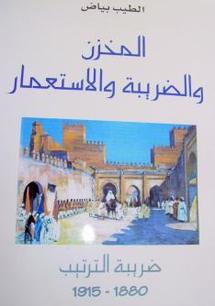
-
Théâtre Riad Sultan de Tanger : Programmation riche et captivante pour le mois de février
-
Mise en avant à Rabat de l'impact socio-économique du Festival "MOGA" sur la ville d'Essaouira
-
Atelier créatif et immersif à Casablanca sous le thème "Histoires berbères"
-
Festival "MOGA" : Un modèle d'événement à fort impact socio-économique sur la ville d'Essaouira
Préfacé par le professeur Mustapha Bouâziz, le nouveau livre de Tayeb Bayyad comprend quatre parties, qui traite successivement de « la campagne marocaine et la structure économique et sociale du Maroc précolonial », « le Makhzen et ses enjeux », « le tertib de Hassan I et l’enjeu de réhabilitation » et enfin « le tertib d’Abdelaziz et l’enjeu de la réforme ».
Le Maroc comptait à l’époque quelque 20 mille protégés. Le Sultan Moulay Hassan, selon l’auteur, a voulu ainsi repenser, en concertation avec les puissances européennes, la nature de l’impôt, pour supprimer le système traditionnel et adopter un système moderne et objectif, ce qu’il avait annoncé lors de la conférence de Madrid en 1880, sous la forme d’un impôt « Tertib ».
La mise en œuvre de la loi régissant cet impôt a rencontré des obstacles, ce qui a fait que le Sultan l’avait remplacé en 1884 par un autre connu pour sa souplesse. Mais, en 1901, le fils de Hassan I, le Sultan Abdelaziz était charmé par le « tertib » et a voulu le revivifier, ce qui a fait que nombre de protégés et de bénéficiaires se sont soulevés contre lui. L’occasion était également propice pour les Français de s’y opposer pour vider les caisses du pays…et partant le pousser à l’endettement. C’est le début d’un processus qui mènera au traité de Fès le 30 mars 1912.
En mars 1915, un dahir sera promulgué régissant et réglementant l’impôt de « tertib », la plus importante source fiscale lors de la période coloniale.












 Théâtre Riad Sultan de Tanger : Programmation riche et captivante pour le mois de février
Théâtre Riad Sultan de Tanger : Programmation riche et captivante pour le mois de février