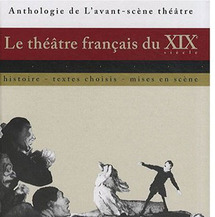
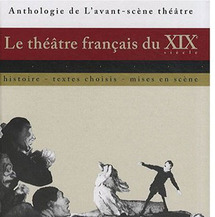
L’ouvrage est divisé en deux grandes parties chronologiques : la première va des décrets impériaux qui fixent le cadre légal de l’institution théâtrale à la Révolution de 1848 qui met fin à certains idéaux romantiques ; la seconde va des modifications du paysage théâtral sous le Seconde Empire jusqu’à 1901, date de publication de « L’Arbre » de Claudel, recueil emblématique d’un tournant esthétique dans l’écriture théâtrale. Au sein de chaque partie, le découpage se fait par genres. Si cette répartition est parfois fatalement un peu réductrice, voire surprenante (Alfred Jarry est placé parmi les grandes figures du symbolisme , et la formule qui sert à expliquer ce choix n’est pas des plus claires ni des plus convaincantes , mais il est vrai que, dans un ouvrage de ce type, il faut toujours placer les inclassables quelque part et après tout, l’important est qu’ils ne passent pas à la trappe ni à la machine à décerveler). Pour chaque genre, une introduction fournit un cadre historique et culturel, et est suivie par l’anthologie proprement dite, textes choisis assortis d’une présentation, d’un bref commentaire et, le cas échéant, si la pièce a donné lieu à une mise en scène récente, de la rubrique "du texte à la scène" où un metteur en scène contemporain donne son point du vue sur le texte. A cela s’ajoutent un dictionnaire des auteurs , un dictionnaire des metteurs en scène , un glossaire théâtral , deux cahiers iconographiques, une bonne bibliographie à la fin des introductions de chaque chapitre ou au sein de celles-ci.
Une envie paradoxale d'exhaustivité
Le choix des textes répond au pari, ambitieux et même paradoxal pour une anthologie, de proposer un aperçu qui soit le plus complet possible : on trouve les extraits de chefs-d’œuvre passés à la postérité (Hugo, Labiche, Feydeau, Claudel...), mais une place importante est réservée aussi aux succès du moment (Eugène Scribe), à des auteurs aujourd’hui inconnus sinon des spécialistes de la période, ainsi qu’à des extraits de pièces d’auteurs plus connus pour leurs romans que pour leur production dramatique (Balzac, Dumas, Zola...), ainsi que des extraits de livrets d’opéras et d’opérettes qui ont rarement leur place dans les anthologies exclusivement littéraires.













 La 3ème édition du Morocco Gaming Expo, du 20 au 24 mai à Rabat
La 3ème édition du Morocco Gaming Expo, du 20 au 24 mai à Rabat



