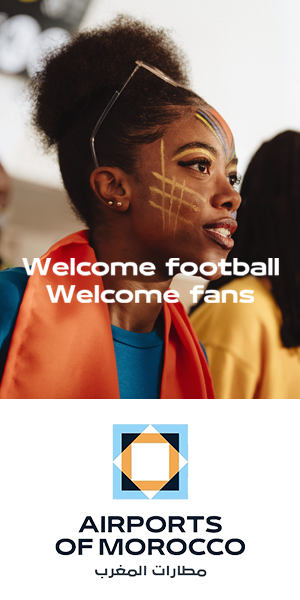-
Ibn Battouta à Quanzhou : Une mémoire gravée dans la pierre
-
Industries culturelles et créatives : Le financement et l’investissement au cœur des débats du FOMICC
-
Ouverture à Rabat de la 3e édition du Forum marocain des industries culturelles et créatives
-
Prix Mohammed VI. Art décoratif marocain sur papier
Pendant vingt ans, j’ai emmené mon père en montagne dans le massif des Ecrins. C’était là sa grande joie. Ma mère choisissait un hôtel confortable et restait à tricoter ou à lire des revues dans le jardin. Et nous partions là-haut parfois à trois si ma compagne du moment aimait les longs efforts vers les sommets. La vigueur de mon père octogénaire capable de dix heures de marche sur des sentiers escarpés me semblait toute naturelle. Il n’allait pas vieillir ni être malade.
Malade, il ne le fut qu’une fois dans sa vie. Il venait de prendre sa retraite, ma sœur s’était établie à Bruxelles, j’enseignais au Nouveau-Mexique, le mauvais temps l’empêchait le plus souvent d’aller dans son jardin et le tête-à-tête jour et nuit avec le «reine-mère» se révéla trop éprouvant. Il contracta une double broncho-pneumonie dans la maison glaciale dont sa femme, par souci d’économie, se refusait toujours à chauffer les étages. Elle se décida enfin à quitter Bruges et à s’établir dans le midi de la France, comme tant de retraités nordiques qui en ont les moyens. Leur installation à Manosque guérit mon père de sa faiblesse pulmonaire. Enfin il avait un jardin au soleil, un grand, un beau, où échapper à la tyrannie de la «reinemère». Ce jardin lui rendait supportable la vie avec une épouse casanière qui n’allait au-delà de la terrasse que pour couper les roses fanées et arroser les fleurs en pot. Ils ont vécu ainsi pendant 30 ans, ensemble pour les repas ou le soir devant la télé à regarder le journal (que des catastrophes partout, ah ! il est beau, le monde actuel !) puis une émission de variétés qui faisait ronfler mon père ou un match de foot qui endormait ma mère.
Après mon petit-déjeuner solitaire, je m’attaque aux placards du couloir. Vider tout le linge de maison, entasser dans des cartons les vêtements innombrables de ma mère et la garde-robe beaucoup plus succincte de mon père. Je m’agite beaucoup, j’ai mis le masque de protection sur mon nez et ma bouche, la poussière me pique quand même les yeux et je transpire abondamment. A dix heures, Liliane téléphone.
Pour s’entendre dire :
- Alors ma vieille, on se la coule douce ? J’ai déjà 5 heures de travaux forcés moi ici.
- S’il te plaît, ne m’agresse pas. Tu sais, c’est dur pour moi aussi. Je n’arrive pas à y aller tous les jours.
- Où ça?
- A l’hôpital gériatrique. C’est abominable. Maman se plaint de tout, veut rentrer chez elle. Papa dit qu’il veut touiller, je trouve qu’il baisse de jour en jour. Et les autres, dans les couloirs, ils me font peur, je fais des cauchemars la nuit. C’est vraiment une maison de fous. Et Maman me dit des horreurs. - Prends de la distance. Ils ne savent plus ce qu’ils disent. Ne reste pas longtemps. Vas y deux ou trois fois par semaine si c’est trop dur pour toi. De toute façon, ils oublient, ils n’ont plus la même notion du temps que nous. Je remplis encore des cartons avec le contenu des armoires, à midi un plat de spaghetti aux poivrons, il fait maintenant trop chaud pour un travail physique, je me consacre pendant deux heures à des problèmes administratifs. Puis, mon masque sur la figure, je vais au garage ouvrir des malles échouées là depuis le déménagement de Bruges et que personne n’a ouvertes depuis. Des chapeaux des années 50, de vieux rideaux, des carpettes usées, des tapisseries passées, des papiers d’emballage, des cadres sans tableau et –moment d’émotion - les jouets antiques de notre enfance. J’entasse le tout dans la voiture dont j’ai retiré les sièges arrière et en route pour la déchetterie, repère de corbeaux croassants. La puanteur y est si persistante que je crois la sentir même après la douche et le savon. Eternuements à répétition, gorge irritée réclamant sans cesse de l’eau, les yeux qui piquent... pour un allergique de toute éternité, peu de chose en somme. Je vais cueillir les mirabelles encore accessibles sans échelle et arroser le jardin. Enfin une tâche agréable. Un moment de paix dans les bonnes odeurs de feuilles et de fleurs. Bientôt ce sera fini, je ne reviendrai plus à Manosque, je ne verrai plus mon père mesurer l’espace entre deux plants de tomate avec une ficelle, creuser symétriquement des petits trous pour y planter les graines. Cet ancien comptable a été un poète géométrique des jardins. Il n’y fallait aucun désordre, aucune mauvaise herbe, qu’il puisse y rêver librement.
Et il n’y fallait nulle chimie. Les fruits et légumes que nous mangions ici n’avaient jamais été traités aux pesticides ni aux engrais polluants. Les mirabelles dégustées, le jardin arrosé, je m’offre le restaurant. Celui où se rendaient mes parents tous les dimanches, à 12 heurs 15 précises. Ma mère se plaignait si souvent de sa condition de femme-esclave obligée de préparer les repas deux fois par jour. Mais elle n’autorisait pas mon père à le faire. Lui était invité à éplucher les légumes, trottiner au jardin pour en ramener les herbes, descendre au garage et en revenir avec les oignons, l’ail ou les fruits. Quand ma mère s’installait pour cuisiner, il attendait ses ordres, mettait la table et réglait la radio pour le «jeu des 1000 francs».
Le dimanche midi donc, ils partaient à pied, ils se donnaient le bras et – ma mère y tenait – ils marchaient au pas. En avant les deux jambes gauches, en avant les deux droites. L’image d’un vrai couple uni sans cahot ni chaos. Ils prenaient toujours le même menu, le même vin. Ces dernières années, la patronne les reconduisait en voiture. Mon père aurait préféré la marche pour une bonne digestion mais il n’allait pas s’opposer à deux maîtresses femmes, l’une soignant ses clients, l’autre ravie de ne pas avoir à faire d’efforts. Installé seul à une table, je commande un menu gastronomique avec une bouteille de Gigondas. A la fin du repas, la patronne viendra évoquer mes parents. – Ils se tenaient si bien, toujours si discrets. Votre père un peu trop silencieux peut-être. Vous dites : 54 ans de mariage ? C’est beau ça. Plus on avance en âge, plus on comprend qu’il n’y a que la famille qui compte, vous ne trouvez pas ? Vous ne pouvez pas savoir ? Ah ! vous n’avez pas d’enfant. Elle s’offre à me raccompagner si je ne suis pas en voiture. Je remercie mais non, ce n’est pas la peine, j’ai besoin d’exercice. Je me lève, le monde chancelle un peu autour de moi. Je marche, alourdi, transpirant dans la chaleur du soir. La patronne ne raccompagne que les clients très âgés (j’ai donc l’air si vieux?). Ou alors les poivrots. Elle a vu que j’avais vidé la bouteille ? Oui, ça doit être ça, je ne suis pas vieux du tout mais j’ai bu un peu plus que de raison. La montée à la colline de Toutes Autres me paraît bien plus raide que d’habitude. Enfin me voilà sur la terrasse de la maison face au clérodendron qui répand son parfum nocturne. Je somnole un peu dans le fauteuil d’osier, me secoue, me lève péniblement et vais chercher dans la bibliothèque en acajou un album de photos. Il s’en échappe un cliché de grand format. Je le ramasse et retourne sur la terrasse, stupéfait de constater que je reconnais tous les élèves de cette classe de 5ème fixés sur la pellicule il y a 50 ans à Bruges.
Je me remémore leurs noms, les copains, les pas-copains et là, mais oui ! c’est ce salaud de Merschout avec ses gros yeux globuleux. Il m’avait traité de lépreux, ayant vu au vestiaire l’eczéma de mes jambes avant le cours de gymnastique. Je lui avais bondi sur le râble avec la ferme intention de le réduire en miettes et seule l’intervention d’autres élèves lui avait sauvé la vie. L’incident, même s’il eut des répercussions dramatiques en moi – je n’oublierai jamais qu’en voyant l’état de ma peau, on pouvait me croire lépreux – demeura pourtant un fait exceptionnel. Aucune femme, désir d’un soir ou liaison durable, ne parut jamais repoussée par mon apparence. La première fois pourtant, au moment crucial où l’on se déshabille après mille peurs et tremblements, je revoyais toujours le visage dégoûté de Merschout – lépreux ! lépreux ! - et prenais grand soin de plonger la chambre dans la pénombre. Alors qu’elles, pleines de délicatesse et de compassion me prodiguaient des conseils cosmétiques et diététiques, exhibaient elles-mêmes à l’occasion une infime dépigmentation, un léger psoriasis, une allergie insignifiante à mes yeux mais qui nous plaçaient sur un plan d’égalité quant à nos complexes.
(A suivre)





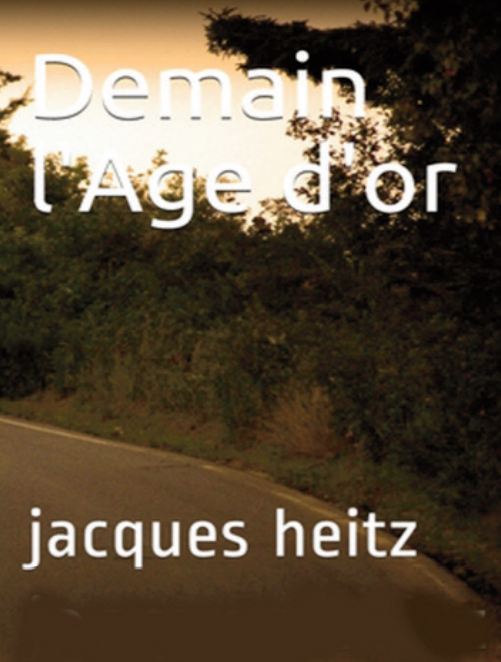









 Ibn Battouta à Quanzhou : Une mémoire gravée dans la pierre
Ibn Battouta à Quanzhou : Une mémoire gravée dans la pierre