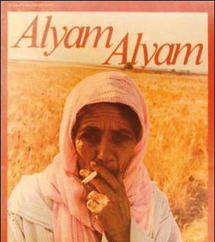
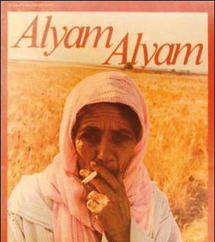
-
Essaouira à l’heure du 4ème Festival international "L'âme des cultures "
-
Enrique Ojeda Vila : Le Maroc et l’Espagne sont liés par des relations culturelles enracinées
-
Théâtre Riad Sultan de Tanger : Programmation riche et captivante pour le mois de février
-
Mise en avant à Rabat de l'impact socio-économique du Festival "MOGA" sur la ville d'Essaouira
Jardins, rues, derbs, riads, hammams, déserts, mosquées, écoles, souks, usines, bureaux, chambres à coucher, salles de torture, prisons, salles de fête, commissariats, Paris, New York, Le Caire…Le cinéma marocain ne cesse d’explorer une diversité spatiale très riche qui dévoile à juste titre une culture métissée capable de faire cohabiter tradition et modernité, Orient et Occident, soufisme et rationalité, intériorité et extériorité…A travers l’espace filmique, les Marocains tentent de se réapproprier leur imaginaire et de réinvestir leur propre mémoire territoriale. La conquête de l’espace fictif est devenu un enjeu considérable pour maîtriser sa propre temporalité, sa propre histoire, son propre devenir.
Evolution
du regard
La structuration de l’espace imaginaire n’ a pas toujours été identique tout au long des 50 ans du cinéma marocain. D’une géographie restreinte, close, endogène, chevillée à la platitude du réel urbain ou rural (Wechma de Bennani…) on est passé aujourd’hui à une représentation topologique plus élargie, plus ouverte sur le monde et sur l’altérité ( « Le grand voyage » de Faroukhi, « Islamour » de Chraibi, « Lola »de Ayouch…).
L’actuel cinéma marocain ne s’enlise plus dans un espace unique, fétichisé et traversé de stéréotypes figés, mais s’ouvre sur une pluralité des regards et une multiplicité des géographies. Le récit et les cadrages transcendent les frontières de l’imaginaire filmique traditionnel, décrivent une territorialité qui, somme toute, constitue une extension du corps, un prolongement de l’individu.
Même le dispositif cinématographique en est modifié. Le cadrage, le son, le montage, la projection dans les salles mettent en valeur une esthétique nouvelle du plan général, du très gros plan, du travelling, de la stéréophonie multicanale, du hors-champ.
Il est vrai que, depuis « Le fils maudit » jusqu’à « Islamour », la conception de la spatialité dans le cinéma marocain a toujours oscillé entre la réalité documentaire du film-témoin et la vérité de la cohérence narrative du film-modalisation, entre les stéréotypes de l’espace, hérités d’une tectonique des imaginaires et l’invention d’une topologie originale plus universelle. Mais, force est de constater que cette configuration de l’espace n’a pas encore osé explorer les méandres souterrains de l’espace fantastique et merveilleux incrustés dans l’imaginaire archétypique des Marocains, ni les interstices insondables de l’univers onirique et individuel, ni les contrées lointaines, très lointaines comme la Chine, la Russie, l’Amérique latine. La caméra marocaine et les scénaristes marocains s’interdisent encore l’aventure dans l’intimité géographique du Maroc et dans les cosmogonies et les mythologies universelles. Exception faite, bien entendu, de « Al Hal » et « Alyam Alayam » de Maânouni qui, de par les jeux mystiques de la caméra et de par les transes des sons et du montage, se sont faufilés dans les entrailles gnaouies de la mémoire marocaine.
Mais le fait marquant de cette évolution du regard filmique marocain, c’est bel et bien ce passage, ce basculement d’une dramaturgie qui sépare l’espace des personnages et du récit (dans le cinéma des années 70, l’espace est secondaire et n’a qu’une fonction d’ancrage topologique) à une dramaturgie plus moderne où s’opère une osmose entre les trois composantes : récit, espace, personnage.
C’est justement à ce propos qu’il est possible de dégager trois périodes de la figuration de l’espace dans le cinéma marocain : la première s’étend jusqu’aux années 80 où l’espace est généralement clos, endogène, terrestre, chtonien, simple décor où évoluent les personnages, saturé de symboles, statique du fait de la rareté des mouvements de caméra et de la carence en fragmentation du regard, et proche de la représentation théâtrale. D’ailleurs, l’indication spatiale est presque absente des titres des films de cette période. La deuxième s’étend jusqu’à l’an 2000 où l’espace est forcément interculturel (Orient/Occident), ouvert sur la proximité géographique et historique (France, Espagne, Algérie…), explorateur d’espace révolu de l’Antiquité…Mais, on déplore que, durant cette période, le cinéma marocain s’est embourbé dans les clichés de la bipolarité primaire et manichéenne (identité/altérité, ici/là-bas, urbain/rural, espace féminin/espace masculin, bien/ mal, clos/ ouvert, sacré/profane…). Et, la troisième étape est beaucoup plus mûre en matière de traitement de l’espace, tant au niveau de la dramaturgie qu’au niveau de la mise en scène et du jeu des acteurs. L’espace y est le lieu d’une configuration nouvelle, d’une plastique inédite et d’une métaphorisation polysémique et créatrice. Les personnages se meuvent au-delà de l’Europe, de l’Afrique. Le cadre et le paysage n’ont plus de centre figé et immuable. Les 90 mn du film montrent une variété des espaces et des lieux, une décentralisation de la parole et de l’image ; et la mise en scène n’est pas en reste : cadrage, lumière, montage, bruitage constituent de véritables ingrédients pour une stylistique de l’espace raffinée et inédite dans l’histoire du Maroc. Et c’est ici qu’on assiste à une véritable mixité du regard cinématographe marocain, à une synthèse de plusieurs regards et pas une juxtaposition naïve de points de vue. De plus, l’espace n’est plus transparent ni décoratif, mais plutôt énigmatique, opaque et mystérieusement polysémique.
Une esthétique
du paysage
Décidément, c’est vrai : une belle image n’est pas celle qui comporte une jolie fille ou un beau paysage, mais plutôt celle qui révèle une belle composition et une harmonie originale des formes et des couleurs. La poétique de l’espace est une affaire de géométrie, de couleurs et d’alchimie visuelle.
Cette lapalissade est valable pour deux cinéastes marocains qui ont su se singulariser par leur traitement esthétique de l’espace : Daoud Oulad Sayed et Faouzi Bensaidi qui, dans leur quête du plan pur, ont su, mieux que d’autres, créer de beaux cadrages où l’harmonie naît de la rencontre entre les lignes géométriques, les couleurs, les mouvements des personnages, l’angle de prise de vue, la thématique et le point de vue. Dans « Tarfaya » aussi bien que dans « Mille mois », chaque plan est un objet de désir et de contemplation, chaque paysage est un lieu d’une mystique savamment racontée. Tout est calculé au millimètre près. L’espace n’est pas un simple décor, (ancrage du récit) ni un ornement touristique, mais un personnage qui modèle, structure, agit et réagit, séduit et entre en concurrence avec les acteurs et le récit. La caméra de Daoud et de Faouzi n’enregistre jamais le réel, mais crée sa propre réalité onirique singulière et hautement plastique, modèle sa propre spatialité sensuelle, matérielle, onirique et inquisitrice. Dans le même ordre d’idées, il existe un cinéaste qui intrigue aussi par son traitement original de l’espace : c’est Jilali Ferhati. « La plage des enfants perdus », « La mémoire en détention », « Tresses » expriment, mieux que d’autres , ce paradoxe que ressent tout Marocain entre liberté et prison, enfermement et ouverture. Et la géographie est le lieu même ou s’intensifie cette double sensation. L’esthétique de l’espace est au service d’une profonde expression du mal-être et d’une constante instabilité du regard et de l’identité. Espace narrativisé et narration spatialisée, tel est le pari réussi du mystérieux moine du cinéma marocain : J.Ferhati.
Il va sans dire que beaucoup de films marocains (d’auteur ou populaires) restent trop classiques dans leur traitement de l’espace et trop soumis à une bipolarisation manichéenne. La lisibilité de la topologie est fonction des indices visuels et sonores permettant de situer le lieu de l’action : titres, cadrage large sur un monument, accent régional, musique ou instrument locaux. L’espace est explicitement montré ou dit et rarement suggéré ou évoqué de manière subtile. Quant aux fonctions dramaturgiques et symboliques de l’espace, dans ce type de cinéma, elles se limitent généralement à l’ancrage géographique,à l’ornement touristique,aux allusions symboliques classiques et aux valeurs nostalgiques.
Le territoire des personnages est souvent soumis à une vision tridimensionnelle où s’instaure la rivalité entre trois espaces : celui de l’individu, celui de la famille, celui de la tribu. Rare est donc le territoire de l’universel. Dire que le cinéma marocain peine à aspirer à la mondialité. D’un autre point de vue, dans le cinéma populaire marocain, les itinéraires et les errances des personnages sont prévisibles et ordinaires : du Sud vers le Nord ou inversement, de l’Est vers l’Ouest ou inversement, de la campagne à la ville, des lieux dysphoriques vers des lieux euphoriques, de la laïcité vers la mystique ou inversement, de l’espace présent vers le passé…Les déplacements des personnages ne sont pas écrits à partir d’une esthétique nouvelle, profondément marocaine. De plus, il n’existe aucune innovation dans le traitement des distances proxémiques entre les personnages : les codes de la proxémique occidentale et marocaine prévalent partout.
Perspectives…
Aujourd’hui, le cinéma nous permet de nous interroger sur la condition humaine et sur celle des peuples. D’où venons-nous ? Où allons-nous ? Là-bas est-il mieux qu’ici ? Là-bas m’est-il vraiment inconnu ? Par le jeu de l’image et des sons, le cinéma marocain a su poser, à sa manière, des questions actuelles sur notre rapport aux territoires de l’identité et de l’altérité et a su contribuer à l’appropriation et à l’apprivoisement de notre propre espace. Il participe également à façonner notre représentation de la géographie nationale et mondiale. C’est peut-être là sa vocation première. Certes, les problèmes d’esthétique restent minoritaires et rares, mais la part de la dramaturgie prend de plus en plus d’ampleur dans le traitement des lieux et dans l’écriture des topologies.
La censure et l’auto-censure (éthique, idéologique et économique) ont privé le Maroc d’espaces imaginaires endogènes et exogènes d’une valeur inestimable et historique, comme ils ont privé de nombreux Marocains de voir leur propre espace fabriqué par leurs propres enfants. Le cinéma marocain s’est malheureusement interdit d’explorer de nombreux espaces intimes, religieux, laïques et fantastiques. La caméra marocaine a toujours été intimidée par la fulgurance et la béance d’une géographie complexe, multiforme, fragmentée et protéiforme. Or, nul ne peut disconvenir qu’aujourd’hui, les géographies imaginaires sont devenues, dans ce contexte de pensée unique et mondialisée, de réels enjeux identitaires, politiques, culturels et existentiels. De nos jours, se réapproprier son espace imaginaire est la seule voie envisageable pour reconquérir son territoire réel et pour dialoguer avec les autres mondes possibles.
* Université Cadi Ayyad
Marrakech












 Essaouira à l’heure du 4ème Festival international "L'âme des cultures "
Essaouira à l’heure du 4ème Festival international "L'âme des cultures "


