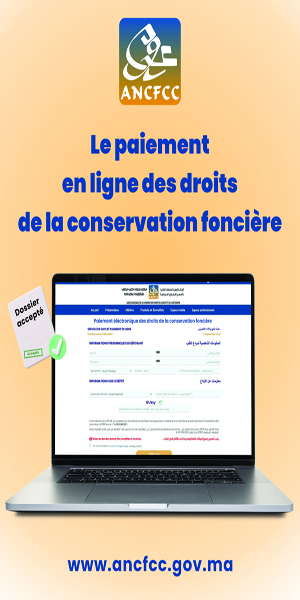Avec Eddington, Ari Aster signe son film le plus politique et peut-être son plus subversif. On connaissait le cinéaste pour son exploration des dynamiques familiales pathologiques (Hérédité), de la psyché amoureuse dévorée par la dépendance (Midsommar) ou encore du trauma existentiel dans Beau is Afraid. Ici, il change de registre apparent : il filme l’Amérique au temps du Covid, mais ce cadre sanitaire n’est qu’un prétexte. Ce qui l’intéresse, c’est de disséquer les fractures idéologiques, les illusions politiques, l’emprise des réseaux sociaux et la montée de la folie collective.
Eddington est moins un récit sur une petite ville américaine qu’un miroir tendu à toute une nation, une miniature où chaque personnage condense une facette de l’Amérique contemporaine.
Le spectateur est d’abord frappé par la richesse et la justesse des acteurs. Joaquin Phoenix, qui incarne le shérif Joe Cross, livre une performance complexe : il est tour à tour protecteur, vulnérable, paranoïaque et charismatique. Pedro Pascal, en maire Ted Garcia, incarne l’autre face du miroir : lisse, rassurant, progressiste de façade, mais vidé de toute profondeur. Les deux figures s’opposent mais finissent par se ressembler : ce sont des hommes pris au piège des symboles instrumentalisés.
Phoenix, avec son intensité quasi shakespearienne, impressionne par sa capacité à rendre tangible la fragilité mentale d’un homme en décalage avec son époque. Pascal, plus discret, joue volontairement la transparence d’un élu local qui n’est qu’un relais d’intérêts supérieurs. Leur contraste met en lumière le cœur du film : le pouvoir politique n’existe plus que comme une mise en scène.
La construction psychologique de Joe Cross est particulièrement fascinante. C’est un homme de devoir, un shérif qui croit encore à sa mission de maintenir la cohésion d’une communauté. Il protège les marginaux, défend un citoyen anti-masque, un SDF agressif, il tente de contenir la violence des militants et de calmer les tensions raciales. Mais cette posture héroïque se fissure. Derrière le protecteur se cache un homme usé, isolé, dont la famille est dysfonctionnelle et gangrenée par le complotisme. Comme beaucoup d’Américains perdus dans la confusion du Covid, Joe se sent abandonné par l’État, trahi par les élites, et cherche dans une position populiste une manière de retrouver du contrôle. Sa dérive psychologique est progressive : d’abord médiateur, il glisse peu à peu dans la paranoïa, absorbe les délires des réseaux sociaux, projette ses angoisses sur un ennemi extérieur. Lorsqu’il se lance dans une candidature populiste contre le maire, il n’est pas cynique comme un politicien professionnel, il croit sincèrement incarner une alternative. Mais ce qui le rend attachant devient aussi ce qui le condamne : il n’a pas la lucidité nécessaire pour voir qu’il est lui-même avalé par le chaos. Sa chute est celle d’un idéaliste brisé, qui voulait sauver mais qui divise, qui voulait protéger mais qui enferme.
En contrepoint, Louise, son épouse (Emma Stone), offre un autre visage de la fragilité américaine. Traumatisée, solitaire, enfermée dans son art-thérapie, elle fabrique des poupées qui sont les doubles silencieux de sa détresse. Sa relation avec Joe est minée par le mutisme et par la présence empoisonnante de sa mère, complotiste forcenée. Louise incarne cette génération de femmes happées par la quête de sens et qui, faute de repères, tombent sous l’influence de figures charismatiques. Sa fuite avec Vernon Jefferson Peak, incarné par Austin Butler, est l’une des lignes les plus percutantes du film. Vernon est un "gourou moderne", coach en mémoire et thérapeute autoproclamé, mélange de new age, de discours woke et d’anarchisme chic. Il séduit par son charisme, son langage pseudo-pacifiste, sa critique de la société de consommation. Mais Ari Aster le montre comme l’archétype des nouvelles sectes contemporaines : derrière le discours progressiste, ce sont les mêmes mécanismes de manipulation que chez les Raëliens ou Osho. Isolement des adeptes, dépendance psychologique, culte de la personnalité, enfermement mental : la façade a changé, les rouages demeurent. Louise, en rejoignant Vernon, n’échappe pas au carcan patriarcal ou institutionnel : elle se soumet simplement à un nouveau pouvoir, plus séduisant, plus moderne, mais tout aussi destructeur.
La dimension politique du film se cristallise dans le personnage de Ted Garcia, le maire interprété par Pedro Pascal. Garcia coche toutes les cases du progressiste modèle : issu de la diversité, covidiste convaincu, ami des big business et chantre de la transition énergétique. Mais cette transition, faite de panneaux solaires, d’éoliennes et de data centers, est présentée pour ce qu’elle est : une vitrine. Aster dénonce l’hypocrisie d’une écologie capitaliste qui se veut verte mais repose sur le bétonnage, la destruction des paysages et la mainmise des géants technologiques. Ted Garcia n’est pas un leader : il est un pantin qui applique des directives, une marionnette politique dont la fonction est d’habiller de beaux discours des projets décidés par d’autres. Sa vacuité psychologique est volontaire : Aster le vide de substance pour le réduire à ce qu’il est, un rouage interchangeable.
Ce dévoilement culmine dans le portrait des véritables maîtres du jeu : les magnats, investisseurs, entrepreneurs richissimes qui prospèrent dans l’ombre. Ce sont eux qui financent, qui orchestrent, qui profitent du chaos social. Pendant que Joe et Ted se déchirent, que les habitants sombrent dans la haine, que les réseaux sociaux exacerbent les divisions, eux avancent leurs pions. Aster est limpide : la guerre civile larvée ne profite qu’aux entrepreneurs de haine et aux big business. Les populistes comme les progressistes, les MAGA comme les BLM, tous finissent instrumentalisés. La fin, avec l’émergence d’un "faux héros" supposé apporter la paix, enfonce le clou : il ne s’agit que d’un nouveau visage, une nouvelle marionnette pour prolonger la domination. Rien ne change, les pantins se succèdent, les magnats demeurent.
La dimension écologique traverse le film comme un fil rouge. Elle est moins frontale que dans un documentaire militant, mais elle est d’autant plus percutante : Aster montre comment la rhétorique verte sert de paravent à la prédation capitaliste. Les projets énergétiques, présentés comme la modernité salvatrice, ne sont que des instruments d’accumulation, sans considération pour la nature ou la vie des habitants. Le climat, la santé, l’équilibre social ne sont que des variables dans un système dominé par le profit. Là encore, les politiciens sont des marionnettes, et la démocratie n’est qu’un théâtre d’ombres.
Eddington est donc à la fois un récit psychologique, une satire politique et une méditation philosophique. Psychologiquement, il explore les failles des individus : Joe le shérif populiste malgré lui, Louise la femme en quête de sens happée par une secte, Ted Garcia le maire creux, Vernon le gourou manipulateur. Politiquement, il renvoie dos à dos démocrates et républicains, progressistes et populistes, en montrant qu’aucun camp n’échappe à la manipulation des puissances économiques.
Philosophique enfin, il propose une lecture désespérante mais lucide : le chaos n’est pas une dérive, c’est un mode de gouvernement. Diviser pour mieux régner, saturer l’espace public de discours contradictoires, livrer les individus à la folie des réseaux sociaux, pendant que les véritables maîtres accumulent les profits.
On comprend mieux pourquoi le film a été accueilli avec autant de crispations. Une partie de la critique l’a jugé excessif, moralisateur, trop noir. Cannes ne lui a rien décerné, signe que ce genre de réquisitoire radical ne plaît pas aux cercles bien-pensants. D’autres y ont vu au contraire une œuvre salutaire, un miroir tendu à l’Amérique contemporaine. Ce qui est certain, c’est que Eddington ne laisse pas indifférent. Sa force est d’embrasser le désordre, de filmer la folie et le grotesque avec un mélange de gravité et de sarcasme, et de faire du Covid non pas une simple crise sanitaire, mais le révélateur d’une société entière en décomposition.
En définitive, Eddington est un réquisitoire contre l’Amérique moderne : ses élites politiques réduites au rôle de pantins, ses habitants enfermés dans la paranoïa et le besoin de croire, ses magnats qui prospèrent sur la destruction écologique et sociale. Ari Aster n’offre aucune consolation, aucune rédemption. Il ne propose pas d’issue : seulement le constat que la démocratie américaine est gouvernée par le chaos, et que ce chaos sert parfaitement ceux qui en tirent profit.
Par Salaheddine Lalouani
Eddington est moins un récit sur une petite ville américaine qu’un miroir tendu à toute une nation, une miniature où chaque personnage condense une facette de l’Amérique contemporaine.
Le spectateur est d’abord frappé par la richesse et la justesse des acteurs. Joaquin Phoenix, qui incarne le shérif Joe Cross, livre une performance complexe : il est tour à tour protecteur, vulnérable, paranoïaque et charismatique. Pedro Pascal, en maire Ted Garcia, incarne l’autre face du miroir : lisse, rassurant, progressiste de façade, mais vidé de toute profondeur. Les deux figures s’opposent mais finissent par se ressembler : ce sont des hommes pris au piège des symboles instrumentalisés.
Phoenix, avec son intensité quasi shakespearienne, impressionne par sa capacité à rendre tangible la fragilité mentale d’un homme en décalage avec son époque. Pascal, plus discret, joue volontairement la transparence d’un élu local qui n’est qu’un relais d’intérêts supérieurs. Leur contraste met en lumière le cœur du film : le pouvoir politique n’existe plus que comme une mise en scène.
La construction psychologique de Joe Cross est particulièrement fascinante. C’est un homme de devoir, un shérif qui croit encore à sa mission de maintenir la cohésion d’une communauté. Il protège les marginaux, défend un citoyen anti-masque, un SDF agressif, il tente de contenir la violence des militants et de calmer les tensions raciales. Mais cette posture héroïque se fissure. Derrière le protecteur se cache un homme usé, isolé, dont la famille est dysfonctionnelle et gangrenée par le complotisme. Comme beaucoup d’Américains perdus dans la confusion du Covid, Joe se sent abandonné par l’État, trahi par les élites, et cherche dans une position populiste une manière de retrouver du contrôle. Sa dérive psychologique est progressive : d’abord médiateur, il glisse peu à peu dans la paranoïa, absorbe les délires des réseaux sociaux, projette ses angoisses sur un ennemi extérieur. Lorsqu’il se lance dans une candidature populiste contre le maire, il n’est pas cynique comme un politicien professionnel, il croit sincèrement incarner une alternative. Mais ce qui le rend attachant devient aussi ce qui le condamne : il n’a pas la lucidité nécessaire pour voir qu’il est lui-même avalé par le chaos. Sa chute est celle d’un idéaliste brisé, qui voulait sauver mais qui divise, qui voulait protéger mais qui enferme.
En contrepoint, Louise, son épouse (Emma Stone), offre un autre visage de la fragilité américaine. Traumatisée, solitaire, enfermée dans son art-thérapie, elle fabrique des poupées qui sont les doubles silencieux de sa détresse. Sa relation avec Joe est minée par le mutisme et par la présence empoisonnante de sa mère, complotiste forcenée. Louise incarne cette génération de femmes happées par la quête de sens et qui, faute de repères, tombent sous l’influence de figures charismatiques. Sa fuite avec Vernon Jefferson Peak, incarné par Austin Butler, est l’une des lignes les plus percutantes du film. Vernon est un "gourou moderne", coach en mémoire et thérapeute autoproclamé, mélange de new age, de discours woke et d’anarchisme chic. Il séduit par son charisme, son langage pseudo-pacifiste, sa critique de la société de consommation. Mais Ari Aster le montre comme l’archétype des nouvelles sectes contemporaines : derrière le discours progressiste, ce sont les mêmes mécanismes de manipulation que chez les Raëliens ou Osho. Isolement des adeptes, dépendance psychologique, culte de la personnalité, enfermement mental : la façade a changé, les rouages demeurent. Louise, en rejoignant Vernon, n’échappe pas au carcan patriarcal ou institutionnel : elle se soumet simplement à un nouveau pouvoir, plus séduisant, plus moderne, mais tout aussi destructeur.
La dimension politique du film se cristallise dans le personnage de Ted Garcia, le maire interprété par Pedro Pascal. Garcia coche toutes les cases du progressiste modèle : issu de la diversité, covidiste convaincu, ami des big business et chantre de la transition énergétique. Mais cette transition, faite de panneaux solaires, d’éoliennes et de data centers, est présentée pour ce qu’elle est : une vitrine. Aster dénonce l’hypocrisie d’une écologie capitaliste qui se veut verte mais repose sur le bétonnage, la destruction des paysages et la mainmise des géants technologiques. Ted Garcia n’est pas un leader : il est un pantin qui applique des directives, une marionnette politique dont la fonction est d’habiller de beaux discours des projets décidés par d’autres. Sa vacuité psychologique est volontaire : Aster le vide de substance pour le réduire à ce qu’il est, un rouage interchangeable.
Ce dévoilement culmine dans le portrait des véritables maîtres du jeu : les magnats, investisseurs, entrepreneurs richissimes qui prospèrent dans l’ombre. Ce sont eux qui financent, qui orchestrent, qui profitent du chaos social. Pendant que Joe et Ted se déchirent, que les habitants sombrent dans la haine, que les réseaux sociaux exacerbent les divisions, eux avancent leurs pions. Aster est limpide : la guerre civile larvée ne profite qu’aux entrepreneurs de haine et aux big business. Les populistes comme les progressistes, les MAGA comme les BLM, tous finissent instrumentalisés. La fin, avec l’émergence d’un "faux héros" supposé apporter la paix, enfonce le clou : il ne s’agit que d’un nouveau visage, une nouvelle marionnette pour prolonger la domination. Rien ne change, les pantins se succèdent, les magnats demeurent.
La dimension écologique traverse le film comme un fil rouge. Elle est moins frontale que dans un documentaire militant, mais elle est d’autant plus percutante : Aster montre comment la rhétorique verte sert de paravent à la prédation capitaliste. Les projets énergétiques, présentés comme la modernité salvatrice, ne sont que des instruments d’accumulation, sans considération pour la nature ou la vie des habitants. Le climat, la santé, l’équilibre social ne sont que des variables dans un système dominé par le profit. Là encore, les politiciens sont des marionnettes, et la démocratie n’est qu’un théâtre d’ombres.
Eddington est donc à la fois un récit psychologique, une satire politique et une méditation philosophique. Psychologiquement, il explore les failles des individus : Joe le shérif populiste malgré lui, Louise la femme en quête de sens happée par une secte, Ted Garcia le maire creux, Vernon le gourou manipulateur. Politiquement, il renvoie dos à dos démocrates et républicains, progressistes et populistes, en montrant qu’aucun camp n’échappe à la manipulation des puissances économiques.
Philosophique enfin, il propose une lecture désespérante mais lucide : le chaos n’est pas une dérive, c’est un mode de gouvernement. Diviser pour mieux régner, saturer l’espace public de discours contradictoires, livrer les individus à la folie des réseaux sociaux, pendant que les véritables maîtres accumulent les profits.
On comprend mieux pourquoi le film a été accueilli avec autant de crispations. Une partie de la critique l’a jugé excessif, moralisateur, trop noir. Cannes ne lui a rien décerné, signe que ce genre de réquisitoire radical ne plaît pas aux cercles bien-pensants. D’autres y ont vu au contraire une œuvre salutaire, un miroir tendu à l’Amérique contemporaine. Ce qui est certain, c’est que Eddington ne laisse pas indifférent. Sa force est d’embrasser le désordre, de filmer la folie et le grotesque avec un mélange de gravité et de sarcasme, et de faire du Covid non pas une simple crise sanitaire, mais le révélateur d’une société entière en décomposition.
En définitive, Eddington est un réquisitoire contre l’Amérique moderne : ses élites politiques réduites au rôle de pantins, ses habitants enfermés dans la paranoïa et le besoin de croire, ses magnats qui prospèrent sur la destruction écologique et sociale. Ari Aster n’offre aucune consolation, aucune rédemption. Il ne propose pas d’issue : seulement le constat que la démocratie américaine est gouvernée par le chaos, et que ce chaos sert parfaitement ceux qui en tirent profit.
Par Salaheddine Lalouani













 Le Maroc pays à l'honneur de l'EFM
Le Maroc pays à l'honneur de l'EFM