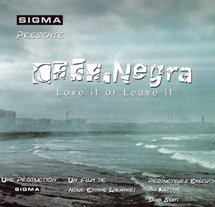
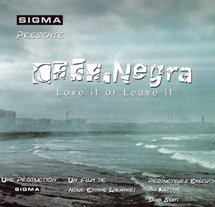
-
Rencontre sur "La langue arabe et les défis de la numérisation"
-
Samir Addahre : Le caftan, un marqueur fondamental de l'identité culturelle marocaine
-
Langues et savoirs : Entre hégémonie linguistique et diversité cognitive
-
Mise en exergue de la splendeur de l’écriture des Sultans du Maroc et ses fonctions civilisationnelles
Tout semble indiquer qu’avec Casanegra, c’est chose faite. Lakhmari a déjà réussi ce premier pari, celui de se réconcilier avec le club de ses fans des années 90. Ils ont retrouvé dans ce deuxième long métrage un rythme, une fougue, un désir de cinéma qui rappellent Brèves notes et Le livreur de journaux. Casanegra peut en effet être abordé d’abord dans cette perspective, celle de l’évolution d’une carrière en regard avec l’accumulation intervenue, entre-temps, dans le champ cinématographique marocain. Et à ce titre, le film est un indicateur éloquent. A l’image de la réception médiatique des premiers courts, le film a généré une sorte d’inflation discursive illustrée par les prix de la presse et de la critique à Tanger; par l’enthousiasme accompagnant la soirée de l’avant première à Casablanca où pas moins de trois salles ont été mobilisées pour une soirée de lancement; par un discours d’escorte dont la figure emblématique pourrait être l’intervention du directeur d’un magazine hebdomadaire parlant, à propos de Casanegra, carrément d’un “tournant” dans le parcours du cinéma marocain; même si l’idée du tournant est toujours à double sens…c’est pour dire que le film crée déjà un débat. Et il est utile de lui offrir des références théoriques. Car au sein de cette cacophonie médiatique, des aberrations sont souvent véhiculées au détriment de la nature réelle du film.
Le film s’ouvre déjà par un titre programme: Casanegra. Dans l’imaginaire collectif marocain, il renvoie à l’image de Casablanca, la ville des villes, celle qui a longtemps cristallisé tous les rêves et toutes les illusions. Ville moderne, elle a assuré pendant longtemps une sorte d’ascenseur social pour les couches successives d’immigrés de l’intérieur. Au cinéma, Casablanca a joué comme figure d’ancrage de sujet clivé, quittant un milieu hostile et frustrant pour trouver refuge dans ce qui était appelé intimement “l’bouida” (la petite blanche): je rappelle à ce propos que le premier personnage dramatique du premier film officiel marocain, Vaincre pour vivre (1968) quitte son village natal pour réussir dans le domaine de la chanson à Casablanca… Abdelouahed, le héros “réel” de O les jours ne rêve que de Casablanca… une ville-mère/mirage qui se révélera ogresse pour Abika, personnage mythique interprété par Habachi dans Les Cendres du clos, arrivant à Casablanca où il se fait subtiliser portefeuille et âme… C’est dans cette suite que peut se lire le scénario de Casanegra… Des jeunes, mais déjà vieux de soucis du film de Lakhmari. La ville n’a plus cette blancheur de l’espoir; elle est devenue Casanegra, la maison noire ; elle n’est plus cet horizon vers lequel regardent les ambitieux; elle est cet enfer nocturne que la jeunesse veut déserter pour d’autres cieux qui s’appellent cette fois Malmoe ou la Norvège (clin d’œil du film à la biographie du cinéaste!). Adil et Karim (magnifique trouvaille du casting) sont les protagonistes d’une dramaturgie urbaine. Ils font partie d’un système qui les intègre et les broie. Mais ils résistent à leur manière, par le rêve; le rêve de partir vers un ailleurs…un ailleurs géographique pour Adil ou un ailleurs social et sentimental pour l’élégant Karim. Des personnages conformes au schéma narratif dominant du cinéma marocain qui repose sur le paradigme du sujet clivé, en rupture avec son espace et dont le programme consiste à passer d’une exclusion à une intégration. Casanegra est le récit de cette recherche d’intégration dans l’enfer de la violence urbaine; violence physique et symbolique. En fait Adil et Karim même s’ils évoluent dans des structures (famille, quartier, réseau…), vont se révéler très vite comme des êtres condamnés à la solitude. Car en fin de compte, ce sont des romantiques qui s’ignorent ou qui se cachent (l’épisode du cheval renvoyant à celui de la tortue): ce sont des espèces écrasées par le système. D’un point de vue cinéphilique, ce sont des enfants du cinéma de Martin Scorsese (Taxi Driver et After hours) et de Michael Mann (Collateral)…des êtres qui n’arrêtent pas de se mouvoir; ce n’est pas un hasard si le film s’ouvre sur leur course désespérée…métaphoriquement c’est une course sisyphienne. Une course forcée les conduisant à l’enfermement, à la claustrophobie. Car on n’échappe pas à la ville, à Casanegra: plus on fuit, plus les pièges urbains se referment sur vous…
Le film pourrait-il pour autant être taxé de “réaliste” ? L’affirmer est une aberration théorique. Le film se réclame d’une esthétique aux antipodes du réalisme. C’est une écriture justement qui tente de contourner l’essoufflement du récit réaliste par des emprunts à l’esthétique de la publicité et de la production des images modernes. La ville est filmée comme un faisceau de signes qui mobilisent tous les sens (importance de la bande son), relevant du courant de l’expressionnisme qui fait de la ville non plus un décor mais un actant dynamique avec ses ombres et lumières, ses lignes et ses formes.













 Rencontre sur "La langue arabe et les défis de la numérisation"
Rencontre sur "La langue arabe et les défis de la numérisation"


