
Former une équipe de changement, ce n’est pas une formalité organisationnelle, c’est un acte fondateur. C’est là que tout commence, dans le feu discret des alliances humaines, dans la rencontre entre des volontés qui vibrent à la même fréquence. Les grandes transformations ne naissent jamais d’un plan figé, mais d’une alchimie entre des êtres animés d’une même ardeur. Jim Collins l’a si bien rappelé : « Les dirigeants qui ont mené leurs organisations de Good to Great n’ont pas commencé par décider où conduire le bus, ils ont d’abord choisi qui y monterait ». Avant la direction, il y a la communion. Avant la vision, il y a la cohésion. Car une grande vision sans grandes personnes n’est qu’une idée sans souffle, un feu sans oxygène.
L’assabiyya. Une énergie de cohésion qui précède l’ordre et la loi
Dans Al-Muqaddima, Ibn Khaldoun scrute les entrailles du pouvoir et découvre qu’aucune grandeur humaine ne tient sans une force invisible : l’assabiyya. Une énergie de cohésion qui précède l’ordre et la loi, une fidélité réciproque tissée dans le sang, dans l’épreuve, dans la mémoire des alliances. Ce n’est pas une théorie abstraite, mais une expérience vécue : celle d’hommes qui se défendent, se soutiennent et s’unissent jusqu’à devenir un seul corps.
Une fraternité en mouvement, un souffle collectif qui donne au groupe la puissance d’un organisme vivant. Ibn Khaldoun voyait là le secret des civilisations : cette assabiyya est la racine de toute conquête et la sève de toute durée. Sans elle, la société s’effondre, se dissout dans le confort et la vanité. Avec elle, les peuples endurcis du désert, pauvres en biens mais riches en liens, renversent les royaumes repus, dont l’âme s’est éteinte dans la mollesse. Ainsi se joue le cycle de l’histoire : la solidarité engendre la puissance, la puissance engendre la décadence, et la décadence appelle une nouvelle assabiyya pour réanimer le monde.
Ce que les penseurs modernes nommeront plus tard capital social n’est, au fond, que la résonance de cette même intuition. Sous des habits savants, il s’agit toujours de cette force subtile qui circule entre les êtres et qui rend l’action collective possible. La confiance, la loyauté, le sentiment d’appartenance, la finalité partagée, autant de formes contemporaines de cette énergie collective dont Ibn Khaldoun fut le premier cartographe.
Le capital social est est la forme moderne d’une sagesse ancienne. Celle qui nous rappelle que le destin des organisations, des nations, comme des empires, ne se joue ni dans les chiffres ni dans les structures, mais dans la qualité du lien humain. Là où l’assabiyya coulait comme un fleuve ardent dans les veines des tribus, le capital social coule aujourd’hui dans les réseaux de confiance, dans la parole tenue, dans la main tendue. Et toujours, derrière les mots qui changent, demeure la même vérité : la force d’un groupe ne réside pas dans la somme de ses individus, mais dans l’intensité de ce qui les relie.
Le capital social : une force immatérielle mais éminemment productive. Invisible, et pourtant agissante comme un vent qui pousse les voiles, elle irrigue nos sociétés modernes de la même énergie que celle dont parlait Ibn Khaldoun. Ce n’est plus l’assabiyya des tribus du désert, mais la trame subtile des relations humaines, la confiance qui relie, la reconnaissance qui donne sens, la réciprocité qui rend le monde habitable.
Ce que l’économie ne peut mesurer, la sociologie le révèle : l’appartenance vaut capital
Dans ce tissage de liens se cachent des privilèges silencieux, des portes ouvertes, des solidarités invisibles qui fondent la puissance autant que la réussite. Ce que l’économie ne peut mesurer, la sociologie le révèle : l’appartenance vaut capital. James Coleman, lui, y voit un mécanisme d’action collective. Le capital social est une fonction. Il naît de la confiance, se nourrit de la réciprocité, et facilite l’action entre les hommes. Là où règne la confiance, les décisions s’accélèrent, les collaborations se multiplient, les coûts de transaction s’effacent. Dans cette mécanique sociale, la norme devient force motrice : chacun agit non par contrainte, mais par conscience du lien.
Ainsi, une même intuition traverse les siècles : la puissance d’un groupe humain ne dépend pas uniquement de ses richesses matérielles, mais de la qualité du tissu invisible qui relie ses membres. Ce capital social, immatériel mais fécond, est la véritable énergie des sociétés vivantes. Il ne s’achète pas, il se tisse. Il ne se décrète pas, il se mérite. Et lorsqu’il circule, il fait fleurir la confiance, la coopération et l’espérance, autant de richesses qui ne figurent dans aucun bilan, mais qui fondent l’avenir des civilisations.
L’énergie collective comme puissance motrice.
Lorsqu’on quitte le vocabulaire des institutions pour celui des forces invisibles, la cohésion humaine se révèle sous un autre visage : celui d’une énergie. Non plus seulement sociale ou politique, mais émotionnelle, presque cosmique, une vibration partagée qui met les âmes en mouvement autour d’une cause commune.
Cette énergie collective est la flamme intérieure des grands élans humains. Elle circule entre les êtres, relie les volontés, et transforme la simple coexistence en puissance d’action. C’est elle qui fait qu’un groupe devient plus qu’une addition d’individus : une respiration, un battement, une intention incarnée.
Le neurobiologiste Antonio Damasio, dans L’Erreur de Descartes, nous rappelle que toute décision, toute action, toute création, procède d’une impulsion émotionnelle. «L’émotion est la source d’énergie de la raison. Sans émotion, il n’y a ni but, ni mouvement, ni choix».
Ainsi, derrière chaque stratégie, chaque projet, chaque idéal collectif, se cache une charge affective : une intensité intérieure qui oriente la raison et lui donne sens. Sans cette énergie, la pensée s’éteint, l’action se fige, la volonté s’émiette. Vue sous cet angle, l’assabiyya d’Ibn Khaldoun apparaît comme une forme archaïque mais universelle de cette énergie émotionnelle partagée. Elle n’est pas qu’un lien de sang ou d’alliance : elle est un feu intérieur commun, un champ d’énergie qui confère direction, ferveur et persévérance à l’action collective. C’est la même force qui, dans les sociétés modernes, anime la passion patriotique, la ferveur religieuse, l’esprit d’équipe ou la conviction idéologique.
Cette énergie ne se décrète pas, elle s’éveille. Elle naît d’un sens partagé, d’une promesse qui dépasse les individus. Elle est la mémoire affective d’un destin commun. Et lorsque cette énergie circule librement, elle devient le moteur des civilisations : elle éclaire les projets, nourrit les engagements, et transforme la simple intention en réalité vécue.
Toute société vivante repose sur une force invisible, la confiance partagée, le lien symbolique et la capacité à se relier
Le fil tendu entre l’assabiyya d’Ibn Khaldoun et le capital social des penseurs contemporains révèle une vérité profonde, presque intemporelle : toute société vivante repose sur une force invisible, la confiance partagée, le lien symbolique, la capacité à se relier. Lorsque cette énergie se retire, les civilisations se fissurent ; lorsque qu’elle circule, les peuples se relèvent.
Dans nos organisations éclatées, nos nations fragmentées, nos communautés dispersées par la vitesse et l’individualisme, le défi n’est plus de retrouver le sang commun, mais le sens commun. Recréer une assabiyya du XXIᵉ siècle, c’est rallumer cette flamme silencieuse qui donne à chacun le sentiment d’appartenir à une même aventure. Cette nouvelle assabiyya n’est plus tribale, elle est symbolique, émotionnelle, narrative. Elle se tisse dans les récits qui unissent, dans les gestes de coopération, dans les valeurs partagées qui redonnent direction et dignité au vivre-ensemble. Les récits collectifs deviennent alors des foyers d’énergie : ils donnent forme au sens, font vibrer la mémoire et ouvrent l’horizon. Les pratiques collaboratives incarnent ce leadership partagé où l’autorité ne s’impose plus d’en haut, mais circule entre les consciences comme une responsabilité mutuelle. Et les valeurs communes, qu’il s’agisse d’un projet d’entreprise ou de société, deviennent les nouveaux pactes fondateurs, les contrats invisibles qui soudent les êtres autour d’une vision qui les dépasse. Ainsi naît l’assabiyya moderne : une cohésion sans murs, une tribu de sens plutôt qu’une tribu de sang. Elle ne s’hérite pas, elle se raconte. Elle ne se commande pas, elle s’inspire. Et c’est peut-être là la plus grande tâche du siècle : recréer, dans un monde saturé de connexions mais pauvre en liens, une fraternité consciente, une énergie collective fondée sur la confiance, l’écoute et la promesse partagée d’un avenir à bâtir ensemble.
Par Abderrazak Hamzaoui
Email : hamzaoui@hama-co.net
www.hama-co.net
Jim Collins, Good to Great: A Study of Management Strategies of Companies with Lasting Growth, 2001
James Coleman, “Social Capital in the Creation of Human Capital”, American Journal of Sociology, 94, 1988.
Ibn Khaldun, The Muqaddimah: An Introduction to History, transl. Franz Rosenthal
L’assabiyya. Une énergie de cohésion qui précède l’ordre et la loi
Dans Al-Muqaddima, Ibn Khaldoun scrute les entrailles du pouvoir et découvre qu’aucune grandeur humaine ne tient sans une force invisible : l’assabiyya. Une énergie de cohésion qui précède l’ordre et la loi, une fidélité réciproque tissée dans le sang, dans l’épreuve, dans la mémoire des alliances. Ce n’est pas une théorie abstraite, mais une expérience vécue : celle d’hommes qui se défendent, se soutiennent et s’unissent jusqu’à devenir un seul corps.
Une fraternité en mouvement, un souffle collectif qui donne au groupe la puissance d’un organisme vivant. Ibn Khaldoun voyait là le secret des civilisations : cette assabiyya est la racine de toute conquête et la sève de toute durée. Sans elle, la société s’effondre, se dissout dans le confort et la vanité. Avec elle, les peuples endurcis du désert, pauvres en biens mais riches en liens, renversent les royaumes repus, dont l’âme s’est éteinte dans la mollesse. Ainsi se joue le cycle de l’histoire : la solidarité engendre la puissance, la puissance engendre la décadence, et la décadence appelle une nouvelle assabiyya pour réanimer le monde.
Ce que les penseurs modernes nommeront plus tard capital social n’est, au fond, que la résonance de cette même intuition. Sous des habits savants, il s’agit toujours de cette force subtile qui circule entre les êtres et qui rend l’action collective possible. La confiance, la loyauté, le sentiment d’appartenance, la finalité partagée, autant de formes contemporaines de cette énergie collective dont Ibn Khaldoun fut le premier cartographe.
Le capital social est est la forme moderne d’une sagesse ancienne. Celle qui nous rappelle que le destin des organisations, des nations, comme des empires, ne se joue ni dans les chiffres ni dans les structures, mais dans la qualité du lien humain. Là où l’assabiyya coulait comme un fleuve ardent dans les veines des tribus, le capital social coule aujourd’hui dans les réseaux de confiance, dans la parole tenue, dans la main tendue. Et toujours, derrière les mots qui changent, demeure la même vérité : la force d’un groupe ne réside pas dans la somme de ses individus, mais dans l’intensité de ce qui les relie.
Le capital social : une force immatérielle mais éminemment productive. Invisible, et pourtant agissante comme un vent qui pousse les voiles, elle irrigue nos sociétés modernes de la même énergie que celle dont parlait Ibn Khaldoun. Ce n’est plus l’assabiyya des tribus du désert, mais la trame subtile des relations humaines, la confiance qui relie, la reconnaissance qui donne sens, la réciprocité qui rend le monde habitable.
Ce que l’économie ne peut mesurer, la sociologie le révèle : l’appartenance vaut capital
Dans ce tissage de liens se cachent des privilèges silencieux, des portes ouvertes, des solidarités invisibles qui fondent la puissance autant que la réussite. Ce que l’économie ne peut mesurer, la sociologie le révèle : l’appartenance vaut capital. James Coleman, lui, y voit un mécanisme d’action collective. Le capital social est une fonction. Il naît de la confiance, se nourrit de la réciprocité, et facilite l’action entre les hommes. Là où règne la confiance, les décisions s’accélèrent, les collaborations se multiplient, les coûts de transaction s’effacent. Dans cette mécanique sociale, la norme devient force motrice : chacun agit non par contrainte, mais par conscience du lien.
Ainsi, une même intuition traverse les siècles : la puissance d’un groupe humain ne dépend pas uniquement de ses richesses matérielles, mais de la qualité du tissu invisible qui relie ses membres. Ce capital social, immatériel mais fécond, est la véritable énergie des sociétés vivantes. Il ne s’achète pas, il se tisse. Il ne se décrète pas, il se mérite. Et lorsqu’il circule, il fait fleurir la confiance, la coopération et l’espérance, autant de richesses qui ne figurent dans aucun bilan, mais qui fondent l’avenir des civilisations.
L’énergie collective comme puissance motrice.
Lorsqu’on quitte le vocabulaire des institutions pour celui des forces invisibles, la cohésion humaine se révèle sous un autre visage : celui d’une énergie. Non plus seulement sociale ou politique, mais émotionnelle, presque cosmique, une vibration partagée qui met les âmes en mouvement autour d’une cause commune.
Cette énergie collective est la flamme intérieure des grands élans humains. Elle circule entre les êtres, relie les volontés, et transforme la simple coexistence en puissance d’action. C’est elle qui fait qu’un groupe devient plus qu’une addition d’individus : une respiration, un battement, une intention incarnée.
Le neurobiologiste Antonio Damasio, dans L’Erreur de Descartes, nous rappelle que toute décision, toute action, toute création, procède d’une impulsion émotionnelle. «L’émotion est la source d’énergie de la raison. Sans émotion, il n’y a ni but, ni mouvement, ni choix».
Ainsi, derrière chaque stratégie, chaque projet, chaque idéal collectif, se cache une charge affective : une intensité intérieure qui oriente la raison et lui donne sens. Sans cette énergie, la pensée s’éteint, l’action se fige, la volonté s’émiette. Vue sous cet angle, l’assabiyya d’Ibn Khaldoun apparaît comme une forme archaïque mais universelle de cette énergie émotionnelle partagée. Elle n’est pas qu’un lien de sang ou d’alliance : elle est un feu intérieur commun, un champ d’énergie qui confère direction, ferveur et persévérance à l’action collective. C’est la même force qui, dans les sociétés modernes, anime la passion patriotique, la ferveur religieuse, l’esprit d’équipe ou la conviction idéologique.
Cette énergie ne se décrète pas, elle s’éveille. Elle naît d’un sens partagé, d’une promesse qui dépasse les individus. Elle est la mémoire affective d’un destin commun. Et lorsque cette énergie circule librement, elle devient le moteur des civilisations : elle éclaire les projets, nourrit les engagements, et transforme la simple intention en réalité vécue.
Toute société vivante repose sur une force invisible, la confiance partagée, le lien symbolique et la capacité à se relier
Le fil tendu entre l’assabiyya d’Ibn Khaldoun et le capital social des penseurs contemporains révèle une vérité profonde, presque intemporelle : toute société vivante repose sur une force invisible, la confiance partagée, le lien symbolique, la capacité à se relier. Lorsque cette énergie se retire, les civilisations se fissurent ; lorsque qu’elle circule, les peuples se relèvent.
Dans nos organisations éclatées, nos nations fragmentées, nos communautés dispersées par la vitesse et l’individualisme, le défi n’est plus de retrouver le sang commun, mais le sens commun. Recréer une assabiyya du XXIᵉ siècle, c’est rallumer cette flamme silencieuse qui donne à chacun le sentiment d’appartenir à une même aventure. Cette nouvelle assabiyya n’est plus tribale, elle est symbolique, émotionnelle, narrative. Elle se tisse dans les récits qui unissent, dans les gestes de coopération, dans les valeurs partagées qui redonnent direction et dignité au vivre-ensemble. Les récits collectifs deviennent alors des foyers d’énergie : ils donnent forme au sens, font vibrer la mémoire et ouvrent l’horizon. Les pratiques collaboratives incarnent ce leadership partagé où l’autorité ne s’impose plus d’en haut, mais circule entre les consciences comme une responsabilité mutuelle. Et les valeurs communes, qu’il s’agisse d’un projet d’entreprise ou de société, deviennent les nouveaux pactes fondateurs, les contrats invisibles qui soudent les êtres autour d’une vision qui les dépasse. Ainsi naît l’assabiyya moderne : une cohésion sans murs, une tribu de sens plutôt qu’une tribu de sang. Elle ne s’hérite pas, elle se raconte. Elle ne se commande pas, elle s’inspire. Et c’est peut-être là la plus grande tâche du siècle : recréer, dans un monde saturé de connexions mais pauvre en liens, une fraternité consciente, une énergie collective fondée sur la confiance, l’écoute et la promesse partagée d’un avenir à bâtir ensemble.
Par Abderrazak Hamzaoui
Email : hamzaoui@hama-co.net
www.hama-co.net
Jim Collins, Good to Great: A Study of Management Strategies of Companies with Lasting Growth, 2001
James Coleman, “Social Capital in the Creation of Human Capital”, American Journal of Sociology, 94, 1988.
Ibn Khaldun, The Muqaddimah: An Introduction to History, transl. Franz Rosenthal
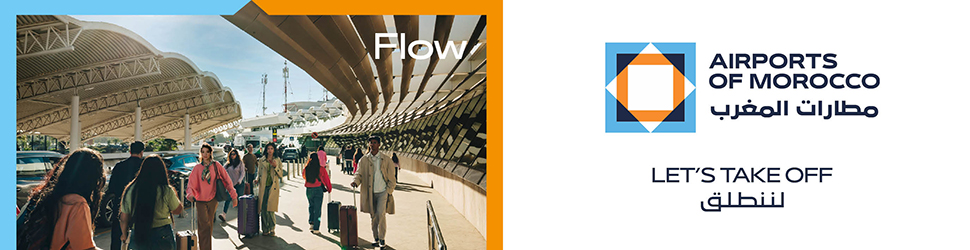



















 Pourquoi Bank Al-Maghrib tarde-t-elle à baisser son taux directeur ?
Pourquoi Bank Al-Maghrib tarde-t-elle à baisser son taux directeur ?





