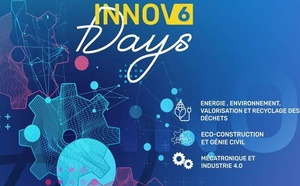-
Participation du Maroc à la 2ème réunion sur la stratégie arabe de l’éducation aux médias
-
Adoption de la Déclaration de Praia
-
Omar Hilale co-préside à New York le Forum de l'ECOSOC sur la science, la technologie et l'innovation
-
Des diplomates étrangers s'informent de la dynamique de développement à Dakhla-Oued Eddahab
La sécheresse actuelle est-elle un phénomène anormal ?
Non, elle n’est ni anormale ni exceptionnelle. La sécheresse n’est qu’une des deux faces d’une même pièce qui est l’irrégularité pluviométrique, donnée structurelle du climat marocain. L’histoire climatique du pays est rythmée par l’avènement de plusieurs années voire périodes sèches persistantes des fois pendant 4 à 5 ans à l’image de la sécheresse qui a sévi entre 1980 et 1985.
Comment la sécheresse de cette année s’explique-t-elle au regard de la circulation atmosphérique générale ?
Au Maroc et ailleurs, trois conditions doivent être réunies pour que la pluie se produise, ce sont les mécanismes locaux de la pluviogenèse. D’abord, la disponibilité d’un potentiel précipitable, celui-ci est d’autant plus important que l’air est chargé en vapeur d’eau. Le Maroc tire profit de sa position aux bords de la Méditerranée et de l’océan Atlantique en s’assurant une grande réserve d’eau qui favorise l’advection et l’humidification de l’air. La deuxième condition est la présence de mouvements ascendants de l’air qui sont indispensables pour la formation des nuages. L’ascendance peut être cyclonique, ou d’instabilité résultant d’un fort gradient thermique entre le sol et l’air en altitude, ou alors dynamique/orographique lorsque l’air est contraint à s’élever en rencontrant le relief. La troisième condition indispensable pour l’avènement de la pluie est l’absence dans l’atmosphère d’une structure verticale stérilisante. En effet, la structure verticale de l’atmosphère ne doit pas s’opposer à l’ascendance de l’air. Pour ce fait, elle ne doit pas présenter une stratification avec des couches superposées aux caractéristiques contrastées. Elle ne doit pas comporter de cisaillement de vent pouvant défavoriser le développement de nuages en altitude. De même, la structure verticale de l’atmosphère ne doit pas être affectée par la subsidence synonyme de situation de stabilité anticyclonique.
Dans le cas du Maroc, les deux premières conditions, à savoir le potentiel précipitable et l’ascendance de l’air, peuvent être réunies, mais c’est le blocage anticyclonique qui s’oppose à l’aboutissement du processus.
Les raisons de ce blocage doivent être recherchées dans un cadre géographique plus large. La pluviométrie au Maroc est tributaire de la circulation atmosphérique générale de l’hémisphère Nord. Plusieurs études ont démontré une anti-corrélation de la pluviométrie marocaine notamment dans la partie Nord-Ouest du pays avec l’Oscillation Nord Atlantique (ONA) ou NOA pour les anglophones. Le calcul de cette oscillation, qui fait sentir ses effets en hiver, est basé sur la différence de pression atmosphérique entre la dépression de l’Islande et l’anticyclone des Açores. Autrement dit, lorsque l’ONA est dans une phase d’affaiblissement présentant donc un indice négatif, elle est synonyme de pluviométrie positive pour le Maroc. Lorsqu’elle se renforce en présentant une grande différence de pression entre une dépression d’Islande très creuse et un anticyclone des Açores très vigoureux et donc un indice positif, comme c’est le cas actuellement, le Maroc subit un déficit pluviométrique. En ce sens, il est intéressant de souligner que l’ONA, très bon indicateur du climat dans l’espace Atlantique Nord, dont le Maroc, notamment son aspect pluviométrique s’inscrit dans une tendance positive depuis les années 1970 même si d’une année à l’autre, son évolution est variable. Rappelons aussi que la sécheresse la plus marquante et la plus persistante dans le temps de ces cinquante dernières années au Maroc (1980-1985) a coïncidé avec un renforcement continu de l’ONA pendant cette même période.
Le renforcement de l’ONA est-il une conséquence du changement climatique ?
Il est très difficile d’affirmer une relation de cause à effet entre le changement climatique et la persistance de l’ONA dans sa phase positive. Ceci est d’autant plus délicat que la variabilité décennale est une des caractéristiques intrinsèques de l’ONA. Si elle persiste dans un mode positif depuis les années 1970, avant cette période, elle s’est inscrite dans un mode négatif entre 1950 et 1970. En revanche, il reste intéressant d’observer que sept parmi les dix valeurs les plus élevées de l’indice de l’ONA enregistrées au cours des 150 dernières années, se concentrent sur la période qui commence en 1980 à nos jours.
Et El Nino très actif en 2015-2016 a-t-il des liens avec la sécheresse au Maroc ?
El Nino, très intense à la fin de l’année 2015 a commencé à perdre en intensité dès mi janvier 2016. La manifestation météorologique principale de ce phénomène dont le théâtre est l’océan Pacifique, est le réchauffement des eaux de surface marine à l’est du Pacifique qui enregistre de fortes anomalies chaudes (plus de +2°C) depuis septembre 2015. Il en résulte des pluies diluviennes dans des régions habituellement arides situées sur le versant ouest de l’Amérique du Sud (Chili, Pérou, Argentine…) et même dans le Sud des Etats-Unis. D’un autre côté, des régions habituellement humides enregistrent un déficit pluviométrique comme ce qui s’est passé en Indonésie, en Australie orientale, aux Caraïbes ou encore dans le Nord-est du Brésil.
Souvent, l’idée de surpuissance du phénomène d’El Nino est véhiculée par le biais de certains médias. Selon cette idée, El Nino serait responsable du dérèglement climatique dans le monde. Dans le cas de la sécheresse qui frappe actuellement le Maroc, plusieurs déclarations ont été faites dans le sens de l’accréditation de cette hypothèse selon laquelle, El Nino serait responsable de cette sécheresse sans expliquer ni le comment ni le pourquoi. Pour répondre à cette interrogation, il faut revenir sur l’origine de la dynamique de ce phénomène.
A l’origine, c’est le facteur vent qui déclenche El Nino. Tout d’abord, les alizés (des vents réguliers de direction est/ouest actifs dans les zones intertropicales) qui prédominent près des côtes chilienne et péruvienne en soufflant du sud-est vers le nord-ouest chassent les eaux chaudes de surface de l’océan Pacifique vers l’ouest en favorisant ainsi la mise en place de l’upwelling (remontée des eaux froides). Il arrive que cette circulation d’alizé soit affaiblie voire inversée dans le cas où des vents d’ouest sont plus forts. Les eaux de surface marine au large du Pacifique, qui sont plus chaudes sont alors véhiculées via ces vents d’ouest vers la côte américaine sud-ouest.
Plusieurs études ont démontré que lors des épisodes El Nino, la Zone de convergence intertropicale (ZCIT) migre plus qu’en temps normal vers le sud. Ce qui peut être expliqué par une activité plus intense des alizés de l’hémisphère Nord et donc une prédominance de l’activité de la circulation générale de l’hémisphère Nord au détriment de celle de l’hémisphère Sud. De la même manière, la phase positive de l’ONA est liée à une accélération de la circulation générale de l’hémisphère Nord. Voilà ce qui explique cette association systématique dans les esprits entre la sécheresse au Maroc et El Nino. En effet, statistiquement, on peut établir un lien entre l’ONA positive et El Nino, étant donné le contexte atmosphérique qui les réunit.
En substance, le lien entre El Nino et la sécheresse au Maroc est souvent établi selon un raccourci erroné qui fait porter, à tort, au phénomène El Nino la responsabilité de la sécheresse, alors qu’il n’est lui-même que la conséquence, au même titre que cette dernière, de l’intensification de la circulation atmosphérique général de l’hémisphère Nord.