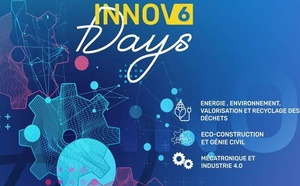-
Participation du Maroc à la 2ème réunion sur la stratégie arabe de l’éducation aux médias
-
Adoption de la Déclaration de Praia
-
Omar Hilale co-préside à New York le Forum de l'ECOSOC sur la science, la technologie et l'innovation
-
Des diplomates étrangers s'informent de la dynamique de développement à Dakhla-Oued Eddahab

Sous l’influence de plusieurs aléas, il y a eu une dégradation des conditions climatiques qui a fait que les populations ont eu recours au pompage des ressources de la nappe phréatique, ce qui a causé son épuisement et plusieurs oasis ont, par conséquent, été désertées par leurs exploitants.
Ayant conscience de la vitalité de ce composé chimique et de sa primordialité pour leur pérennité et prospérité, les habitants de plusieurs régions oasiennes que nous avons rencontrés à l’occasion du Salon international des dattes (SID) à Erfoud, notamment ceux de Tinjdad, Oued Ghriss et Boudnib nous ont affirmé qu’ils se trouvent désormais confrontés à d’énormes difficultés pour se ravitailler en eau. «Vous savez que sur les 30 dernières années, deux décennies ont été marquées par la sécheresse. L'approvisionnement en eau a été assuré grâce à la nappe phréatique. Mais de nos jours, cette nappe s’est de plus en plus épuisée à cause d’une exploitation excessive», nous a affirmé un agriculteur de la région de Boudnib en ajoutant qu’il y a quelques années, ils trouvaient de l’eau en creusant des puits de 5 à 8 mètres, mais qu’actuellement, ils doivent creuser jusqu’à 80 mètres pour en trouver.
Profitant du malheur des habitants de la région, plusieurs investisseurs qui ont été séduits par les prix abordables des terres, se sont installés ces dernières années dans la région et ont boudé les palmeraies à cause de la pénurie de l’eau.
Cette situation remet en cause la politique hydraulique adoptée depuis des décennies, basée sur la construction de barrages et la mise en place d'un système institutionnel et juridique pour la gestion intégrée des ressources en eau. Ce dernier n’est pas du tout respecté selon certains habitants de la région qui parlent de licences de puits distribuées n’importe comment.
«L’agence hydraulique donne jusqu’à 10 autorisations à une seule personne, qui peut par la suite creuser des puits sans respecter la distance normale qui doit les séparer», nous a dévoilé un ingénieur sous le sceau de l’anonymat. «Les autorités doivent agir afin de pouvoir sécuriser et pérenniser les ressources en eau», a-t-il poursuivi, ajoutant que le secteur de l'eau reste confronté à de nombreux défis notamment sa raréfaction du fait des changements climatiques et de la détérioration de sa qualité.
Parmi les facteurs qui affectent la production, différents experts ont été unanimes sur le fait que plusieurs attitudes irrationnelles et archaïques perdurent sous le couvert du respect des coutumes, et entraînent de ce fait des productions médiocres. Ce qui impose la nécessité d’encadrer les agriculteurs et de former une nouvelle génération de techniciens et d’ingénieurs capables d’introduire de nouvelles procédures et techniques rationnelles de plantation et d’irrigation.
A titre d’exemple, lors de la visite qu’il a effectuée dans la région, le ministre de l’Agriculture et de la Pêche maritime a demandé à un agriculteur combien de litres il utilisait quotidiennement pour arroser chaque pied de palmier. Ce dernier lui a répondu 1000 litres, affirmation qui a fait sursauter certains ingénieurs hydrauliques.
L’un d’entre eux, Ataa Abouatallah, spécialiste en irrigation et technologies de l’eau nous a assuré que «cette moyenne de 1000 litres dépasse de trop le besoin en eau du palmier dattier, arbre qui résiste pourtant fort bien à la sécheresse».
Pour sa part, M. Sabri de l’Institut national de la recherche agronomique, nous a expliqué que «le besoin annuel en eau par palmier-dattier est de 60 m3» en précisant qu’ «avec 6000 à 9000 m3 par hectare, on peut produire et assurer la pérennité de la production», alors que «les agriculteurs utilisent entre 20.000 et 50.000 m3 à l’hectare».
Certes, il y a de plus en plus de prise de conscience du fait que le développement de ces régions passe par la plantation, autant que faire se peut, de nouveaux palmiers-dattiers, en recourant aux ressources hydriques actuellement mobilisables qu’il ne faut surtout pas surexploiter.