
I - Les routes de l’expatriation
«En surfant sur le net, je tombe sur Sciences-po. Je regarde les anciens de l’école et je me dis : “pas mal !” Et puis je tente et ça marche ». Cet étudiant camerounais diplômé de Sciences-po en Economie et finance en 2009 résume d’un trait l’alliage contemporain entre de nouvelles technologies de communication, des opportunités élargies d’expatriation universitaire et des référents historiques qui signent le prestige d’une formation d’élite.
Les études supérieures en France sont un terrain connu pour nombre d’élites d’Afrique subsaharienne : d’un Léopold Senghor, élève de la Sorbonne, à un Paul Biya, diplômé de Sciences-po en Relations internationales, la formation universitaire en France n’a cessé de recouvrir des enjeux stratégiques. On connaît bien les élites africaines d’hier : les « évolués » formés par le système colonial, les cadres africanisés au moment des indépendances et ceux qui ont été au fondement de la Françafrique. Mais qui sont les jeunes élites d’aujourd’hui ?
La nouvelle donne internationale a changé : la mondialisation signe le décloisonnement des relations qu’entretient le sous-continent africain avec le monde. Quelles sont, dès lors, les dynamiques qui sous-tendent, rythment, encouragent ou restreignent l’expatriation universitaire des étudiants d’Afrique subsaharienne ?
C’est à partir de cette question qu’une étude a été menée au sein de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris, auprès des étudiants d’Afrique subsaharienne que l’Institut a accueilli depuis les années 1960. Pourquoi ces étudiants ont-ils choisi Sciences-po ? Qui sont-ils ? Quelle formation ont-ils suivie ? Quels sont leurs projets ou que sont-ils devenus ? Quel rapport entretiennent-ils avec l’international mais aussi avec leur pays d’origine ? L’exemple de Sciences-po est d’autant plus pertinent que l’école cherche de plus en plus à dépasser les frontières et à échapper à l’image d’un élitisme « franco-français ». Sciences-po reste une école d’élite et cette sélectivité est fortement valorisée par les étudiants ; mais ses formations et ses diplômes ont une envergure internationale : à l’heure de l’internationalisation du marché du travail, le choix d’y étudier en est d’autant plus stratégique. L’étude a porté sur une période longue, de 1960 à 2010. Elle a permis de faire ressortir des trajectoires et d’interpréter leur évolution qualitative. Les années 1960 ne concernent évidemment pas la formation des élites qui ont « fait » les indépendances de leur pays, celles-ci ayant été formées bien avant. Mais elles constituent un point de départ révélateur : la plupart des indépendances d’Afrique subsaharienne étant acquises, quels sont les combats que mènent et mèneront les futures élites ?
Il faut tout d’abord noter que l’Afrique subsaharienne est très faiblement représentée au sein de l’IEP. De 1960 à 2009, elle n’a représenté que 2,7 % de l’effectif total des étudiants étrangers. Plus encore, le sous-continent n’est que partiellement représenté : seulement 23 nationalités (sur les 48 constituant la région) comptées pendant la période, majoritairement francophones. Si des raisons d’ordre structurel peuvent expliquer ce déficit de représentation (marasme de l’enseignement supérieur en Afrique subsaharienne), il faut souligner que la réputation de Sciences-po en Afrique subsaharienne demeure récente et pâtit d’une réputation d’école de « sciences politiques politiciennes » qui a perdu de son attrait auprès de la jeunesse africaine. Le choix de Sciences-po ne demeure pas moins stratégique, pour une population relativement ciblée. En effet, l’étude sociologique menée auprès des étudiants d’Afrique subsaharienne à Sciences-po a montré que ces derniers appartiennent à une jeune élite sociale et professionnelle, essentiellement intellectuelle et issue d’un milieu francophone – nombre d’étudiants ont un ou plusieurs membres de leur famille ayant fait des études en France, par exemple ; plus largement, le legs colonial marque encore beaucoup les enseignements en Afrique subsaharienne. Néanmoins, 55 % des étudiants bénéficient d’une bourse d’étude et 59 % ont également recours aux ressources financières parentales, ce qui témoigne d’une certaine ouverture sociale.
Le choix de l’expatriation, s’il procède souvent de la volonté d’échapper à la saturation de l’enseignement supérieur africain, n’en demeure pas moins « naturel » : non seulement l’expatriation est valorisée au sein de leur famille – certains étudiants suivant « l’exemple » d’un ou de plusieurs membres de leur famille – et de leur société – révélant la persistance d’un « complexe de l’Occident », comme le dit une étudiante camerounaise en Finance et stratégie – mais surtout, elle participe d’une quête de prestige et d’excellence. « Pour ma famille, c’était une fierté parce qu’en Afrique, quand un étudiant doit continuer sa formation en Occident, c’est une preuve de succès, d’excellence aussi », témoigne un étudiant ivoirien diplômé en Finance et stratégie. Les études expatriées sont donc un signe de réussite scolaire et sociale. Par ailleurs, ces étudiants ne sont pas tant à la recherche d’une formation intellectuelle que d’une formation compétitive, d’excellence et labellisée par un diplôme garantissant leur insertion sur le marché international du travail, autant que dans la mondialisation. De fait, leurs choix d’orientation marquent une nette préférence pour les domaines de la finance et de l’économie, des domaines jugés « scientifiques » et « neutres ». Cette tendance n’est pas propre à l’Afrique subsaharienne. Elle renvoie à un mouvement plus global : le savoir est devenu une forme de capital. Ce phénomène, connu sous le nom d’«économie de la connaissance» (knowledge-based economy), rend compte du nouveau couple «internationalisation de l’enseignement - internationalisation du marché du travail» : la connaissance étant devenue capital (dès lors que la capacité à acquérir et à utiliser un savoir scientifique et technique constitue un potentiel de puissance – ce que Joseph Nye a notamment appelé le « soft power »), le capital économique n’est plus le seul déterminant des relations de pouvoir sur la scène internationale. Il doit être combiné à un capital humain, tenu d’être tout autant compétitif. Or, cette manière d’envisager le monde est particulièrement significative chez les étudiants d’Afrique subsaharienne et témoigne d’un changement qualitatif entre deux générations d’élites : à la lutte pour la décolonisation semble avoir succédé la lutte pour l’internationalisation. Comment celle-ci se traduit-elle ?
Une élite
« désidéologisée »
en quête
d’accumulation
de connaissances
et de compétences
L’enquête menée auprès des étudiants a montré une nette « désidéologisation ». Contrairement aux étudiants des années 1950 et 1960 engagés dans la lutte pour les indépendances, les étudiants d’Afrique subsaharienne à Sciences-po cherchent à se distancier d’un univers politique privé de sa valeur, marqué par le poids de la corruption et des espoirs déçus et dominé par des politiques qui ont perdu, selon eux, tout crédit. Pour autant, cela ne signifie pas que ces étudiants ne croient plus en rien. Au contraire, la désidéologisation est contrebalancée par une foi dans le règne de la compétence érigée en investissement durable. De fait, leur approche dépassionnée de la formation universitaire ne doit pas masquer que cette jeune élite technocratique a parfaitement saisi le bouleversement des défis auxquels l’Afrique subsaharienne contemporaine est confrontée. Ainsi, l’expatriation universitaire est envisagée comme un détour stratégique pour accumuler des connaissances scientifiques et maîtriser les « outils de la mondialisation ». Un étudiant malien, également diplômé en Finance et stratégie, explique : « La mondialisation est une opportunité inédite […]. Est-ce qu’il faut remettre en cause les règles du jeu ? Oui. Mais est-ce qu’il ne faut pas aussi jouer avec les règles du jeu ? Oui [...]. Il faut ouvrir le débat sur [ces] règles pour qu’[elles] soient un tout petit peu plus justes mais il faut également être pragmatique et attaquer les choses comme elles nous viennent ». L’évolution qualitative est de taille : la mondialisation n’est plus perçue comme le « fardeau » de l’Afrique ; loin de là, la nécessité de « se mondialiser » et de se projeter comme les « acteurs » de la mondialisation, est considérée par les étudiants comme la clé du développement pour leur pays.
Ce credo du « détour technocratique » conduit à deux observations majeures. D’abord, il nous amène à briser le mythe du non-retour et de la « fuite des cerveaux » de l’élite africaine. Nombre d’étudiants ont fait part d’un sentiment d’isolement vis-à-vis des enjeux internationaux et des outils à la fois techniques et intellectuels – places financières, développement d’un tissu économique dense... Partir à l’étranger, et plus particulièrement en Occident, est donc pour eux la possibilité de retrouver une place dans la mondialisation mais aussi de dépasser un savoir livresque et théorique pour pouvoir mettre en application concrète leurs connaissances. Nous l’avons vu, la standardisation des compétences à l’échelle internationale est désormais la matrice qui dicte les exigences de formation. Ainsi, accéder à une école du type de Sciences-po est un premier tremplin pour une carrière internationale et un moyen d’acquérir les outils qui leur permettront de trouver une place dans la mondialisation. Toutefois, si la mobilité des carrières est un objectif important, elle est d’abord considérée comme une étape stratégique. 58 % des étudiants d’Afrique subsaharienne diplômés de Sciences-po reviennent à terme dans leur pays d’origine. L’analyse des trajectoires professionnelles a montré que le mythe du « médecin africain » qui préfèrerait la France et son salaire à son pays est inopérant. Certes, les étudiants ont l’impression qu’une carrière internationale est la voie dorée pour s’accomplir professionnellement et qu’un retour prématuré dans leurs pays bornerait leurs ambitions. Mais, à travers cette volonté de s’inscrire dans la mondialisation, ils affirment leur volonté de mettre à profit leurs compétences pour le développement de leur pays. La notion d’expatriation se détache alors de toute idée de « défection » au profit d’une adhésion, d’un ralliement, d’une convergence flagrante se produisant sur fond d’internationalisation des savoirs et constituant un des changements majeurs dans la circulation des élites africaines contemporaines.
Ensuite, la notion de « détour technocratique » nous amène à reconnaître qu’une élite mondialisée n’est en rien une élite d’aliénés. Considérant le détour par « l’international » non comme une rente mais comme un passeport marqué du sceau de la modernité, de l’excellence, de la mondialisation, elle n’est ni occidentalisée, ni africanisée, mais plutôt labellisée.L’internationalisation revendiquée par Sciences-po est un atout majeur pour des étudiants qui recherchent une passerelle vers « l’international ». De fait, cet « international » renvoie davantage à un imaginaire symbolique qu’à une réalité géographique extensive, puisqu’il se réduit schématiquement à l’univers anglo-saxon, des grandes places financières aux organisations internationales, et encore moins à une réalité identitaire. Nous assistons donc à une double convergence, d’abord une convergence qui s’actualise par un ralliement à la cause économique, considérée comme une technique de gestion universelle ; puis une convergence des élites à l’international, dans une uniformisation des compétences et des savoirs, qui annonce une forme de « méta-intégration » des élites africaines formées à l’étranger dans l’ordre mondial.
L’internationalisation des formations et des carrières valide l’idée d’une circulation des compétences qui s’effectue cependant au sein de cercles d’influence relativement fermés – grandes écoles ou grandes universités internationales, grands groupes financiers, grands groupes industriels, grandes institutions internationales – avec un panel des carrières limité – auditeur, manageur, directeur général, consultant.
* (Doctorante au Centre d’études et de recherches internationales
de Sciences-politiques)
Fondation Jean-Jaurès
DEMAIN :
II- Le management
à l’international,
nouveau mode
d’expression politique ?
«En surfant sur le net, je tombe sur Sciences-po. Je regarde les anciens de l’école et je me dis : “pas mal !” Et puis je tente et ça marche ». Cet étudiant camerounais diplômé de Sciences-po en Economie et finance en 2009 résume d’un trait l’alliage contemporain entre de nouvelles technologies de communication, des opportunités élargies d’expatriation universitaire et des référents historiques qui signent le prestige d’une formation d’élite.
Les études supérieures en France sont un terrain connu pour nombre d’élites d’Afrique subsaharienne : d’un Léopold Senghor, élève de la Sorbonne, à un Paul Biya, diplômé de Sciences-po en Relations internationales, la formation universitaire en France n’a cessé de recouvrir des enjeux stratégiques. On connaît bien les élites africaines d’hier : les « évolués » formés par le système colonial, les cadres africanisés au moment des indépendances et ceux qui ont été au fondement de la Françafrique. Mais qui sont les jeunes élites d’aujourd’hui ?
La nouvelle donne internationale a changé : la mondialisation signe le décloisonnement des relations qu’entretient le sous-continent africain avec le monde. Quelles sont, dès lors, les dynamiques qui sous-tendent, rythment, encouragent ou restreignent l’expatriation universitaire des étudiants d’Afrique subsaharienne ?
C’est à partir de cette question qu’une étude a été menée au sein de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris, auprès des étudiants d’Afrique subsaharienne que l’Institut a accueilli depuis les années 1960. Pourquoi ces étudiants ont-ils choisi Sciences-po ? Qui sont-ils ? Quelle formation ont-ils suivie ? Quels sont leurs projets ou que sont-ils devenus ? Quel rapport entretiennent-ils avec l’international mais aussi avec leur pays d’origine ? L’exemple de Sciences-po est d’autant plus pertinent que l’école cherche de plus en plus à dépasser les frontières et à échapper à l’image d’un élitisme « franco-français ». Sciences-po reste une école d’élite et cette sélectivité est fortement valorisée par les étudiants ; mais ses formations et ses diplômes ont une envergure internationale : à l’heure de l’internationalisation du marché du travail, le choix d’y étudier en est d’autant plus stratégique. L’étude a porté sur une période longue, de 1960 à 2010. Elle a permis de faire ressortir des trajectoires et d’interpréter leur évolution qualitative. Les années 1960 ne concernent évidemment pas la formation des élites qui ont « fait » les indépendances de leur pays, celles-ci ayant été formées bien avant. Mais elles constituent un point de départ révélateur : la plupart des indépendances d’Afrique subsaharienne étant acquises, quels sont les combats que mènent et mèneront les futures élites ?
Il faut tout d’abord noter que l’Afrique subsaharienne est très faiblement représentée au sein de l’IEP. De 1960 à 2009, elle n’a représenté que 2,7 % de l’effectif total des étudiants étrangers. Plus encore, le sous-continent n’est que partiellement représenté : seulement 23 nationalités (sur les 48 constituant la région) comptées pendant la période, majoritairement francophones. Si des raisons d’ordre structurel peuvent expliquer ce déficit de représentation (marasme de l’enseignement supérieur en Afrique subsaharienne), il faut souligner que la réputation de Sciences-po en Afrique subsaharienne demeure récente et pâtit d’une réputation d’école de « sciences politiques politiciennes » qui a perdu de son attrait auprès de la jeunesse africaine. Le choix de Sciences-po ne demeure pas moins stratégique, pour une population relativement ciblée. En effet, l’étude sociologique menée auprès des étudiants d’Afrique subsaharienne à Sciences-po a montré que ces derniers appartiennent à une jeune élite sociale et professionnelle, essentiellement intellectuelle et issue d’un milieu francophone – nombre d’étudiants ont un ou plusieurs membres de leur famille ayant fait des études en France, par exemple ; plus largement, le legs colonial marque encore beaucoup les enseignements en Afrique subsaharienne. Néanmoins, 55 % des étudiants bénéficient d’une bourse d’étude et 59 % ont également recours aux ressources financières parentales, ce qui témoigne d’une certaine ouverture sociale.
Le choix de l’expatriation, s’il procède souvent de la volonté d’échapper à la saturation de l’enseignement supérieur africain, n’en demeure pas moins « naturel » : non seulement l’expatriation est valorisée au sein de leur famille – certains étudiants suivant « l’exemple » d’un ou de plusieurs membres de leur famille – et de leur société – révélant la persistance d’un « complexe de l’Occident », comme le dit une étudiante camerounaise en Finance et stratégie – mais surtout, elle participe d’une quête de prestige et d’excellence. « Pour ma famille, c’était une fierté parce qu’en Afrique, quand un étudiant doit continuer sa formation en Occident, c’est une preuve de succès, d’excellence aussi », témoigne un étudiant ivoirien diplômé en Finance et stratégie. Les études expatriées sont donc un signe de réussite scolaire et sociale. Par ailleurs, ces étudiants ne sont pas tant à la recherche d’une formation intellectuelle que d’une formation compétitive, d’excellence et labellisée par un diplôme garantissant leur insertion sur le marché international du travail, autant que dans la mondialisation. De fait, leurs choix d’orientation marquent une nette préférence pour les domaines de la finance et de l’économie, des domaines jugés « scientifiques » et « neutres ». Cette tendance n’est pas propre à l’Afrique subsaharienne. Elle renvoie à un mouvement plus global : le savoir est devenu une forme de capital. Ce phénomène, connu sous le nom d’«économie de la connaissance» (knowledge-based economy), rend compte du nouveau couple «internationalisation de l’enseignement - internationalisation du marché du travail» : la connaissance étant devenue capital (dès lors que la capacité à acquérir et à utiliser un savoir scientifique et technique constitue un potentiel de puissance – ce que Joseph Nye a notamment appelé le « soft power »), le capital économique n’est plus le seul déterminant des relations de pouvoir sur la scène internationale. Il doit être combiné à un capital humain, tenu d’être tout autant compétitif. Or, cette manière d’envisager le monde est particulièrement significative chez les étudiants d’Afrique subsaharienne et témoigne d’un changement qualitatif entre deux générations d’élites : à la lutte pour la décolonisation semble avoir succédé la lutte pour l’internationalisation. Comment celle-ci se traduit-elle ?
Une élite
« désidéologisée »
en quête
d’accumulation
de connaissances
et de compétences
L’enquête menée auprès des étudiants a montré une nette « désidéologisation ». Contrairement aux étudiants des années 1950 et 1960 engagés dans la lutte pour les indépendances, les étudiants d’Afrique subsaharienne à Sciences-po cherchent à se distancier d’un univers politique privé de sa valeur, marqué par le poids de la corruption et des espoirs déçus et dominé par des politiques qui ont perdu, selon eux, tout crédit. Pour autant, cela ne signifie pas que ces étudiants ne croient plus en rien. Au contraire, la désidéologisation est contrebalancée par une foi dans le règne de la compétence érigée en investissement durable. De fait, leur approche dépassionnée de la formation universitaire ne doit pas masquer que cette jeune élite technocratique a parfaitement saisi le bouleversement des défis auxquels l’Afrique subsaharienne contemporaine est confrontée. Ainsi, l’expatriation universitaire est envisagée comme un détour stratégique pour accumuler des connaissances scientifiques et maîtriser les « outils de la mondialisation ». Un étudiant malien, également diplômé en Finance et stratégie, explique : « La mondialisation est une opportunité inédite […]. Est-ce qu’il faut remettre en cause les règles du jeu ? Oui. Mais est-ce qu’il ne faut pas aussi jouer avec les règles du jeu ? Oui [...]. Il faut ouvrir le débat sur [ces] règles pour qu’[elles] soient un tout petit peu plus justes mais il faut également être pragmatique et attaquer les choses comme elles nous viennent ». L’évolution qualitative est de taille : la mondialisation n’est plus perçue comme le « fardeau » de l’Afrique ; loin de là, la nécessité de « se mondialiser » et de se projeter comme les « acteurs » de la mondialisation, est considérée par les étudiants comme la clé du développement pour leur pays.
Ce credo du « détour technocratique » conduit à deux observations majeures. D’abord, il nous amène à briser le mythe du non-retour et de la « fuite des cerveaux » de l’élite africaine. Nombre d’étudiants ont fait part d’un sentiment d’isolement vis-à-vis des enjeux internationaux et des outils à la fois techniques et intellectuels – places financières, développement d’un tissu économique dense... Partir à l’étranger, et plus particulièrement en Occident, est donc pour eux la possibilité de retrouver une place dans la mondialisation mais aussi de dépasser un savoir livresque et théorique pour pouvoir mettre en application concrète leurs connaissances. Nous l’avons vu, la standardisation des compétences à l’échelle internationale est désormais la matrice qui dicte les exigences de formation. Ainsi, accéder à une école du type de Sciences-po est un premier tremplin pour une carrière internationale et un moyen d’acquérir les outils qui leur permettront de trouver une place dans la mondialisation. Toutefois, si la mobilité des carrières est un objectif important, elle est d’abord considérée comme une étape stratégique. 58 % des étudiants d’Afrique subsaharienne diplômés de Sciences-po reviennent à terme dans leur pays d’origine. L’analyse des trajectoires professionnelles a montré que le mythe du « médecin africain » qui préfèrerait la France et son salaire à son pays est inopérant. Certes, les étudiants ont l’impression qu’une carrière internationale est la voie dorée pour s’accomplir professionnellement et qu’un retour prématuré dans leurs pays bornerait leurs ambitions. Mais, à travers cette volonté de s’inscrire dans la mondialisation, ils affirment leur volonté de mettre à profit leurs compétences pour le développement de leur pays. La notion d’expatriation se détache alors de toute idée de « défection » au profit d’une adhésion, d’un ralliement, d’une convergence flagrante se produisant sur fond d’internationalisation des savoirs et constituant un des changements majeurs dans la circulation des élites africaines contemporaines.
Ensuite, la notion de « détour technocratique » nous amène à reconnaître qu’une élite mondialisée n’est en rien une élite d’aliénés. Considérant le détour par « l’international » non comme une rente mais comme un passeport marqué du sceau de la modernité, de l’excellence, de la mondialisation, elle n’est ni occidentalisée, ni africanisée, mais plutôt labellisée.L’internationalisation revendiquée par Sciences-po est un atout majeur pour des étudiants qui recherchent une passerelle vers « l’international ». De fait, cet « international » renvoie davantage à un imaginaire symbolique qu’à une réalité géographique extensive, puisqu’il se réduit schématiquement à l’univers anglo-saxon, des grandes places financières aux organisations internationales, et encore moins à une réalité identitaire. Nous assistons donc à une double convergence, d’abord une convergence qui s’actualise par un ralliement à la cause économique, considérée comme une technique de gestion universelle ; puis une convergence des élites à l’international, dans une uniformisation des compétences et des savoirs, qui annonce une forme de « méta-intégration » des élites africaines formées à l’étranger dans l’ordre mondial.
L’internationalisation des formations et des carrières valide l’idée d’une circulation des compétences qui s’effectue cependant au sein de cercles d’influence relativement fermés – grandes écoles ou grandes universités internationales, grands groupes financiers, grands groupes industriels, grandes institutions internationales – avec un panel des carrières limité – auditeur, manageur, directeur général, consultant.
* (Doctorante au Centre d’études et de recherches internationales
de Sciences-politiques)
Fondation Jean-Jaurès
DEMAIN :
II- Le management
à l’international,
nouveau mode
d’expression politique ?


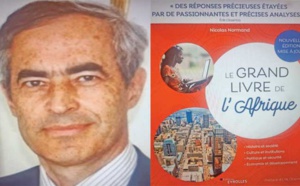
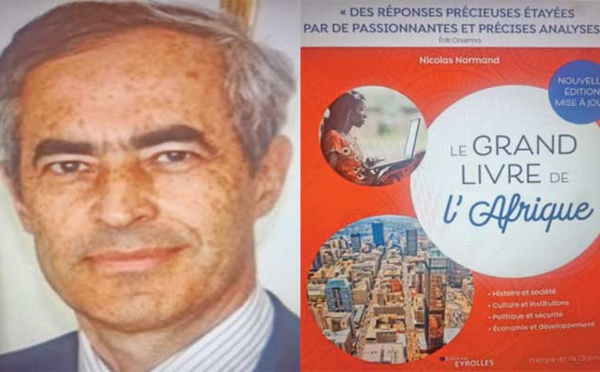












 Les défis et les perspectives dans la mise en œuvre du concept de l'Etat social au Maroc
Les défis et les perspectives dans la mise en œuvre du concept de l'Etat social au Maroc


